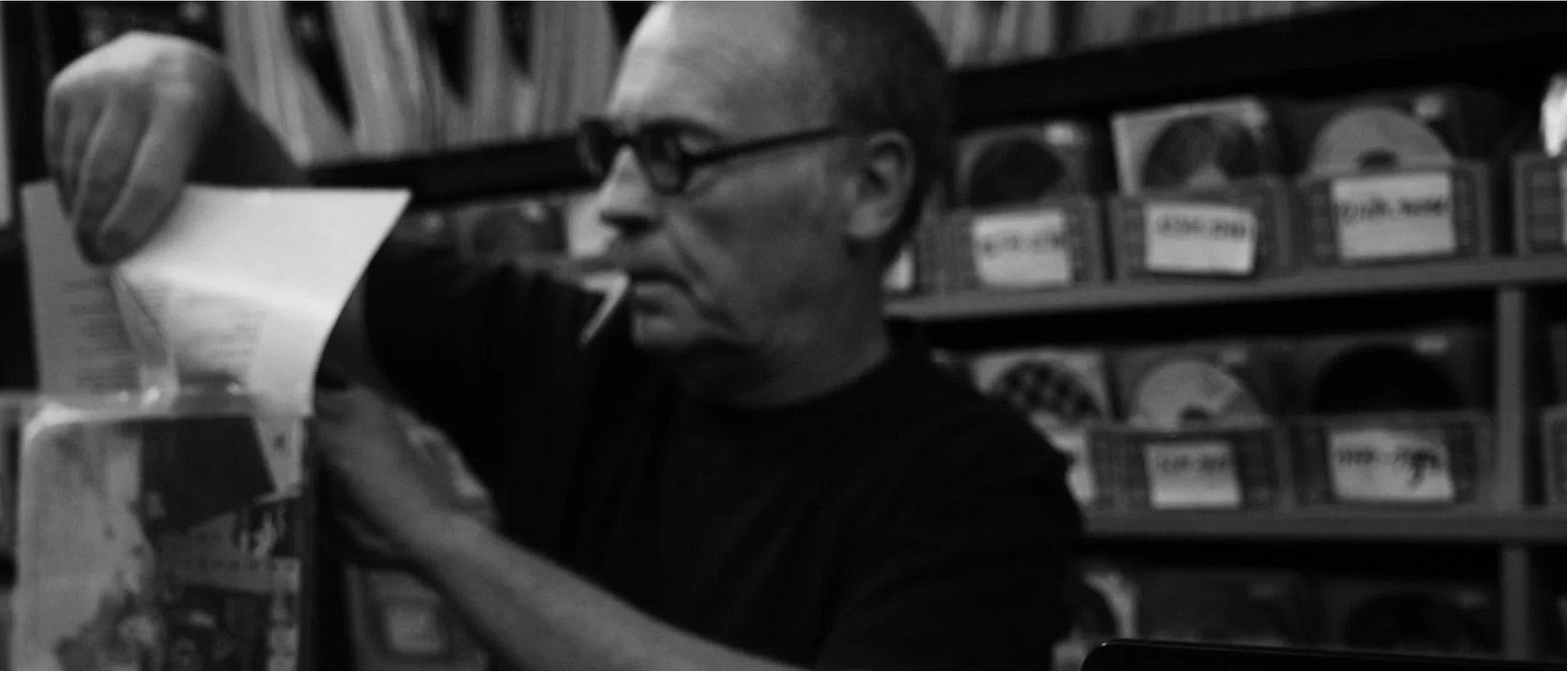Éditoriaux
Éditoriaux de 2026
Une façon de commencer 2026
Didier Périès
La semaine dernière, au chalet dans la Petite-Nation, j’ai eu l’opportunité de jouer à « The game ». Loin de mettre des individus ou des équipes en compétition, ce jeu de cartes force les participants à collaborer afin de compléter quatre suites, deux croissantes, de 1 à 100, et deux décroissantes, de 100 à 1. Rien d’extraordinaire, mais impossible de le faire seul-e avec les six cartes dont on dispose au début de la partie. Dans « The game », que l’on gagne ou perde, le résultat est collectif. Et j’ai trouvé difficile de communiquer simplement dans un but commun, tant nous sommes conditionnés à rivaliser avec autrui, à performer au détriment d’autrui. Comme l’a affirmé le philosophe anglais Thomas Hobbes, « L’homme est un loup pour l’homme » ; la vie, c’est « la guerre de tous contre tous », n’est-ce pas ? En d’autres termes, l’être humain serait essentiellement un être égoïste et violent ; la société l’éduquerait à être sociable et courtois, à recouvrir ses instincts d’un « vernis de civilisation ». Mais si c’était le contraire ?
En effet, si, dans notre société, ce système qui perdure depuis quelques milliers d’années, la véritable victoire est rare, elle est souvent le fait de quelques-uns au détriment de beaucoup d’autres. Regardez autour de vous les inégalités énormes, l’écart croissant entre les mieux nantis et les moins favorisés, à petite échelle, locale, à Aylmer, comme à l’échelle de la planète. Et si nous n’étions pas fondamentalement « mauvais » et notre existence sur terre vouée à être une compétition permanente? Les modèles sociaux depuis 10 000 ans corrompent notre nature, caractérisée par l’empathie, l’altruisme et le renoncement à soi pour le bien commun, ainsi que le démontre le philosophe Jean-Jacques Rousseau.
Si Hobbes considère fondamentalement l’humanité de manière pessimiste et que Rousseau la définit à l’opposé ; on peut considérer que les deux facettes coexistent. Alors la question cruciale, pratique, éthique devient : en quelle version croyons-nous le plus ? Parce que toutes les études scientifiques récentes s’accordent sur un fait : nos ancêtres cueilleurs-chasseurs et nomades étaient plus heureux et moins belliqueux que nous, qui avons matériellement un confort, dans un cadre social, plus sophistiqués qu’ils ne l’ont jamais été.
Nous ne sommes pas plus heureux collectivement. Collectivement. La mention est importante, parce que notre force en tant qu’espèce, y compris l’évolution de nos savoirs et techniques, a historiquement reposé sur notre capacité à socialiser mieux que n’importe quel autre mammifère, même à intelligence égale. Homo sapiens sait comment s’organiser pour vivre en grand groupe, comment joindre ses forces, comment négocier collectivement pour le bien de tous.
Les exemples positifs parsèment notre histoire récente, depuis les situations extrêmes de survivants de crash jusqu’à celles des populations harcelées, bombardées ou poussées à l’extinction. Cependant, l’histoire officielle et les médias, victimes d’un biais quasi instinctif, celui de la vigilance permanente pour identifier prioritairement les facteurs de risque et les dangers, les ont écartés. Pourquoi ne pas se les rappeler plus souvent et internaliser enfin que le temps est venu (à nouveau) de la solidarité, en commençant dans nos communautés proches et locales, mais en pensant à l’échelle planétaire ? Haut les cœurs ! Au fond de notre sentiment d’impuissance face à l’inéluctabilité des désastres de tous ordres se trouvent l’énergie et le potentiel de rebondir. Il faut le croire pour le voir.
Cette bactérie qui infecte la Terre depuis 10 000 ans
Didier Périès
Combien d’entre nous ont été malades pendant les congés de Noël à cause d’un vilain petit virus ? Pourtant les virus sont partout et pour ainsi dire impossibles à éviter. Par exemple, le VPH et l’herpès. Eh bien, ils étaient déjà présents il y a 40 000 ans dans le corps humain, selon les recherches archéologiques le plus récentes. Le premier peut induire des cancers, notamment de la gorge et des parties génitales ; le second cause notamment la roséole chez les jeunes enfants.
Et qu’il s’agisse d’Ust’-Ishim, un Homo sapiens de Sibérie, dont les restes sont vieux de 45 000 ans, ou d’Ötzi, un « homme des glaces » trouvé dans les Alpes, sapiens lui aussi, vieux de 5300 ans, dans les deux cas étudiés, la présence des virus que leur corps contient prouvent leur remarquable constance à travers les âges. Même les Néanderthaliens, une autre branche de l’espèce humaine souffrait d’une forme d’herpès. En fait, les chercheurs les ont retrouvés jusque dans nos chromosomes ; 10 % à 40 % de notre génome appartient aux virus ! Tout comme les bactéries, ils sont consubstantiels à l’être humain moderne.
Cependant, comme l’herpès, plusieurs virus sont latents, transmis d’une génération à l’autre, et cela pour 1 % de la population mondiale. Cela constitue un volume important, qui n’a pas l’air de réduire au fil des siècles, malgré les progrès des sciences. Ces virus et ces bactéries nous « bouffent » (littéralement) la vie. Car, s’ils peuvent nous rendre malades, ils ont aussi des rôles parfois positifs, ils font partie de notre « microbiote », comme nous-mêmes, humains, faisons partie du « macrobiote » terrestre.
Il en est d’ailleurs certains qui n’hésitent pas à assimiler l’humain à un parasite : pensez à notre rôle dans la crise climatique, dans la destruction de l’environnement naturel, au recul flagrant de la lutte pourtant nécessaire contre les changements climatiques de la part de nos décideurs au plus haut niveau (les Legault, Carney et autres grands dirigeants d’institutions financières, de firmes multinationales). Je ne peux m’empêcher de penser à cette bactérie « mangeuse de chair », dont le seul nom nous fait frémir. En serions-nous l’équivalent pour la Terre ?
À l’instar de cette bactérie, nous produisons des choses (matériaux de construction, plastiques, produits chimiques…) qui détruisent le « corps » terrestre, qui provoque aussi des réactions (fonte des glaces, réchauffement des mers, inondations, tempêtes, canicules…), autant de signes d’« infection ». Cela crée une sorte de « nécrose », c’est-à-dire une disparition des « tissus corporels », que sont la faune, la flore, les minéraux. Il en reste au mieux des cicatrices, au pire une amputation, avec un taux de mortalité de 30 % en ce qui concerne la bactérie mangeuse de chair.
Pour soigner, pas de vaccins, pas de remèdes miracles ou de technologie magique qui permet de revenir en arrière, à part peut-être la chirurgie. Ce sont les mesures de préventions que l’on préconise : nettoyer immédiatement une plaie, faire le suivi, avoir le bon médecin à disposition en cas de séquelles ou d’aggravation des symptômes, faire attention à ce que l’on ingère, digère et manipule. Après, le plus souvent, c’est trop tard. Cela semble plus facile à dire qu’à faire quand on ne pense qu’a soi, à court terme, et non à ses enfants, petits-enfants, jusqu’à la septième génération, ainsi que nous l’enseigne la sagesse autochtone.
Le pilote qui voit loin ne fera pas chavirer son bateau
Didier Périès
Un coup de tonnerre dans le ciel ennuagé de la politique québécoise, voilà ce que fut l’annonce inattendue de la démission du premier ministre François Legault. Certains ajouteraient que l’orage, la tempête, avait déjà éclaté et que ce n’est qu’un peu de bruit supplémentaire dans la cacophonie actuelle. Mais à défaut d’avoir peur, nous sommes en droit de nous interroger.
En effet, plusieurs dossiers attendent, ou plutôt n’attendront pas : gérer à la fois le futur chef du PLQ, probablement Charles Milliard ; PSPP et la domination du PQ dans les sondages ; la tentative du PCQ de Duhaime de doubler la CAQ par sa droite… Il faut y ajouter le rapport final de la commission Gallant sur la gestion et la modernisation de la SAAQ, le nouveau régime forestier, les élus indépendants à l’Assemblée nationale, les négociations avec les médecins spécialistes, les nouvelles cibles climatiques pendant la crise qui va s’accentuer, et, oh !, quelques projets de loi majeurs, tels que la suite et la fin du projet de loi de « Constitution québécoise » (face au « Livre bleu » du PQ), celui visant à renforcer la laïcité ou celui sur la gouvernance des syndicats… Tout cela dans un contexte international pour le moins changeant et précaire, en particulier à côté de notre gros voisin étatsunien.
Bref, il y a du pain sur la planche et quitter le navire en ce moment pourrait s’apparenter à de la lâcheté : Legault « sauverait » ainsi son honneur, avant de descendre encore plus dans les sondages et subir une cuisante défaite lors des prochaines élections. À moins qu’il ait compris que, pour avoir une chance de préserver son legs principal (la CAQ elle-même), il fallait qu’il débarque. Après tout, que retiendrait l’Histoire si, après lui, la CAQ disparaissait ? Après tout, elle se positionne à l’heure actuelle en quatrième position dans les sondages, à égalité avec Québec Solidaire, qui risque, lui aussi, de disparaitre de l’échiquier politique québécois. La démission du fondateur de la CAQ constituerait alors un geste désespéré face à un risque existentiel pour son bébé ; ne façon de rester dans les livres d’histoire.
Cependant, le mal est fait, si je puis dire, parce que les deux mandats de Legault ont confirmé et influencé une tendance sociétale et politique lourde : un coup de barre à droite. Moins de compassion, plus de fermeture et de suspicion ; plus d’entreprises, moins de service public ; moins d’interculturalisme, plus de nationalisme. Regardez le paysage politique québécois, canadien, même dans les pays du nord global. Nous sommes entrés pour de bon dans une nouvelle ère.
Je m’explique… Dans la foulée de la Révolution tranquille, la culture a servi de ciment, elle a permis la consolidation de la société québécoise autour de valeurs progressistes : ouverture, sécurité (psychologique), féminisme et solidarité. Les fleurons québécois qu’ont été le système de santé et celui d’éducation sont aujourd’hui exténués ; ils ont été dévêtus de leur compassion initiale pour « faire du chiffre », être « efficaces », tout en restant en état d’alerte permanent. Le sentiment d’échec prévaut et l’on se cherche des boucs émissaires : les autres, ceux qui ne sont pas de chez nous. La bonne nouvelle ? De ces situations de crise ressortent en général de belles personnalités, prêtes à prendre à bras-le-corps les problèmes, avec courage et lucidité. Alors, qui sera le-la prochain-e ?
Investir Spéculer en bourse
Didier Périès
Quand j’ai vu la statistique, je suis resté bouche bée : 16 000 millionnaires devraient s’ajouter aux centaines de milliardaires et de millionnaires que notre planète abrite déjà, avec l’entrée en bourse des entreprises d’intelligence artificielle open AI, SpaceX et Anthropic. Et relancer les marchés financiers. Comme s’ils avaient périclité historiquement!
De l’avis des spécialistes, 2026 sera l’année des méga-introductions (en bourse). On parle-là de record de capitalisation, à des années-lumière de nos petits revenus de citoyens lambda : Anthropic discute d’un financement de 350 milliards de dollars américains, alors qu’Open AI vaut déjà 500 milliards et SpaceX a été réévaluée à 800 milliards ! Et les investisseurs seraient au rendez-vous !
Vous, moi, qui au juste ? Alors que nos systèmes de santé et d’éducation sont en crise, que nos gouvernements nous assènent à tout bout de champ qu’il n’y a pas d’argent et que nos gouvernements sont en déficit de quelques dizaines de milliards de dollars canadiens. Ces « big data companies » ne font même pas encore de bénéfices. Les gens qui comptent mettre de l’argent là-dedans, peut-être vous, espèrent que les profits commenceront à rentrer d’ici 2030 ou 2035. En attendant, elles ont besoin d’argent, parce qu’elles ne font qu’en perdre. Alors, investissement ou spéculation ?
Seule certitude à court terme : Wall Street et la Silicon Valley vont s’enrichir. Vous remarquez ? Pas de noms de personnes. Et pour une bonne raison : dans la vie réelle, et non virtuelle, celle de notre quotidien, on n’en verra que les conséquences, soit la disparition d’emplois remplacés par l’IA et plus de pollution engendrée par la multiplication des centres de données. Ce sont en fait les banques et de gros investisseurs (des entreprises, des ultrariches) qui vont en bénéficier.
Pour certains, rendre publiques ces entreprises réduira la spéculation fondée sur l’ignorance de ce qu’elles sont et font. On aurait enfin des chiffres ! Et alors ? Qu’est-ce qui changera, quand on sait que prendre une décision d’achat en bourse prend six minutes en moyenne ? N’écoutez pas les « coachs » qui vous servent leurs 17 conseils pour démystifier la bourse et « multiplier » votre argent. Même s’ils semblent rassurants, parce qu’ils avertissent contre toute décision sous le coup de l’émotion, qu’ils vous disent que cela se joue à long terme, qu’il faut être patient, qu’avec de bonnes stratégies, comme la diversification, cela fonctionne automatiquement, tout cela repose sur de la spéculation, c’est-à-dire deviner ce qui va décoller pour de vrai, donc sur du vent !
On oublie que l’économie, c’est littéralement « l’administration de la maison », « l’art de gérer les ressources […] un capital ou un revenu » (Dictionnaire de l’Académie française). Quand vous rencontrerez — ou pas — votre conseiller financier pour réviser votre profil d’investisseur, faire un peu plus d’argent, vous payer un séjour dans le sud l’année prochaine, rappelez-vous que donner de l’argent à ces grandes entreprises de l’IA qui gonflent artificiellement les marchés financiers, non seulement ne contribuera en rien à régler nos ennuis réels (inflation, crise du logement, santé, éducation, etc.), mais en plus, va contribuer à aggraver la crise climatique. Une crise qui a déjà couté 5 milliards de dollars en 2025 au Canada. D’après vous, avec quel argent les assurances font-elles face aux inondations, aux feux de forêt ou aux canicules ? Qui paye les taxes pour les mesures d’« adaptation » climatique ?
Le « pragmatisme vert » nord-américain
Didier Périès
Donald Trump, PSPP, Charles Milliard, Pierre Poilièvre, Bernard Drainville, Christine Fréchette et Mark Carney ont tous un point commun — pas celui que vous croyez : ils alimentent un écran de fumée qui cache un ennemi bien pire. Que l’on nomme leur attitude hypocrisie climatique, climatoscepticisme, écoblanchiment, ou déni climatique, elle mène dans tous les cas à une inaction gravissime.
Alors que nous serions en droit d’attendre plus d’action pour le climat, le plus ahurissant est que nous regrettons presque les deux mandats de Trudeau (dont un majoritaire), où lui-même a fait deux pas en avant pour un pas en arrière ! Vous me direz, la pandémie est passée par là, et Trump aussi, plutôt deux fois qu’une ; vous insisterez sur le nécessaire pragmatisme (« On ne peut pas tout faire en même temps, s’occuper de l’économie et de l’écologie »), ou pire vous affirmerez votre « pragmatisme vert », à la Drainville, proche de celui de Carney, qui parle d’exploiter davantage « toutes les ressources naturelles » dans ses « projets d’intérêt national », comme si nous étions dupes de l’amalgame qu’il fait entre énergies renouvelables et propres et les énergies tirées des hydrocarbures ultrapolluantes.
Mais, sachez-le, dans le nord global et à l’échelle planétaire, où les investissements verts battent des records, nous sommes bien les seuls à en avoir si peu fait. Et cela constitue en soi un recul. Au Québec, repousser la cible de 37,5 % de réduction des GES à 2035, au nom d’une « approche équilibrée et responsable » (encore Drainville), est criminel, parce que, pour certains esprits obtus et peu informés, l’environnement ne créerait pas d’emploi ! C’est faux et un très mauvais message envoyé aux acteurs sociaux et économiques : si le gouvernement le fait, alors chacun peut le suivre dans cette voie sans issue. Nos émissions ont seulement reculé de 20 % jusqu’à maintenant. Pour mémoire, l’objectif est 100 % en 2050 !
Et les tarifs étatsuniens ont bon dos ! D’accord, il y a de l’incertitude économique, mais pas à tous les niveaux : le prix des aliments va continuer d’augmenter, comme les primes d’assurance ; les conflits dus à des migrations climatiques vont être plus fréquents ; nous allons assister à la disparition des coraux, à la dégradation irréversible des forêts tropicales, à la fonte définitive du pergélisol et des glaciers, à l’extinction de milliers d’espèces animales. Tout cela est en train de nous revenir au visage comme un boomerang. Sont-ce vraiment les conditions de vie que nous voulons pour nos enfants et petits-enfants ?
Se loger, se déplacer, se nourrir, occuper le territoire différemment, autant de domaines d’action qui ne peuvent pas relever seulement de l’initiative individuelle. L’état doit impérativement susciter et accompagner ces transformations essentielles à la vie sur Terre. Le manque d’ambition climatique de nos deux paliers de gouvernement est un terreau fertile pour un certain découragement : à quoi bon se battre finalement ?
Le Québec a la chance d’avoir une énergie hydro-électrique abondante et peu chère, mais c’est insuffisant dans le contexte actuel ; se comparer aux États-Unis n’est pas honnête, c’est un cancre climatique. Le leadership voudrait que l’on regarde plutôt les premiers de classe… ou que l’on développe nos propres solutions, tant sur le plan du transport collectif que de l’urbanisation ou de l’électrification du parc automobile. Nous semblons pourtant, et tristement, aller dans la direction opposée.
Éditoriaux de 2025
De l’eau dans le gaz
Didier Périès
Samedi dernier, les trente joueurs du Stade toulousain (moyenne d’âge : 22 ans) ont tenu tête pendant 80 minutes à La Rochelle ; il a fallu le coup de pied de pénalité de leur botteur pour que ces derniers vainquent à la dernière seconde. Le Stade, première au classement du championnat de rugby à 15 français — l’équivalent de la LNH — n’avait en fait aligné quasiment aucun de ces titulaires. Pourquoi ? Parce que cette équipe-phare du rugby, cette machine de guerre, partait le lendemain disputer un match de coupe d’Europe… en Afrique du Sud.
Et oui, vous avez bien lu ! On pourrait s’étonner, à cause du non-sens géographique, voire s’offusquer des coûts financiers et écologiques d’une telle virée.
Ce serait un peu comme si deux équipes de la LNH, au hasard : les Sharks de San Jose et les Predators de Nashville, ou l’Avalanche du Colorado et les Blue Jackets de Colombus, jouaient en Suède ou en Finlande, vous voyez ? Or, le plus étonnant, est que tout le monde semble trouver cela normal… Vous me direz : on joue bien des coupes du monde de soccer en plein désert, dans des pays dont la culture du football (soccer) date de moins de 20 ans.
En fait, mis à part les aspects culturel et sportif, certes importants, mais secondaires au regard de la crise climatique actuelle, et si on ajoute à ces déplacements, ceux que toutes ces équipes, surtout nord-américaines, font chaque semaine, alors le constat est effarant ! 13,44 tonnes de CO2 par personne, juste pour la saison 2023-2024 du Canadien. Le ou la Québécoise moyen-ne produit 0,9 tonne par an. Alors, oui, la LNH rachète des crédits carbones, mais elle pollue quand même ; d’ailleurs, seuls les riches peuvent se permettre cela.
On nous tance régulièrement, nous, pauvres mortels, sur nos déplacements en avion, nos vacances, mais il faut surtout remettre en cause les pratiques, tant des compagnies de transport que des ligues de sport. Le transport est la seconde plus grande cause d’émissions de GES (après l’industrie des énergies fossiles), mais il n’y a pas que le transport de marchandises. La preuve ! Multipliez le cas de la LNH ou de la Première ligue de rugby française par le nombre de sports et de fédérations partout autour du monde : c’est une aberration !
Évidemment, il y a une contradiction plus profonde, plus essentielle, à vouloir une croissance de la consommation infinie, y compris de voyages, sans conséquences. Déni ? Hypocrisie ? Bêtise ? Chose certaine, il existe une tabou quand il s’agit de critiquer les déplacements de nos chers héros sur la glace ou sur un terrain synthétique. Et, dans ces conditions, on ne voit pas comment ces secteurs de l’économie pourraient réduire leurs émissions aussi drastiquement que nécessaire, de 10 % à 30 % de leur volume actuel…
Faut-il systématiquement taper sur le consommateur de base, vous, moi, en lui faisant comprendre que moins peut être mieux ?
Individuellement, nous produisons déjà en ce moment en moyenne 1,79 tonne de CO2, soit presque la limite de 2 tonnes qui est la limite maximale de l’ONU pour éviter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius. Que reste-t-il ? Doit-on compter sur des avancées technologiques, elles-mêmes gourmandes en matières premières non renouvelables et productrices de pollution ? La réponse est dans la question.
La paix ou la guerre
Didier Périès
Comment cela a-t-il commencé ? Par la paix ou la guerre ? Ces premiers Homo erectus, nos ancêtres, comment leurs premiers contacts se sont-ils déroulés, alors que leurs têtes émergeaient pour la première fois au-dessus des herbes hautes de la savane ?
Je me pose la question en m’endormant dans l’avion qui me transporte du Canada vers la France, quelques jours avant Noël. L’esprit de fête et de réconciliation qui m’habite en ces temps de polarisation, de radicalisation et de conflits de plus en plus nombreux à l’échelle de la planète est un peu incongru. Je me surprends moi-même à souhaiter la paix sur Terre, pour nous pauvres humains, ô nous frères humains qui passons notre temps à nous déchirer en famille, à nous méfier des Autres ou à partir en guerre pour un oui ou pour un non avec nos voisins.
Est-ce à ce point inscrit dans nos gènes ou bien n’y a-t-il là aucune fatalité ? Peut-on garder l’espoir d’une amélioration, d’un progrès, un jour prochain ? Et à quelles conditions ? Parce qu’il faut d’abord en convenir, avec les chercheurs en neurosciences : notre cerveau n’est pas vraiment différent de celui de nos ancêtres préhistoriques — des centaines de milliers d’années sont nécessaires à l’évolution d’une espèce avant d’être observable ! Nous qui croyions les australopithèques et autres Cro-Magnon tellement plus violents et barbares que nous en prendrions pour notre rhume si l’on savait…
L’illusion d’être « plus avancés », « plus développés », bref meilleurs, vient surtout d’un manque de lucidité (ou bien d’un aveuglement volontaire) sur nos conditions de vie, sur la sophistication de nos outils et notre emprise sur notre environnement, qui ont fait un bond inimaginable, ne serait qu’aux humains de l’Antiquité. Nul besoin d’une grande imagination pour se le figurer, il suffit de regarder autour de nous… Malheureusement. D’abord, parce que ce « progrès » semble s’accélérer en même temps que la dégradation de notre planète — on pourrait dire, pour rester dans la référence préhistorique, que nous scions la branche sur laquelle nous nous trouvons — ; ensuite, parce qu’il faut vraiment réfléchir pour trouver un quelconque progrès moral dans notre évolution.
L’invention de la religion et des états ? La création d’un gouvernement mondial ? Le multilatéralisme et la solidarité internationale ? Une éducation à l’esprit critique, à l’humanisme et à la conscience citoyenne ? Des sociétés policées sans policiers pour vérifier l’application des lois, sans militaires pour protéger les frontières, parce qu’il n’y a de frontière que dans nos têtes ? La liberté des peuples à disposer d’eux-mêmes ? Un ventre plein, une soif apaisée, un toit au-dessus de la tête pour tous ? Un peu de respect et tout simplement de gentillesse entre nous (ce qui n’est pas incompatible avec de la fermeté parfois), est-ce trop demander ? À commencer au sein des familles, dans les fratries, entre parents et enfants… J’en oublie évidemment. On peut rester sceptique. Les choses sont-elles si mal embouchées et notre avenir hypothéqué ?
Pour conduire à une meilleure vie, je ne vois personnellement qu’un pessimisme joyeux ou un gai désespoir assumé, si vous préférez ; un stoïcisme de bon aloi, qui accepte de faire le bien autour de soi, loin de la peur et de l’égoïsme qui nous paralysent ou font honte à notre humanité. C’est ce que je vous souhaite pour 2025.
Morts de rire
Didier Périès
Je lisais la semaine dernière, dans le courriel des lecteurs, la « défense et illustration » du Bulletin, et plus globalement des publications régionales, par monsieur Loyd. Coïncidence intéressante, je suis en train d’étudier avec mes élèves de 11e année, tout au long du mois de janvier, le journalisme : sa définition, ses acteurs, ses enjeux ; autour de la question suivante : le journalisme n’est-il qu’un fait culturel, historique et contingent destiné à disparaitre ? Et cela, en invitant l’un de mes anciens élèves, journaliste au Nunavut pour le Nunatsiaq News, ainsi que le caricaturiste de presse du Droit, Guy Badeaux, alias Bado.
Fait remarquable, partout sur la planète ce mois-ci, disons, particulièrement dans les démocraties du nord global, nous commémorons les 10 ans des attentats de Charlie Hebdo. Pour mémoire, le 7 janvier 2005, deux hommes entrent dans les locaux parisiens de l’hebdomadaire satirique français, armés de fusils d’assaut. Ils assassineront au total 12 personnes, parmi lesquelles 8 membres de la rédaction, journalistes ou dessinateurs. Ils arrivent à s’enfuir avant que la police ne les retrouve deux jours plus tard. Ils se réclamaient d’Al-Qaida dans la péninsule arabique. L’un de leurs complices tuera dans les jours qui suivent une policière et quatre Français juifs dans une petite épicerie casher. Je n’égrènerai pas la longue liste des attentats et des morts qui sont survenus dans la dernière décennie, juste en France.
Il faut simplement se rappeler que la France a été visée pour des raisons générales, qui concernent la plupart des pays du nord global face à l’islam radical, mais également plus spécifiques : elle est le berceau de la presse (dès la fin du XVIIe siècle, avec les premières gazettes), du journalisme professionnel et de la laïcité. Surtout, elle est la patrie des droits de l’homme, parmi lesquels la liberté de presse — garantie dés 1789, mais mise à mal par la censure officielle jusqu’au XXe siècle — qui découle de la liberté d’expression, qui elle-même repose sur la liberté de conscience. Leur corollaire, le droit à l’information, est fondamental dans une démocratie et toute entrave ou attaque envers ses chiens de garde q (les journalistes) — suivez mon regard vers un certain parti conservateur — est une attaque à la démocratie elle-même. Des journalistes meurent chaque année dans l’exercice de cette noble mission!
Dans un contexte de (extrême) droitisation du spectre politique aujourd’hui, je vous recommande de bien réfléchir à ce que cette attitude nous révèle sur nos prétendants aux postes électifs… En tout cas, admettons qu’il y a plusieurs manières de faire passer l’information, de sensibiliser les citoyens aux enjeux de notre époque, et bien l’humour n’en fait-il pas partie ? Les caricaturistes de presse, les émissions et les journaux satiriques sont là pour ça. Non seulement sont-ils en voie de disparition, mais l’on peut aussi se demander où est passée la capacité de notre société à rire, à comprendre l’humour ? Nous considérons comme une blague les propos sérieux d’un pervers narcissique arrivé au plus sommet de l’état américain, mais détournons le regard et censurons des caricatures qui se moquent des superstitions ou des agissements absurdes des grands de ce monde ! Nous ne sommes plus capables de distinguer le vrai du faux, l’intention mesquine et l’intimidation au service d’intérêts personnels du dessin ou de la réplique moqueuse visant à nous conscientiser.
MAGAFAM
Didier Périès
Je vous le dis franchement : je suis à deux clics de me désabonner de Facebook. Vu ce qu’est devenu Twitter/X à la suite de son rachat par Elon Musk — à savoir un réservoir d’informations toxiques sous couvert de liberté d’expression — la plateforme de Mark Zuckerberg, désormais sans contrôle ni modération, depuis le 8 janvier, sera inexorablement envahie par les troupes de trolls et de goules de l’extrême droite… pardon, de la droite « alternative ».
En effet, les « fact checkers » et autres médias professionnels ne sont pas assez nombreux et incapables, du fait même de la nature de leur travail, de rivaliser avec les messages de haine et désinformation générés par des robots conversationnels (baptisés à tort « intelligence artificielle »), qui publient des messages au mégaoctet. Les faits publiés par ce que les complotistes nomment les « merdias » sont noyés sous des tonnes de… merde venant de ces faux comptes ou de ces propagandistes, dont le seul but est de semer le doute, diviser l’opinion publique et déstabiliser nos démocraties.
Science feedback a conclu de l’étude de 8 autres médias de vérification des faits, comme lui, que 490 super-propagateurs de désinformation (dont 329 en anglais) ont généré une augmentation de 42 % de l’« engagement » (nombre de fois qu’un gazouillis est aimé, commenté ou partagé) des utilisateurs depuis 2022, année du rachat par Musk. La moitié d’entre eux seulement sont les moteurs de cette croissance, parmi lesquels des gens comme Robert Francis Kennedy Jr., antivaccin notoire et désormais secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, et Liz Wheeler, grande promotrice de l’idée que les élections de 2021 ont été truquées, entre autres. Les climatosceptiques (voire négationnistes) sont aussi bien représentés, autour du mot-clic de l’« arnaque climatique ». Ne soyez pas étonné-e, ce sont les mêmes qui trouvent une justification à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.
Dans le même temps, Amazon fermait tous ces centres au Québec afin de « retourner vers un modèle de livraison par de tierces parties supportées par des petites entreprises locales », donc prenait une sorte de décision opérationnelle logique, qu’il n’applique plus et nulle part ailleurs ! Une simple coïncidence ou une réponse à la syndicalisation de l’entrepôt de Laval ? Résultat : 3000 emplois directs ou indirects disparus, même si les activités continuent, ce qui signifie « faire de l’argent » !
Bref, qu’elles opèrent dans la technologie (Apple,), les médias (Tik Tok, Méta, X…), la finance (les cryptomonnaies, notamment), les industries fossiles, ou d’autres domaines (Amazon, Alphabet, Uber), ces entreprises multinationales, notamment américaines, ne répondent à personne d’autre qu’à leur dirigeant (tous des hommes blancs milliardaires d’ailleurs) et à leurs actionnaires.
Leurs dirigeants se trouvaient derrière Donal Trump lors de sa cérémonie d’investiture, le 20 janvier dernier. Plusieurs d’entre eux ont des fonctions officielles ou sont conseillers auprès de son gouvernement, lequel a renforcé une véritable internationale des démocratures en invitant Milei (Argentine), Meloni (Italie), Orban (Hongrie), Noboa (Salvador) et bien des dirigeants des partis d’extrême droite européens.
Ces GAFAM sont désormais en collusion totale avec le pouvoir politique à Washington, en accourant à l’annonce des décrets de l’oligarque de 78 ans visant en particulier plus de dérèglementation et moins d’impôt — ce qui devrait augmenter leurs bénéfices. Et le simple citoyen qui a voté naïvement pour Trump en voyant en lui un « homme du peuple » ? Il n’en verra jamais la couleur.
L’incertitude
Didier Périès
Je crois que c’est le mot de ce début d’année 2025 ; on le retrouve partout, dans les médias, dans les conversations, dans les discours de nos politiciens ou de nos entrepreneurs. Revenons un petit peu à la base : ce mot désigne plusieurs concepts liés à l’imprécision et à l’indétermination, à des évènements dont « la nature est imprévisible » (Robert).
Par exemple, l’incertitude de notre avenir en tant qu’individu, en tant qu’être vivant, peut nous préoccuper, ce souci est tout à fait légitime. Pourtant, notre avenir est clair, n’est-ce pas ? Que nous soyons riches ou pauvres, petits ou grands, l’issue de notre existence est fatale et inévitable : à moins de croire dans un « après-la-vie », nous mourrons tous un jour. Ce n’est pas comme si nous avions le choix, ou plutôt seulement le choix du moment et la manière, et là encore…
En revanche, si par incertitude, on réfère à l’indécision, lors de choix difficiles, par exemple, alors on parle d’autre chose. Le plus souvent, nous avons l’impression de ne pas avoir le choix, de subir les décisions des autres, mais 1) nous avons fon-da-men-ta-le-ment le choix, cela se nomme libre arbitre 2) plusieurs des situations desquelles nous sommes les « victimes » sont le résultat de nos actions, nous en sommes imputables. Au pire, on parlera même de choix « cornélien », pour exprimer l’impossibilité de choisir, comme Chimène, dans Le Cid de Corneille, entre son amour et son honneur, parce qu’elle perd quelque chose d’essentiel à son bonheur dans les deux cas, soit son père, soit son amoureux.
Il faut avouer néanmoins que la peur peut prendre le dessus ; en effet, le concept d’incertitude implique également la notion d’erreur (en mathématiques, il s’agit de la marge d’erreur potentielle d’une valeur mesurée). Différemment, en physique, le « principe d’incertitude » d’Heisenberg affirme que l’on ne peut pas connaitre à la fois la vitesse et la position d’une particule. Donc, c’est une sorte de certitude de l’incertitude ! Mais bref, cet entre-deux qu’est la véritable incertitude peut causer la peur, voire l’angoisse totale et, en bout de ligne, le déni, qui nous poussent à la paralysie existentielle ou à la fuite en avant. Ainsi, par rapport à la crise climatique : il n’y a pas de véritable incertitude, mais bel et bien un doute sur notre capacité à y répondre, en agissant adéquatement, en votant pour les bonnes personnes, en étant nous-mêmes des acteurs du changement et de la lutte.
Il est aussi beaucoup question d’incertitude à propos de Trump et de ces agissements. Étonnant, quand on comprend qu’il est au fond, dans le corps d’un homme blanc de 70 ans, un enfant apeuré, qui humilie, intimide et harcèle d’autant plus qu’il se hait lui-même. Ces paroles et actions sont hautement prévisibles, je vous le garantis !
Si l’on va plus loin, l’Académie française définit l’incertitude comme le « caractère de ce qui n’est pas d’une nature bien arrêtée… ». Et c’est un truisme de dire qu’il faut se méfier de nos certitudes… En même temps, peut-on douter de tout ? Descartes a déjà répondu : on peut douter de tout, sauf du doute lui-même, c’est le fondement de son « cogito ergo sum » ! À partir de ces prémices, quelle conclusion ? Méfiez-vous, informez-vous, cherchez les preuves et gardez la tête sur les épaules. A-t-on vraiment le choix ? Pas certain.
Avez-vous regardé le Superbowl ?
Didier Périès
Quelle réaction remarquable, forte et rapide des citoyens canadiens, depuis que la perspective de subir le contrecoup des « tarifs » américains s’est précisée et que l’échéance promise par le président Trump a été atteinte. Une indignation à l’échelle du pays, rassembleuse, citoyenne, non-partisane ; une sorte de réveil national ! Les appels au boycottage des produits américains et à l’annulation des voyages chez nos voisins du sud se sont multipliés en un temps record. Vraiment, cette capacité à s’indigner et à être prêt-e à agir pour marquer notre désaccord m’a éblouie ! Peut-être n’est-elle que symbolique — ces grandes compagnies font un chiffre d’affaires souvent faramineux hors du Canada de toute façon — mais se voir ostraciser par l’un des rares voisins dont les États-Unis disposent pourrait avoir un impact, allez savoir… Et ça fait du bien au moral, d’agir, de prendre son destin en main, de ne pas rester une victime sans défense.
Ceci étant dit, embarquerions-nous dans cette guerre d’usure avec le gros blond à la chaussure noire, quelques questions méritent d’être posées : d’abord, quels produits peut-on nous permettre d’éviter ? Ensuite, devrait-on également ignorer superbement les magasins, les chaines américaines, qui emploient tout de même des employés québécois et canadiens et utilisent des fournisseurs d’ici ? Et que dire du secteur de la culture ?
D’abord, il est clair (et plus facile) de ne pas acheter bon nombre de marchandises américaines dans les supermarchés et les boutiques, en particulier lorsqu’ils sont remplaçables par des biens québécois : boissons gazeuses, savons, ketchup, sauces piquantes, jus, nourriture pour animaux, cosmétiques, soupes, pizzas congelées, biscuits, bonbons acidulés, fromage à la crème, c’est possible. Pour le reste, parfois, les certifications d’origine comme « Producteurs laitiers du Canada » sont fiables… ou pas. La viande, par exemple : pas d’obligation d’indiquer la provenance si elle est importée (mais transformée et emballée ici). Nous avons de la chance au Québec avec nos porcs, notre agneau ou notre veau, mais il y a une nette différence entre « Produit du Canada » (98 % d’ingrédients canadiens) et « Fabriqué au Canada » (au moins 51 %) !
Cependant, dans le domaine de l’électronique et des médias, serons-nous capables de nous sevrer d’Apple, Netflix, X, Méta ou Amazon ? Leurs propriétaires sont pourtant parmi les principaux bailleurs de fonds de Trump et ont montré toute leur allégeance ces dernières semaines. De plus, les chaines, comme Walmart, Starbucks, Costco, etc., avec leur modèle d’affaire et de consommation ineptes, sont très populaires et emploient des milliers de personnes, partout au pays. Sommes-nous prêts à payer le prix fort ?
Les experts universitaires l’affirment : le boycottage est d’autant plus efficace et envoie un message plus réel s’il touche de grandes marques symboliques ; ne plus voyager dans le pays a aussi des impacts notables. Quant à infléchir la politique d’un pays, cela reste à voir. Nous sommes finalement devant le mur tarifaire comme nous le sommes devant le mur climatique, à une (grosse) différence près : au fond, nous pouvons mettre en pause notre course effrénée à la consommation pendant quelques semaines, la chance existe même que nous ne le frappions pas. Et dans le cas des taxes états-uniennes sur les produits importés, la vitesse à laquelle nous rentrerons dans le mur dépend en bonne partie de nous, beaucoup plus que de la volonté d’un seul homme.
Un cordon difficile à couper
Didier Périès
Il aura fallu quelque trois mois pour accoucher, et un mois de plus pour couper le cordon ombilical. Le Parti conservateur du Canada (PCC) nous est arrivé avec les tempêtes hivernales, ces derniers jours, aussi frais, émaciés et glaçants qu’une armée de marcheurs blancs. Il lui a fallu en effet tout ce temps pour se positionner, trouver ses marques, se détacher de la figure maternelle, dans ce cas-ci très patriarcale, de Donal Trump.
Jouer avec les marges les plus extrêmes de son parti, surfer sur la vague anti-élite et les théories du complot, tout en attaquant les individus au lieu de proposer des idées : la recette a fait long feu. Il est vrai que l’ajournement des travaux du parlement a supprimé la principale chambre d’écho dont usait Pierre Poilièvre. Il fallait donc trouver autre chose.
Heureusement arriva le président Trump ! avec ses habituelles saillies humiliantes, ses idées (apparemment) farfelues, mais surtout avec une mégalomanie désormais sans limite. Au point de poignarder son « ami » de toujours, son allié indéfectible, le Canada, à coup de taxes douanières iniques ; au point d’envisager son assimilation, comme cinquante-et-unième état de l’Union.
L’on voit maintenant Poilièvre vouloir se transformer en Captain Canada — comme Clark Kent, il a profité d’une cabine de toilettes pour revêtir ses plus beaux atours, blancs et rouges — en quelques secondes, avant de voler au secours de notre patrie et de notre drapeau. Et oui ! Sa mission est en fait de protéger le Canada, il avait bien caché son jeu ! Prenant exemple sur le premier ministre Ford (« Protéger l’Ontario »), en fin de semaine dernière, il a profité opportunément des célébrations de la Journée du drapeau canadien et a dévoilé son slogan pour la campagne électorale qui arrive : « Le Canada d’abord ». C’est tellement impressionnant et profond !
Rappelons-nous que c’est le résultat du remue-méninges de plusieurs des stratèges du PCC pendant plusieurs semaines ! Dès lors, doit-on s’attendre à une nouvelle stratégie, qui proposerait, par exemple, des actions, des solutions aux grands enjeux de notre temps ? Certainement ! Au lieu de s’attaquer à Trudeau, de mentir sur les politiques et les idées de leur rival, les conservateurs vont désormais s’attaquer aux deux plus gros candidats à la course à la chefferie du Parti libéral du Canada, Chrystia Freeland et Mark Carney, et surtout à ce dernier, avec les mêmes tactiques, soit l’insulte et le mensonge. Cela n’a d’ailleurs pas tardé la semaine dernière…
Donc au diable la « taxe carbone » et les coupures dans la fonction fédérale ? Difficile de répondre : le programme du PCC n’est pas sur son site web, à peine a-t-on une profession de foi, en quelques expressions générales passe-partout, tous partis confondus : un parti « fondé sur les principes de paix et de liberté » ; de « gestion responsable » ; d’« ouverture aux personnes persécutées » ; de « défense des technologies canadiennes propres [SIC !] » et pour un « partage clair des responsabilités entre les paliers gouvernementaux ». Personne ne peut être contre la vertu, mais au-delà des mots, s’il s’agit en fait de briser systématiquement ce que les gouvernements précédents ont fait et de profiter de la peur ambiante, au lieu d’avoir des propositions concrètes, positives, honnêtes et éclairées, alors pourquoi Pierre Poilièvre et ses troupes ne retourneraient pas dans les jupes de papa Trump, de l’autre côté de la frontière ?
Veut-on vraiment de la démocratie ? (1)
Didier Périès
Cela m’a frappé la semaine dernière, en lisant un article à propos du documentaire Les perdants de la réalisatrice Jenny Cartwright. Le reportage s’intéresse à ces partis ultra-marginaux que sont le Parti Nul, le Parti culinaire du Québec ou le Ministère de la Nouvelle Normalité ; j’aurais pu y ajouter le Parti Rhinocéros… Si, à première vue, dans notre système électoral, les perdants sont ces partis-là, c’est en vérité plutôt nous, vous, moi, les citoyens, car nous finissons immanquablement par nous retrouver dans la même situation, à la fin de chaque élection : le parti « gagnant » obtient une majorité des sièges et des remboursements électoraux alors qu’il a été élu avec une minorité des voix (encore pire si l’on compile les abstentions, les votes blancs ou nuls. Par exemple, la CAQ a touché 40% de ces fonds, alors qu’elle a été élue avec 25% des voix en 2018 ; il en de même avec le Parti libéral du Canada qui a pourtant reçu moins de 30% du total des voix en 2021. Une chose est claire : le système uninominal à un tour a montré toutes ses limites, changeons-en !
Pour sortir de l’anecdote et retourner aux idées, souvenons-nous que notre démocratie, héritage de l’Antiquité gréco-romaine, est une forme de démocratie représentative qui se caractérise par la protection des libertés individuelles, des élections justes et libres, la séparation des pouvoirs, la primauté du droit, le suffrage universel et une constitution.
Au Canada, au Québec, à Gatineau, malgré les débats et les ratés évidents – quel régime est parfait ? -, on peut admettre que, globalement, les droits humains et les libertés civiles sont protégés ; nos représentants sont élus lors d'élections régulières, transparentes et concurrentielles entre plusieurs partis politiques ; il existe une séparation claire entre les différentes branches du gouvernement (exécutif, législatif et judiciaire) ; les décisions gouvernementales sont conformes aux lois établies et l'autorité gouvernementale ne s'exerce légitimement que dans le cadre de ces lois ; tous les citoyens adultes ont le droit de vote, sans distinction de race, de sexe ou de statut économique et notre système politique repose sur une constitution qui définit les pouvoirs de l'État et protège les droits des individus.
Or, aujourd’hui, cette forme de régime démocratique est sérieusement mise à mal par un courant de droite illibéral, qui conduit à des démocratures dans plusieurs pays. Cette tendance se nourrit d’une certain désillusion chez des citoyens devenus parfois de simples consommateurs, guère plus. Les limites de ce gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple est ont-elles été atteintes ? Peut-on enrayer le mouvement qui est en train de nous mener tout droit vers une forme de gouvernement plus autoritaire, plus identitaire et moins soucieuse des droits et libertés fondamentales ?
Pour pouvoir répondre à ces questions, il faut aller dans les détails et analyser plus clairement ce qu’il se passe. Ainsi pourrons-nous envisager les réponses à y apporter… N’est-ce donc pas le moment de mettre ce sujet à l’ordre du jour, alors que nous approchons des élections fédérales et que les grandes démocraties dans les pays du Nord global sont en crise et parfois remises en cause dans leur existence même ? Mais voulons-nous vraiment sauver notre modèle de démocratie ?
Veut-on vraiment de la démocratie ? (2)
Didier Périès
Ouf ! Les électeurs ontariens ont voté… enfin, 44 % des inscrits sur les listes électorales. Et les 150 millions de dollars publics dépensés par Doug Ford lui ont permis de gagner… 1 siège de plus, avec 43 % de ces 44 % ; d’où sa majorité relative, qu’il qualifie de « forte », parce qu’elle lui permet de régner seul. Le premier ministre de l’Ontario représente en fait 2 200 000 citoyens sur les 11 000 000 d’électeurs inscrits. Ce manque de représentativité s’applique à tous les paliers de gouvernement, bienvenue au Canada !
La semaine dernière, je donnais un aperçu de ce qu’est une démocratie, dans ses grands principes, même sous sa forme la plus imparfaite. Il faut admettre qu’aujourd’hui, si l’on gratte un peu, si l’on observe de près son fonctionnement, ce système connait de graves problèmes, une forme d’usure ou d’érosion très préoccupante, et cela dans deux domaines au moins, en plus du manque de représentativité du scrutin nominal à un tour duquel je parlais au début de cet éditorial.
Ainsi, la démocratie moderne se définit notamment par la séparation des pouvoirs (exécutif, législatif, judiciaire), auxquels s’ajoute la libre circulation des idées et de l’information. Les journaux, qui sont nés dans le sillage des Lumières en Europe au XVIIIe siècle, avec une certaine idée de la démocratie libérale, sont un contrepoids, un quatrième pouvoir indissociable des trois autres ; ils illustrent la libre circulation des idées, le droit d’être informé et la liberté d’expression. Dès lors, comment peut-on laisser nos gouvernements empêcher le public ou la presse d’obtenir des renseignements qui ne relèvent pas de la sécurité nationale, en caviardant les documents à l’excès, en ne répondant pas aux demandes d’accès à l’information ? Comment certains des chefs de parti peuvent-ils systématiquement refuser des entrevues, discréditer les journalistes, proposer de définancer les services publics (Radio-Canada est une société d’État, mais pas une agence gouvernementale !) ?
« Quand on veut noyer son chien, on l’accuse d’avoir la rage », affirme le dicton. Pourquoi accuser tel ou tel gouvernement de « briser » (vive les hyperboles et les mensonges !) le Canada, alors qu’à l’évidence, ce n’est pas vrai ? Comment, la seconde d’après, pouvoir se déclarer honnêtement le seul à pouvoir protéger le pays, avec la même exagération, sans aucune nuance ? La réponse à ces deux questions est la même : le calcul politique, le cynisme, la soif du pouvoir à tout prix. Ce sont également des ingrédients du populisme, qui souffle sur les braises de la peur (conduisant à la colère, voire à la haine) ; qui se tourne dans le même sens que le vent tourne ou qui flatte les électeurs dans le sens du poil, quitte à exploiter leurs pires instincts.
Quand on commence à insulter les candidats adverses de ce dont est accusé soi-même : « toi, tu es un menteur, tu es un dictateur ! », ou les médias d’être « antidémocratiques » (SIC Poilièvre !), vous au lieu de s’attaquer aux actions, ou que l’on change les faits, la réalité pour des raisons électoralistes, non seulement c’est de la diffamation, mais cela ne fait qu’ajouter à la fameuse polarisation dont on parle si souvent. Jeter de l’huile sur le feu, voilà le jeu des populistes, de droite comme de gauche. Cela nous amène sur le terrain de la grande désillusion démocratique, qui pave la voie à la dictature.
Le changement dans la continuité
Didier Périès
C’est une page qui se tourne dans notre existence de citoyens canadiens et donc dans notre quotidien, même si certains ont l’impression — à tort — que les politiques et programmes fédéraux ne l’influencent pas vraiment. Dimanche dernier, les militants du Parti libéral du Canada ont officialisé le départ de Justin Trudeau en élisant Mark Carney comme chef de parti et premier ministre intérimaire. Ce n’est pas rien, après dix ans, après un gouvernement majoritaire et deux minoritaires et tant d’événements qui nous donnent un aperçu de ce à quoi le XXIe siècle va ressembler.
Je me rappelle parfaitement combien l’arrivée des libéraux de Trudeau a été vécue à l’époque comme une libération, après l’ère conservatrice. Même la candidature de Greg Fergus est passée comme une lettre à la poste, tant l’homme était connu dans la communauté et déjà une personnalité publique, sympathique. Tant d’espoir de changement, tant de promesses… non tenues.
On pourrait commencer par la plus grave : la réforme du mode de scrutin, pour introduire plus de proportionnalité et contrer l’érosion du vote… abandonnée en 2018. Continuons par la quasi-disparition du Canada comme leader de la paix à l’international (pas de poste au conseil de sécurité de l’ONU, recul du nombre de Casques bleus canadiens, engagement systématique auprès des Américains dans les conflits armés). Et pour finir, parlons du repli dans la lutte contre la crise climatique (deux pas en arrière pour chaque pas en avant), notamment par l’achat du pipeline Transmountain acheté et entretenu au coût de 30 milliards de dollars qui s’ajoutent aux 40 milliards annuels de subventions aux compagnies pétrolières et gazières contre une taxe carbone qui va être annulée de toute façon d’ici quelques semaines…
A contrario, on pourrait rétorquer que Trudeau laissera quand même une trace indélébile, des réformes audacieuses et progressistes, un legs pour les générations à venir. En améliorant la prestation canadienne pour enfants, en 2016 ? Vrai, plus de 3 millions de familles en bénéficient et, depuis, les chiffres de la pauvreté infantile reculent. La légalisation du cannabis et la renégociation de l’Accord de libre-échange en 2018 ? OK, c’est du moyen long terme. La gestion de la crise pandémique de Co-Vid-19 ? Pas si mal… et depuis ? Pendant que Greg Fergus devenait président de la Chambre des communes, le NPD a pu faire adopter ses lois sociales et les libéraux ont creusé le déficit public de manière exponentielle en distribuant 250 $ à chaque foyer canadien ?
À cela deux bémols qui concernent les grandes réformes « sociales », autour de la santé et de l’éducation : 1) le gouvernement libéral a empiété sur les champs de compétences des provinces — pour un parti qui défend bec et ongles la constitution, notamment quand il s’agit des lois québécoises 21 et 96, cela n’a pas l’air trop contradictoire ! 2) Il a attendu que le NPD ait la balance du pouvoir et lui torde le bras avant de faire passer des lois dans des domaines de compétence provinciale, comme l’assurance dentaire.
Malgré l’éloquence retrouvée de Trudeau face à la menace trumpienne ces dernières semaines et l’élection de Mark Carney à sa tête, comment croire sérieusement que le Parti libéral du Canada fera maintenant ce qu’il n’a pas fait dans les dix dernières années, c’est-à-dire apporter des solutions concrètes aux grands enjeux de notre époque ?
À la hache ou à la tronçonneuse ?
Didier Périès
Au départ, je voulais aborder la dérèglementation interprovinciale, dont nous parlons beaucoup ces derniers temps, parce qu’avec la hausse des tarifs douaniers par les États-Unis, l’économie canadienne devra se tourner vers le marché intérieur et faciliter les échanges de marchandises, de services et la mobilité professionnelle. Autant d’aspects de notre vie quotidienne, ici, en Outaouais, auxquels nous sommes confrontés de manière criante.
Entretemps, j’ai eu le malheur de chercher la plateforme conservatrice en matière environnementale. Résultat : il n’y en a pas (la dernière qui ait été formalisée date d’Erin O’Toole). Ce dont disposons, ce sont les paroles du chef, et elles sont alarmantes. Vous me connaissez, impossible pour moi de rester silencieux là-dessus.
Dans ces prises de parole, Pierre Poilièvre parle plutôt d’« efficacité » du gouvernement — comme pour les coupures dans la fonction publique — à la manière du DOGE de Trump, par exemple en accélérant les projets d’exploitation des ressources naturelles (eau, forêts, hydrocarbures, etc.) ou en « éliminant les barrières », comme les évaluations d’impact environnemental. Pour lui, de toute façon, les analyses et données provenant de l’expertise des fonctionnaires fédéraux ne sont que de la « propagande ». Alors, advenant la victoire du PCC, aurions-nous droit, nous aussi, à une dérèglementation, des coupes dans le budget de la recherche climatique et à des mises à pied des fonctionnaires qui travaillent dans ce domaine, comme aux États-Unis ?
Vous me direz, le nouveau gouvernement libéral de Mark Carney ne fait pas mieux : il a déjà désavoué son ex-ministre de l’Environnement, Steven Guilbault, en le plaçant à la culture et supprimé la seule mesure proactive un tant soit peu sensée et utile qu’il avait mise en place : la taxe carbone ! Eût-il voulu nier l’urgence climatique, Poilièvre n’aurait pas fait mieux ! Belle tactique électoraliste donc de la part des libéraux pour couper l’herbe sous les pieds de leurs rivaux, mais piètre mesure environnementale… Pas étonnant venant d’un parti qui se targuait d’avoir le meilleur plan pour le climat lors des élections de 2021. Vous connaissez le dicton ? « N’écoutez pas ce qu’ils disent, regardez plutôt ce qu’ils font »,
Mais soyons optimistes, Poilièvre a peut-être soutenu quelques initiatives contre la crise climatique ? Dans les vingt dernières années, il a plutôt voté contre l’environnement 400 fois en chambre ! Vous avez bien lu : du logement abordable écoénergétique à la réduction des inégalités d’impôts pour que les ultrariches payent plus (parce que ce sont eux les plus gros pollueurs), en passant par la protection des territoires ou la taxation du carbone, un revenu entièrement redistribué au contribuable, qu’il affirme défendre ironiquement ! Juste pour être clair : peu efficace contre les pollueurs, c’est vrai, parce que trop bas, le prix mis sur le carbone produit n’a pas contribué à la hausse de l’inflation.
Bref, tout ce que l’on peut trouver date de 2021 et se résume à quatre mesures : un compte d’épargne personnel pour la réduction du carbone ; un programme de véhicules à émission zéro, la réduction des émissions industrielles et un tarif frontalier sur le carbone… Rien qui fasse une grosse différence, surtout quand toutes ces propositions reposent sur de l’incitation. Avec l’attaque en force de Trump sur l’environnement, la crise climatique va juste s’accélérer : veut-on d’un gouvernement qui oublie cette simple, mais dramatique menace existentielle ?
Le libre-échange canadien, une utopie moderne
Didier Périès
En 2023, près de 3,6 milliards de dollars de biens et services ont franchi la frontière canado-américaine. Notre relation économique avec les États-Unis est l’une des plus intégrées au monde. Et elle a été renforcée par l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) en 2020, signé par nul autre que Donald Trump ! Enfin, pour ne citer que quelques faits, si les États-Unis sont le premier investisseur au Canada, ce dernier est la plus grande source d’investissements étrangers directs chez son gros voisin ; nous en sommes également le premier fournisseur d’énergie (27 % de toutes nos exportations de marchandises) ! Bref, la politique commerciale du nouveau gouvernement américain n’a pas fini de nous faire mal.
En réponse à cela, plusieurs, dont plusieurs zélotes du libre-échange, de la main invisible du marché et de la loi de l’offre et de la demande, ont pensé immédiatement à resserrer les liens entre nos provinces, ici, au Canada. « Desserrer » les liens, devrais-je plutôt dire, puisqu’il est question d’enlever toutes les entraves au commerce à l’intérieur du pays. J’avoue y avoir songé, parce que c’est logique. Ajoutons qu’en tant que résidents de l’Outaouais, les échanges interprovinciaux sont au cœur de notre vie. Mais dans quelle mesure est-ce sérieusement envisageable ?
D’abord, il parait un peu illusoire de penser qu’un marché potentiel de 40 millions de consommateurs canadiens pourrait remplacer un marché américain fort de 200 millions d’habitants, à moins de pouvoir multiplier notre pouvoir d’achat par quatre… Surtout dans le contexte actuel d’inflation et de récession imminente.
De plus, si l’équation « circuits de distribution plus courts + production locale = faire travailler nos gens ici (donc enrichir notre société) » parait évidente a priori, qui peut garantir que nous aurons à dépenser moins, a posteriori ? Et en ce qui concerne la qualité des produits ? L’idée n’est certainement pas de promouvoir l’agriculture et l’élevage intensif, industriel, mais plutôt les filières écologiques, plus saines pour notre santé, non ?
Un autre aspect non négligeable concerne les compétences provinciales en termes de réglementation : sans même aborder la question des tarifs ou des quotas, pensez à tous les règlements sur le transport, la fabrication, la protection du consommateur, l’emballage, l’étiquetage, les matériaux utilisés, les normes environnementales, les permis requis, etc. Un vrai casse-tête!
Ah ! J’oubliais : la mobilité de la main-d’œuvre ! Combien de travailleurs de l’Outaouais québécois préfèrent obtenir leur carte professionnelle en Ontario, pour des raisons de salaire ? Pourquoi ne peut-on travailler des deux côtés de la rivière, sur des projets identiques, sans avoir à choisir entre les deux ? Si cela n’a pas été fait jusqu’à maintenant, en pleine pénurie de main-d’œuvre qualifiée, il est difficile de croire que la situation change du jour au lendemain, comme l’exige pourtant la situation actuelle. Et dans ce cas, le gouvernement fédéral ne peut qu’intervenir sur les équivalences de diplôme ou de certificat professionnel au niveau pancanadien ; les ordres peuvent toujours obliger à un réexamen du dossier par la suite, comme plusieurs d’entre nous l’ont vécu ou le vivent encore.
Bref, ce sera donc aux provinces, principalement, de déréguler ce qui peut l’être pour faciliter les échanges commerciaux et la mobilité des travailleurs; ce sera aux provinces de convaincre plus de 300 organismes régionaux ou locaux d’assouplir les règles qui justifient leur existence même, comme les ordres professionnels. Bonne chance !
Il faut sauver le soldat « Impératif français » !
Didier Périès
La semaine dernière l’organisme de promotion du français Impératif français a défrayé la chronique. Il est bien connu dans la région et partout au Québec, surtout à travers son ancien président, haut en couleur et pourfendeur des délinquants du français dans la région, la province et au Canada.
Depuis ses débuts en 1975, l’organisme culturel vise une meilleure francisation des gouvernement et des entreprises ; il collabore avec d’autres organisations de défense du français et réalise des évènements, tels que la Semaine de la langue française, des concours d’écriture ou le célèbre Outaouais en fête. Ce festival nous positionne d’ailleurs au moins une fois par an comme leader en matière d’illustration du français au Québec. Pas si mal ! Combien de jeunes (et de moins jeunes) ont-ils été bénévoles, un jour ou un autre, à l’occasion de cet événement, qui a réuni au fil des années les plus grands noms de la musique francophone québécoise.
Pendant les quarante années de la présidence de Jean-Paul Perreault, Impératif français semble surtout être devenu un organisme de défense du français, et son président, Jean-Paul Perreault, une sorte de chien de garde qui avertissait bruyamment, dans un langage fleuri, mais toujours correct, lorsque nos décideurs se permettent de bafouer le français. l’autre langue officielle - au Canard - mais la seule au Québec (!).
Qui oserait dire que nous pouvons nous passer d’un tel garde-fou linguistique ? On sait en effet que nos compatriotes québécois considèrent l’Outaouais comme un « coin d’Anglais », au fin fond de la province, que la proximité de l’Ontario condamnerait à être un éternel mauvais élève de la langue française. Alors, nous avons appris à nous défendre par nous-mêmes, c’est de la résilience. Plusieurs grands artistes en sont d’ailleurs originaires : Gatineau est un vivier plutôt qu’un désert en la matière.
Par contre, on connait moins les activités de recherche de l’auguste institution, cela mériterait peut-être un développement dans le futur, sous la forme d’études de terrain sur la présence, l’évolution et l’avenir du français ou des « cultures d’expression françaises » (le pluriel est de moi) …
Cependant, l’actualité récente a quelque peu écorné l’image d’Impératif français. Si un changement de garde a eu lieu à l’automne dernier avec le remplacement discret, mais historique de Jean-Paul Perreault par une Linda Larocque très en verve. Trop, selon ce que le journal Le Droit a découvert sur son Facebook. Pour résumer, il s’avère que Mme Larocque confond défense du français avec défense de ce qu’elle croit être la culture « traditionnelle » québécoise et dans une langue très vulgaire, loin des standards du français. Optionnellement, elle a provoqué par son mode de gestion, le départ de sa directrice générale, de son secrétaire et possible de son vice-président. Bref, Impératif est désormais une poule sans tête, qui n’aurait qu’une centaine de membres en règle finalement… mais trois millions de dollars en banque. À moins qu’il perde son financement public, il reste un organisme viable financièrement et qui dispose encore probablement d’un fort crédit auprès de la population.
Mais Impératif français pourrait rapidement décliner sans une nouvelle direction respectueuse de ses employés, des bénévoles et de la communauté, garante d’un français de qualité et qui serait tournée vers la réalité de la francophonie d’aujourd’hui plutôt que vers un passé révolu.
Fixer un prix sur le carbone, trop coûteux ?
Didier Périès
Et oui, maintenant, nous sommes les « irréductibles gaulois » québécois, parce que nous sommes les derniers au Canada à avoir fixé un prix sur le dioxyde de carbone. En effet, Mark Carney a appliqué la mesure qu’il avait annoncée : la fin de la taxe carbone. Avec pour effet immédiat de voir le carburant diminuer de quelques cents partout ailleurs, sauf au Québec, où le prix du litre est désormais d’un peu moins de 4 cents supérieurs… C’est grave, docteur ?
J’aimerais rétablir quelques faits afin de mieux évaluer l’impact de cette abolition, mais aussi sa pertinence. D’abord, il faut se rappeler que les Canadiens qui payent depuis 2019 cette taxe au moment de remplir le réservoir de leurs véhicules ont gagné de l’argent, des chèques compensatoires d’un montant total de 1544 $ pour une famille de quatre personnes, en Alberta, en 2023-2024. Et cette taxe contribue pour seulement 0,1 % de l’inflation, contrairement aux mensonges répétés de Pierre Poilièvre. En plus, il s’agit de pousser les consommateurs — entreprises comme particuliers — à changer leurs habitudes, comme réduire leurs déplacements ou posséder moins de véhicules… Soit dit en passant, il a été prouvé que le montant actuel (65 $ la tonne de CO2) était insuffisant pour être un véritable incitatif, celui prévu en 2030 (165 $ la tonne), en revanche, aurait pu avoir un effet. Bref, c’était une demi-mesure, mais elle fait partie de l’arsenal d’outils pour ralentir les changements climatiques. L’avoir supprimée est une erreur.
Alors, dans un contexte de reprise de l’inflation et de probable récession à venir, le Québec devrait-il maintenir sa tarification du carbone ? En fait, nous participons à un système de plafonnement et d’échange de droits d’émissions qui met un prix sur la pollution et permet aux entreprises, aux institutions, aux états qui polluent moins de vendre leurs crédits et à ceux qui polluent davantage de racheter ces crédits afin d’équilibrer leur bilan carbone et payer moins de pénalités. Est-ce que cela entraine directement moins de pollution ? Non, surtout, pour les plus riches des compagnies, qui peuvent se le permettre… Mais c’est un peu la carotte qui, conjuguée à des subventions à l’achat de produits moins néfastes pour l’environnement, par exemple, comme carotte, va certainement dans le bon sens. Par ailleurs, il faut aussi que les sommes dégagées aillent dans des mesures écologiques : c’est le cas au Québec, où elles vont dans le Fonds pour l’électrification et les changements climatiques.
Une fois écarté le Bloc québécois, puisqu’il n’est pas un parti de gouvernement, on peut quand même observer le silence du NPD, qui n’a pas mis à profit son alliance avec le Parti libéral du Canada pour faire avancer une seule mesure climatique et la régression des deux partis majeurs… C’est très préoccupant, parce qu’il faut être clair : nous n’améliorerons pas notre bilan carbone, en tant que pollueurs majeurs de la planète, sans qu’il y ait quelques désagréments. Abandonner des politiques climatiques sérieuses, exigeantes, courageuses et laisser croire que c’est possible au nom d’une urgence telle la crise économique due à l’explosion des droits de douane étatsuniens, est hypocrite ou inconscient ! Le principe du pollueur-payeur est un principe irréfragable ; s’il fallait en plus que l’on fasse porter le fardeau de la dette à l’ensemble de la population !
La machine à illusions
Didier Périès
Au moment où des milliers de Gatinois se promenaient sur la rue Principale, à Aylmer, et profitaient du festival « La principale se sucre le bec », en cette première magnifique fin de semaine printanière, d’autres se pressaient au Salon de l’auto de l’Outaouais 2025.
C’était à l’autre bout de la ville, au Centre Branchaud-Brière, à l’intérieur, bien sûr. Donc, ironiquement, au lieu de profiter de l’extérieur, les visiteurs de ce salon se sont enfermés pour magasiner des objets qui les coupent de l’extérieur, une sorte de double enfermement. C’est pour moi symptomatique d’un certain état d’esprit culturel ou civilisationnel, dans un monde où l’automobile a occupé depuis un siècle une place prépondérante, tant au niveau de la croissance économique que de notre environnement physique… et surtout dans nos têtes : pensez aux préoccupations permanentes dont nous sommes les victimes : la recherche d’un nouveau ou d’un deuxième (ou d’un troisième !?!) véhicule, le prêt pour l’acheter, le permis pour la conduire, son immatriculation, les réparations… dois-je ajouter le temps passé devant la moitié des publicités que nous recevons et qui tentent de nous vendre une voiture ?
Mais ce n’est pas tout : rappelons-nous qu’il y encore un an, le salon de l’automobile se nommait le « Salon du véhicule électrique de l’Outaouais », et ce, depuis quelques années déjà. Et là, pourquoi retournerait-on à un nom plus générique ? Étrange… Aujourd’hui, grand retour des véhicules à essence… en incluant aussi tout ce qui est hybride ou électrique (vélo, trottinette, etc.). La raison officielle d’après les organisateurs ? Attirer les « gens qui carburent à l’essence » afin de leur donner à essayer l’électrique, pour les convaincre. Ma version : là où il y a de l’argent à faire, on n’est pas trop regardant. Franchement, être écolo, en conduisant une Mustang électrique ou un gros pick-up américain ? De toute façon, le problème est plutôt la voiture solo ; la multiplication des véhicules pour un seul foyer ; les voitures, surtout électriques, qui sont de plus en plus lourdes, qui abîment les routes… Le pire est que le phénomène s’étend à d’autres villes du Québec (Victoriaville, Terrebonne, Saint-Hyacinthe).
Bon, je vais être honnête : le retour au moteur à combustion me préoccupe sérieusement. Parce que j’étais certain que nous étions en train de passer le cap collectivement, de tourner la page pour des véhicules vraiment moins polluants. Il a suffi que les deux paliers de gouvernement, provincial et fédéral, réduisent puis suppriment les subventions à l’achat d’un véhicule hybride ou électrique, et hop, disparues les bonnes intentions ! Et Mark Carney a cloué le cercueil de la cause climatique en reprenant l’argumentaire de Pierre Poilièvre (à moins que ce soit le contraire) : il veut que l’on soit « maitre chez nous » (deviendrait-il souverainiste ?) et leader mondial sur le plan énergétique, en relançant la production des énergies fossiles… tout en faisant la transition énergétique vers les énergies propres et renouvelables évidemment ! Il n’y a pas de contradiction, selon notre grand financier international. Ouf, on a eu peur ! On a cru un moment que le premier ministre du Canada intérimaire voulait vraiment réduire les GES et combattre la crise climatique. Non, non, il est comme beaucoup, mais en pire (parce que lui gouverne), il feint de croire que le développement économique est synonyme de rejet de l’écologie.
Or, c’est faux.
Ce que ça dit sur notre démocratie…
Didier Périès
Nous avons assisté la semaine dernière à un spectacle médiocre, dans un « boys club », un ring de boxe où se répondaient quatre chefs parmi les cinq que compte la Chambre des communes. Les trois mêmes chefs que la fois précédente, en 2021, sauf pour un Carney quasi inaudible, digne successeur de Trudeau, et à l’exclusion de Jonathan Pedneault, le cochef du Parti vert du Canada, seul capable de tenir vraiment tête à Blanchet en français.
Leur credo ? À peu près les mêmes que d’habitude. Pour les libéraux, doubler le rythme de construction (500 000 logements, mais pour qui, à quel prix ?) et protéger la culture. Pour les conservateurs, rendre la vie plus abordable par des coupures d’impôts de 15 % et d’autres coupures dans la TPS sur les nouvelles maisons, avec moins de fonctionnaires et de gouvernement… bref, chacun pour soi ! Pour les bloquistes, la priorité c’est le droit pour le Québec d’avoir une économie différente, une culture différente, des points de vue différents, bref d’être différent. Je crois qu’on avait compris, mais est-ce un programme ? Enfin, pour le NPD, il s’agit de défendre des valeurs : prendre soin les uns des autres, par le système de santé (assurance-médicaments et soins dentaires) et investir plutôt que couper ; 600 000 nouveaux logements sur des terrains fédéraux, avec quels matériaux de construction ? Et quels travailleurs qualifiés ?
Tout à coup, nous avons entendu des expressions comme « souveraineté (canadienne) », « maître chez soi » (pure appropriation culturelle venant de fédéralistes), « les Canadiens et les Québécois », comme si le Québec était un pays différent du Canada. Soudainement, les libéraux se posent en défenseurs de la langue française, de la gestion de l’offre et de la culture québécoise. Tout à coup, le PLC dirigé par des gens de Toronto veut défendre les Québécois ! Comme ils l’ont fait depuis 10 ans ? Allons donc !
Comme à son habitude, en bon libéral, Carney a promis des dépenses tous azimuts, de l’aide à toutes et à tous pour répondre aux problèmes que l’arrivée de Trump a accrus exponentiellement, par des réductions d’impôts, de taxes, et cela en épongeant les 50 milliards de déficit actuel. Et ce gars-là vient de la finance ? Il n’a pas dû suivre les mêmes cours de comptabilité que moi alors…
Ironie du sort, aucun des quatre partis n’avait présenté son cadre financier au moment du débat, après quatre semaines de campagne ! Il me semble que cela ressemble pas mal à un (autre) déni de démocratie, non ? Pensent-ils sérieusement que nous allons les croire aveuglément, sans avoir au moins les prévisions budgétaires sous les yeux ?
La question reste : voulons-nous réellement d’un gouvernement libéral majoritaire ? Parce qu’un gouvernement minoritaire n’est en fait bloqué que dans l’imaginaire de certains : il n’est pas bloqué, il doit faire des concessions. Dans ce cas-là, ce n’est d'ailleurs pas le Bloc qui ferait grand-chose, il défend seulement les intérêts du Québec et n’a pas de vision canadienne (jusqu’à preuve du contraire, nous vivons encore au sein de la confédération). Le NPD, lui, a prouvé que, s’il est capable de faire avancer des réformes sociales, c’est en empiétant sur la constitution du Canada, mais quid des réformes environnementales ? Et à quoi sert la péréquation ? Bref, seul un nouveau joueur, un autre parti progressiste et écologiste pourrait changer la donne.
Bras d’honneur à notre mère, la Terre
Didier Périès
Au moment où j’écris ces lignes, il m’est impossible d’avoir les résultats exacts des élections fédérales, je me garderai donc de commenter… pour l’instant. Laissez-moi vous raconter une petite anecdote.
Pour la journée de la Terre, outre un nettoyage des débris ultrapolluants laissés par les feux d’artifice cet hiver sur le brise-lames de la marina d’Aylmer, j’ai assisté à une cérémonie organisée dans l’école où je travaille. Afin d’aller plus loin dans l’engagement pour l’environnement, qui passe déjà par un plan stratégique vert, une collaboration étroite avec les gardiens de notre territoire que constituent les Anichinabés de Kitigan Zibi, nous travaillons aussi avec les Gardes-rivière des Outaouais, une association unique pour une cause écologique unique.
En effet, le bassin versant de la rivière des Outaouais, l’affluent le plus important du fleuve St-Laurent, recueille toute l’eau de pluie et des fontes printanière, depuis sa source, le lac des Outaouais à 250 km au nord, s’allonge sur 1271 km jusqu’à son embouchure et fait 146 300 km2 de superficie, soit deux fois la taille du Nouveau-Brunswick. Et sur son sol s’élèvent le Bouclier boréal et des plaines à forêts mixtes.
Il est aussi difficile de savoir exactement de quelles manières l’activité humaine affecte la qualité de cette rivière qui nourrit tant de sols et d’activités que de comprendre son fonctionnement systémique. Et comme il s’agit d’une rivière interprovinciale, aucune des deux provinces ne peut faire des études exhaustives de son bassin versant à partir de ses berges, d’où l’existence et la nécessité des Gardes-rivière des Outaouais. Bref, voici tout au moins une liste partielle nous polluons la rivière des Outaouais : les barrages, les eaux usées municipales, les eaux usées industrielles, les eaux de ruissellement urbaines, l’agriculture, les plaines inondables et l’aménagement des rives, et la destruction des terres humaines.
En tout cas, mardi dernier, lors de la conférence à ciel ouvert de Laura Reinsborough, la directrice générale de l’organisme, j’ai pris conscience de l’importance cruciale de la rivière que je vois quasiment depuis ma fenêtre tous les jours. Mes collègues enseignants, le personne de mon école aussi probablement, et alors qu’elle continuait habilement à nous parler, je me disais intérieurement plus de 90 % de ces gens qui avaient l’air de compatir, de saisir intimement ce qui leur était dit, allait faire des choix électoraux aux antipodes de cela par peur, par intérêt personnel ou par aveuglement.
Elle continua en nous posant trois questions cruciales : Où sommes-nous ? quand sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Et là, rebelote ! Non, pas à Ottawa ou à Gatineau, mais sur Terre, un caillou habité quelque part dans l’univers ; non, pas en 2025, mais dans un continuum vieux de 300 00 ans, depuis les premiers hominidés, avec un cerveau identique à celui des hommes préhistoriques ; non, pas seulement des humains, mais des organismes vivants, au même titre que les plantes et les animaux, dont les particules iront finalement se fondre dans le grand tout autour de nous.
Cette cérémonie s’est terminée par un serment d’allégeance d’un-e représentant-e de chaque corps constituant l’école, comme si nous avions vraiment décidé, collectivement, que préserver notre environnement devenait notre mission prioritaire. Dans une époque où nos sociétés ne pensent qu’en dollars, taux de croissance, barrières douanières, clics ou « likes » sur les médias sociaux, quelle ironie cruelle !
On prend les mêmes et on recommence !
Didier Périès
En fait, ce n’est pas complètement vrai. Parce que le paysage politique canadien a sensiblement changé après les élections de la semaine dernière. Voyons cela de plus près.
D’abord, quelques chiffres, toujours une bonne base pour entamer la discussion, quand ils sont fiables. Et il faut toujours les mettre en perspective plutôt que de les prendre en soi. Élections Canada nous informe que le PLC a obtenu un peu plus de 8,3 millions de voix, soit 43,6 % des votes exprimés, le PCC quasiment 8 millions… avec un taux d’abstention de 33 % environ. Donc, cette large minorité obtenue, qui obligera les libéraux à trouver 14 autres députés pour faire voter les lois proposées qu’ils proposeront, ne représente en fait que la moitié des deux tiers des Canadiens votant, soit à peine 30 % des citoyens en âge de voter.
Pour comparaison, en 2021, il y avait eu un gouvernement minoritaire libéral (déjà), avec 36,5 d’abstention. La différence avec la situation actuelle, on la comprend, la peur de Trump est passée par là. D’où également le fameux « vote stratégique » auquel les libéraux ont largement fait appel, qui a certainement entrainé un report des voix de gauche.
Localement, ce sont 62 % des votes exprimés qui sont allés à Greg Fergus, laissant les conservateurs à un étonnant 17 %, vu que leur candidate n’a participé à aucun débat et n’a pour ainsi dire pas fait campagne — j’y reviendrai — et le Bloc à 12 %, les autres partis, surtout les partis progressistes de gauche (NPD et Verts) se partageant les miettes… En 2021, le Bloc était second, avec 16 %, le NPD troisième avec près de 13 % des voix et les Conservateurs quatrième à même pas 10 % !
D’ailleurs, tout cela ne doit pas masquer deux problèmes beaucoup plus préoccupants. Le premier est l’aveuglement d’une bonne partie de l’électorat qui, en cédant à la peur, n’a parfois même pas considéré que le vote étant acquis aux libéraux dans certaines circonscriptions (comme les nôtres en Outaouais), il eût été largement possible de voter pour des partis aux valeurs qui leur ressemblaient davantage. Comme ce ne fut pas le cas, les partis progressistes, disons de gauche, sont désormais au bord de l’extinction, sans financement.
Le deuxième est la « droitisation » du spectre politique. Avouons-le, Mark Carney a non seulement mis à mal plusieurs années d’efforts pour le climat - déjà insuffisants, mais quand même - mais en plus, il a chassé sur les terres des conservateurs en coupant la taxation du carbone, rassuré le lobby pétrolier et gazier en promettant de développer les pipelines et l’extraction d’énergies fossiles, de baisser les impôts et de rendre la fonction publique plus « efficace ». Tout cela sans le dire franchement, et en cela, il faut reconnaitre que le multimillionnaire et spécialiste de l’évasion fiscale qu’il est, a su rapidement adopter la langue de bois politicienne.
Bref, il a tenu un langage de droite et nationaliste qui a flatté beaucoup de Canadiens dans le sens du poil ; ajoutons-y toutes les voix conservatrices, celles du PPC et celles du Bloc, qui n’est pas à proprement parler un parti de gauche, et vous obtenez le portrait d’un pays plus à droite que jamais dans les cinquante dernières années… Quand je vous disais préoccupant.
Dieu est mon droit
Didier Périès
Vous devez penser : « Est-ce que Didier aurait tourné casaque ? ». J’avoue qu’en choisissant la devise de l’Angleterre (en français dans le texte original, parce que la langue de la cour et de l’aristocratie anglaises du XIe au XIVe siècle était le français, l’anglais étant réservé au petit peuple), j’ai voulu provoquer. Rien de bien méchant, mais suffisamment pour nous faire réfléchir à notre relation avec Albion.
En effet, faut-il le rappeler, le Canada est une monarchie parlementaire. Et si, quotidiennement, c’est l’aspect parlementaire qui domine la vie politique canadienne, il n’en reste pas moins qu’au-dessus de la tête de nos députés à la chambre des communes, et même au-dessus de celle de notre premier ministre, se tient une tête couronnée. En l’occurrence, celle de Charles, le roi d’Angleterre.
Et nous avons beau clamer que nous sommes un pays indépendant, qui a gagné ses galons par le sacrifice de ses enfants, lors des différentes guerres mondiales (souvenez du massacre de Vimy, encensé comme l’acte de naissance du Canada), les faits sont têtus : le roi d’Angleterre et souverain du Royaume, chef de l’Église anglicane, nomme le premier ministre du Canada et « sanctionne » les lois votées au Parlement à Ottawa.
Pour moi, cela constitue tout simplement une épée de Damoclès qui menace la démocratie canadienne. Et aujourd’hui, en 2025, pour nombre de Québécois et de Canadiens, il s’agit d’une incongruité, d’une anomalie dont on ne perçoit plus le sens. Les plus récents sondages montrent que près des deux tiers des Canadiens (et les trois quarts des Québécois) pensent qu’il faudrait reconsidérer les relations avec la Couronne britannique. Et cela augmente chaque année.
Certains défenseurs du statu quo arguent que le pays tient le coup face à toutes les tempêtes grâce à cette « stabilité », que cet assujettissement nous protège… contre quoi ? Les changements ? Qui a dit que les changements étaient mauvais ? Il n’existe pas de forme figée de démocratie, elle est un régime par définition protéiforme et évolutif. Au contraire même, elle se doit d’évoluer avec son temps, comme les sociétés se transforment. Comment peut-on penser que le mode de fonctionnement des institutions politiques qui valait sous John A. McDonald puisse encore être pertinent au XXIe siècle ?
D’autres avancent que « Oh, Charles a les mêmes intérêts que nous pour les changements climatiques ou l’éducation, la diversité et l’inclusion, alors pourquoi ne pas le garder comme chef de l’état canadien ? ». Ou encore : « Cela ne change rien de toute façon… ». Franchement, sont-ce des arguments ? Voulons que le modèle ultime d’être humain que nous présentons à nos enfants soit celui d’une personne, dont la principale qualité pour être chef est d’être le fils du roi ou de la reine précédent-e, soit à l’opposé de la méritocratie que nous vantons tant ?
Et l’ironie dans tout cela est que nous venons d’élire le plus monarchiste des candidats qui se présentait aux élections fédérales, le 28 avril dernier. Mark Carney, duquel la conjointe est britannique, qui a œuvré comme directeur de la Banque d’Angleterre et qui a osé inviter le roi d’Angleterre à prononcer le discours du trône marquant le début de sa mandature, à la place d’un autre vestige des temps anciens, la gouverneure générale. Et d’ajouter : « Cette décision souligne la souveraineté du Canada » ; plutôt l’adoubement d’un vassal par son suzerain.
Vivre (heureux) et laisser vivre
Didier Périès
La lecture du témoignage intègre et courageux (si, si) de Louise Rousseau a encore augmenté d’un cran l’indignation qui m’habite souvent, spécialement dans les dernières années. J’avais juste envie de dire : « Hé, l’ami, si c’est toi qui as proféré ces paroles et/ou qui as frappé l’un de tes voisins pour sa préférence sexuelle, vient me voir, je vais te faire comprendre à ta manière ce que je ressens et te faire ravaler tes propos désobligeants ». Au fond, je sais que cela ne changerait pas grand-chose, que ce n’est pas une réponse politiquement ou socialement correcte, mais, quel défoulement ce serait! Personne ne devrait craindre d’afficher son identité ou sa préférence sexuelle en public. C’est non négociable. Mais un peu d’empathie, que diable ! Par contre, ce qui est fâcheux, c’est la confusion, l’approximation et l’amalgame.
Par exemple, clamer : « Arrêtez la guerre à Gaza, arrêtez le massacre et d’affamer les Gazaouis ! », est-ce faire preuve d’antisémitisme ? Certains voudraient amalgamer anti-israélisme (oui, le terme est bizarre) et antisémitisme. Et entendre Trump parler de crime antisémite à propos de l’assassinat de deux employés de l’Ambassade d’Israël à Washington la semaine dernière, alors que cent civils — majoritairement des femmes et des enfants — meurent sous les bombes chaque jour à Gaza, c’est d’une ironie cruelle. Je parlais d’approximation : le président étatsunien traite son homologue sud-africain de génocidaire, parce que certains fermiers blancs afrikaners ont été expulsés de leurs terres (et parfois attaqués)… Or, l’Afrique du Sud est le pays qui mène la poursuite contre Israël pour génocide auprès de la justice internationale depuis l’année dernière. Coïncidence ?
Pour être franc, il me semble au contraire que c’est probablement l’une des agressions les moins antisémites de ces derniers mois. Ce couple était israélien et travaillait pour le gouvernement israélien. L’assassin, lui, n’a pas crié « mort aux juifs », mais « libérez Gaza ». Cependant, il faut aussi reconnaitre que les délits haineux contre des juifs ont augmenté partout dans le monde… particulièrement depuis la réponse disproportionnée du gouvernement de Benjamin Netanyahou aux attaques meurtrières du Hamas d’octobre 2023. Sans cela, d’ailleurs, le double meurtre aurait-il eu lieu? Tous les Gazaouis ne sont pas des suppôts du Hamas, ils le subissent aussi ; tous les Israéliens ne soutiennent pas les crimes de guerre de Tsahal, l’armée israélienne. Et encore moins les juifs hors d’Israël. Un peu de nuances !
Dans cette affaire, dont les fondements sont à chercher dans l’histoire longue, et plus récemment au XXe siècle, la plupart des gens sont confus. Et cette confusion est renforcée par les plus radicaux, à l’extrême gauche comme à l’extrême droite : les antisémites profitent de la guerre à Gaza pour s’attaquer à tous les juifs sous couvert de parler des Israéliens ; le très cynique Netanyahou, accroché à son pouvoir et associé aux ultrareligieux israéliens les plus fanatiques, qualifie d’antisémite toute critique envers sa politique de destruction à Gaza et dans les territoires palestiniens.
Pourquoi dépenser tant d’énergie, de temps et de moyens dans la guerre ? Pourquoi détester nos voisins (de près ou de loin) au point de les affamer, de les battre, de leur enlever toute dignité ? Qu’est-ce qu’apporte cette haine de bon ? Après tant de détestations, est-on plus heureux ? J’aimerais pouvoir préconiser le dialogue, mais, comme l’Histoire nous l’a prouvé, on ne peut tolérer l’intolérable.
Inaction climatique : avancer à reculons
Didier Périès
Vous me trouverez un brin (trop) sarcastique peut-être, mais comment ne pas noter cette coïncidence troublante ? Si j’étais superstitieux, je la verrais comme un signe divin. Mais pour Mark Carney et la majorité du monde économique sans morale des « investisseurs », c’est juste un contretemps. On change de lieu, tout simplement, comme on change de pays, voire de continent, quand les lois d’un pays incommodent la politique interne d’une entreprise en matière syndicale, salariale, écologique, fiscale… C’est le jeu de la mondialisation, commenteraient certains en se couvrant les yeux… et, dans ce cas-ci, en se bouchant également le nez.
Notre sauveur et nouveau premier ministre vient d’effectuer une rencontre cruciale avec les premiers ministres provinciaux sur le chemin vertueux de la relance économique, plus exactement sur les « projets d’intérêt national » et la facilitation du commerce intérieur. Elle était prévue initialement à Saskatoon, mais à son tour après le Manitoba, la Saskatchewan a déclaré l’état d’urgence en raison de grands incendies la semaine dernière ! Or, ces derniers ne sont pas le fruit d’un hasard climatique et ponctuel ou d’un pyromane. Les météorologues le prédisent : à l’ouest du Canada, l’été va être chaud et très sec ; à l’est, chaud et très humide, avec des risques d’orage et de vents très violents (ça vous rappelle quelque chose ?). La saison des feux commence en fait de plus en plus tôt, c’est l’une des conséquences de la crise climatique. Oui, oui, celle de laquelle on découvre tout à coup qu’il n’en a pas été question pendant la dernière campagne fédérale. Si nous pouvons aisément admettre que la guerre en Ukraine et l’épuration ethnique à Gaze ainsi que le trublion Trump constituent un écran de fumée, il est inacceptable que nos gouvernants, qui se présentent souvent eux-mêmes comme des visionnaires au-dessus de la mêlée, il est intolérable que ces décideurs l’occultent.
Mais réduisons plutôt la « paperasse administrative », comme les évaluations environnementales, afin d’augmenter « l’efficacité » dans la réalisation de nouveaux projets industriels ! Exploitons nos ressources énergétiques naturelles (parmi lesquels le pétrole et le gaz de schiste) pour retrouver la croissance ! Donnons des milliards aux constructeurs pour bâtir des logements cheaps non écologiques, ou pour des solutions technologiques « vertes » qui n’existent pas ! Pourquoi pas, si ça rapporte de l’argent ? Mais qui en tire le plus de profit, selon vous ?
Parce que, parallèlement, le fait demeure : l’urgence climatique ne faiblit pas, au contraire. La sécheresse, les inondations et les incendies détruisent les récoltes partout, contribuant, entre autres, à briser les chaines d’approvisionnement, ce qui se répercute sur les prix à la consommation. Puis, avec la multiplication d’événements extrêmes, les assurances couvrent de moins en moins ces risques ou réclament des primes grandissantes. Enfin, la hausse des pathologies dues à la pollution atmosphérique, aux coups de chaleur, à la progression de maladies, comme la maladie de Lyme, etc., fait exploser les coûts en santé.
Même en nous attaquant aux « gros pollueurs » (industries extractives, transport, grosses entreprises de transformation…) — ce que Mark Carney refuse de continuer — nous allons droit dans le mur, mais là, avec le retour à des politiques publiques écocides, c’est à grande vitesse que nous le prenons. Ironie cruelle, les provinces les moins enclines à s’adapter à cette nouvelle donne seront les premières à en payer le prix, dès cet été.
Comme un parfum d’évasion dans l’air
Didier Périès
Juin est l’un de ces mois de l’année où les enfants sont à l’honneur. En effet, c’est la fin de l’année scolaire, le début des vacances d’été, soit, pour certains, la fin d’un chapitre de leur vie : dernière année en garderie, au préscolaire, de primaire, de secondaire ou de collégial, il y a en juin ce drôle de mélange entre la gravité des examens et des remises de diplôme et la légèreté estivale. Un entre-deux un peu flou. Comme le ciel que nous avons tous observé récemment, accompagné d’une petite odeur âcre de brulé parfois et, pour les plus fragiles d’entre nous, les enfants par exemple, d’une difficulté à respirer ou de maux de gorge.
Mais il y a désormais encore un nouveau gadget pour les occuper, les pauvres ! Et, oui, le 5 juin dernier, Nintendo a sorti sa nouvelle console de jeu, la Switch 2. Huit ans après la Switch, voilà que « Big N » nous propose une nouvelle version. Notez bien qu’ayant raté le train des jeux vidéo à la fin du XXe siècle — trop occupé avec d’autres activités, je ne pouvais consacrer 3-4 heures à jouer devant un écran — je ne connais peu ce domaine. Il reste encore un mystère pour moi, d’autant plus si j’entends que des millions de ces petits bijoux de technologie sont déjà prévendus, notamment au Canada, pour la modique somme de 629,99 $ (+ taxes + 100 $ pour chaque jeu ajouté). Nous sommes quasiment en récession, plusieurs d’entre nous en arrachent pour se nourrir et se loger, mais il y a visiblement le budget pour se payer une nouvelle console de jeu dans les familles… Parce que la Switch est avant tout une console familiale. D’où ma curiosité.
Parents ou enfants, les amateurs attendaient le divin engin depuis l’annonce faite au début de l’année. Les appétits étaient aiguisés : imaginez, un nouveau Mario Kart World prenant vie sous vos yeux ébahis ! Le 12 juin, Memory Lost et Gal Guardians servants of the Dark ; le 19, Raidou remastered the mystery of the Soulless army ; et en août, le célèbre Berserk Boy ! Et puis aussi Tom Raider IV-VI Remastered, the Thing, Légendes Pokémon Z-A, et j’en passe. Une avalanche de divertissement, à la sortie savamment orchestrée, afin de nous tenir en haleine, les mains sur la console pendant des mois, que dis-je, des années… Jusqu’à la sortie de la Switch 3...
Ainsi se résume pas mal notre vie, à attendre, attendre la prochaine sortie du prochain gadget indispensable à une existence tellement vide ou déprimante qu’il nous faille pareille distraction pour la supporter. Ironiquement, ce n’est pas tant l’emprise psychologique et physique que peut avoir un tel appareil, corollaire d’un temps accru passé devant un écran, que le prix, qui frustre de nombreux adeptes au pays. Mais, la puissance et la qualité de l’image est au rendez-vous, que voulez-vous ? La Switch sera désormais au niveau d’autres consoles beaucoup plus chères… quand on se compare, on se console ! Et puis les jeux ont toujours couté cher, de toute façon. Et maintenant, les correctifs se font à distance, c’est ça d’économisé… L’entreprise nous l’affirme : « Offrir de nouvelles expériences de divertissement agréable est primordial ». Et ce bonheur-là, à portée de main, n’a pas de prix, n’est-ce pas ?
Bonne fête des pères !
Didier Périès
En tant que parent, en tant que père, il est plusieurs évènements que nous ne voulons surtout pas vivre. Je passerais sur la première, qui consiste à survivre à la mort de nos enfants, pour discuter de l’une des suivantes : assister à l’arrestation puis à la détention de notre progéniture, et voir cette dernière devenir un-e criminel-le. Un véritable crève-cœur ! Or, l’on peut déjà se poser la question de savoir si l’on connait vraiment nos enfants, ou petits-enfants, neveux, nièces, etc. ? En fait, il peut arriver que l’on découvre des aspects plus sombres de leur existence ou de leur personnalité…
Cette problématique est même devenue un enjeu social. Les habitudes de nos jeunes, disons entre 14 et 25 ans, ont changé. D’une part, leur socialisation : entre une hyperindividualisation, que notre société de consommation encourage, et un certain cloisonnement entre les groupes ou communautés, qui répond à un besoin de sentiment d’appartenance, entre autres choses, les moments de socialisation sans supervision parentale, tels que des « party », ne se déroulent peut-être plus comme avant. Ma propre fille m’avouait récemment que, déjà lors de ses années de secondaire, il était commun de fréquenter des membres de « gangs » à cette occasion ou de. voir des gens avec un couteau. Lors d’une rixe, aujourd’hui, on ne prend pas un coup de poing, on fait face à des coups de couteau ! Le racisme, l’homophobie, l’intolérance ont refait surface et s’y expriment, décuplées par les réseaux sociaux, sur lesquels se retrouvent aussi les groupes criminels d’ailleurs.
D’autre part, dans cette tranche d’âge, le port d’armes a changé de statut, il n’est plus tabou. Attention, je ne parle pas de fusils d'assaut, mais d’armes de poing (à air comprimé ou à feu) ou de lames, qui connaissent un réel engouement. Conséquence d’une certaine culture, on observe une propension à porter une arme, notamment dans les « party » qui émaillent ces années-là. Une culture de la violence physique comme seul moyen d’exprimer le sentiment de ne pas avoir de place dans notre société ou aucun avenir ? Une culture de la colère, de la rage même, dirigée contre la société, contre ceux ou celles qui sont différents, bref, contre les Autres.
S’il y a les agresseurs d’un côté, n’oublions pas qu’il y a aussi les victimes potentielles. Ces dernières ressentent davantage d’insécurité aujourd’hui que par le passé. Dans les évènements sociaux, ces personnes craignent pour leur vie physiquement. On pourrait y ajouter le risque violence sexuelle, qui ajoute une couche d’anxiété... Et quand on a peur, quoi de mieux pour se rassurer que de porter soi-même une arme ? Avec laquelle on pourra éventuellement crâner, pour montrer que l’on est également un-e « badass » ou simplement comme réponse à la menace par la menace. Avec laquelle on pourra éventuellement, par accident, blesser, voire tuer… Alors, la victime devient l’agresseur, qui termine devant un juge, avec des accusations criminelles !
Plusieurs jeunes l’avouent : c’est devenu la norme ! Le phénomène s’est banalisé dans la dernière décennie, particulièrement dans les villes - les statistiques d’arrestation de jeunes pour violence ont explosé - et l’Outaouais n’y échappe pas. C’est extrêmement préoccupant. D’autant plus que nous, les adultes, n’avons le plus souvent aucune idée de ce qui se passe vraiment dans la tête et dans la vie de nos enfants.
Ces mots qui font mal (parfois)
Didier Périès
Oui, chaque mot est important, particulièrement dans les sphères du pouvoir, parce que chaque terme est choisi. Il a un sens, un poids, un impact.
Les mots peuvent faire mal, comme des armes. Pensez à Donald Trump, le président des États-Unis, mais surtout un intimidateur de premier ordre ! Son arme principale, ce sont les déclarations tous azimuts, à l’emporte-pièce, souvent des attaques personnalisées amplifiées par les médias sociaux : « Crooked Hillary » contre Hillary Clinton, lors de sa première campagne électorale en 2017 ; « sleepy Joe » pour Joe Biden, répété à l’envi, pendant la présidence de ce dernier ; « Pocahontas » à propos de Kamala Harris, dans la dernière campagne, en 2024… L’ironie en ce qui concerne Trump est que ses adversaires ont commencé à l’imiter, avec grande efficacité (parce qu’il n’y a rien de pire pour un intimidateur à l’ego surdimensionné que de devenir à son tour la cible) : TACO (pour Trump Always Chickens Out) est son surnom désormais. Taco a de la chance, parce qu’on ne s’attaque qu’à ses actions, nullement à son intégrité physique, ce qui serait facile. Ainsi, à la vue du teint orangé de son visage trop maquillé, comment ne pas penser à une carotte ? Au fond, les mots ne peuvent blesser que si la victime y accorde de l’importance.
Par ailleurs, les mots peuvent tromper, comme des masques. Dans ce cas, impossible de les ignorer, il faut même les décrypter. Un exemple ? Mark Carney, lorsqu’il aborde la question de l’énergie, un enjeu crucial dans notre quotidien, aux répercussions à moyen long terme incommensurables. Il déclare : le Canada est « parfaitement placé pour devenir la superpuissance énergétique mondiale, tant dans l’énergie propre que dans l’énergie traditionnelle ». Outre le ton hyperbolique, que l’on retrouve souvent chez l’ambitieux ex-banquier, on peut s’interroger sur ce qu’il entend par « énergie traditionnelle », surtout quand juxtaposé à « énergie propre ». Bon, cela ne prend pas un bac en linguistique pour comprendre qu’il parle des énergies fossiles, qui sont la cause de 90 % de l’augmentation des GES aujourd’hui. Mais, s’il n’y prête pas attention, le citoyen lambda pourrait avoir l’impression que notre premier ministre libéral ne penche pas spécialement pour le développement de l’industrie pétrolière et gazière ; ce qui est tout le contraire. Nous venons de nous en faire passer une petite vite.
Cependant, on dit qu’une image vaut mille mots… Pourquoi pas ? Si je vous dis « crime de guerre », « crime contre l’humanité » qu’affamer toute une population — jusqu’aux enfants — tout en l’empêchant de quitter un territoire donné ; pire, en faisant en sorte que l’aide alimentaire provienne des personnes mêmes qui la persécutent, cela reste abstrait pour vous. Normal. Mais si je vous montre une courte vidéo d’un garçon de 10 ans, aux joues creusées, aux yeux démesurément grands dans son petit visage d’enfant, qui demande pourquoi il n’a rien à manger avec la dernière énergie qu’il lui reste, et pour exemplifier son propos, se baisse et ramasse une poignée de sable qu’il mange devant vous, alors là, peut-être, serez-vous choqué-e.
On l’apprend dès le plus jeune âge : les mots ne sont pas anodins. Et dépendant du contexte de communication, ils peuvent faire très mal… ou au contraire beaucoup de bien. C’est peut-être à cela que nous devrions réfléchir davantage quand nous ouvrons la bouche !
L’écoblanchiment ou comment détourner nos économies
Didier Périès
Parlons un peu finances, parce que, si nous avons l’impression d’en avoir moins dans les poches aujourd’hui qu’hier, on nous dit également qu’il n’y a pas assez d’argent quand vient le temps de payer pour des transports publics, une meilleure éducation pour nos enfants ou simplement pour accéder à un médecin. Quant à prévenir l’aggravation de la crise climatique, n’en parlons pas !
Dernièrement, la capitalisation sur les places boursières de nos pays n’a jamais été aussi haute, ce qui signifie : des montants astronomiques échangés (et non taxés), et des bénéfices incroyables pour les détenteurs d’actions (très peu taxés en comparaison avec les impôts sur le revenu du travail). Dois-je aborder la question des salaires des « stars », du sport à la musique, en passant par la technologie ou celle des paradis fiscaux ? Dans une époque où les états, les pouvoirs publics, peinent à équilibrer leurs comptes, l’argent ne manque pas. Y compris et surtout dans les états pétroliers, comme ceux de la péninsule arabique… ou en Azerbaïdjan, où se déroule la COP 29.
Là, cette fois encore, la montagne accouche d’une souris, même si on y a parlé finances, parce que les pays du Sud réclament à cor et à cri un dédommagement pour les dégâts historiques – et actuels - infligés par les pays du Nord global. En effet, ils subissent plus que jamais notre mode de développement extractiviste, et leurs plus gros impacts environnementaux : submersion des îles dans le Pacifique ; pluies et inondations diluviennes en Asie forçant des déplacements de population massifs ; désertification du continent africain et de plusieurs régions en Amérique du Sud. Grosso modo, la moitié des GES dans le monde provient de l’exploitation et de notre production/consommation des énergies fossiles.
Il faut donc réduire notre utilisation des hydrocarbures pour infléchir la croissance exponentielle du réchauffement climatique. Et la « bourse du carbone », soit payer pour pouvoir polluer, n’est qu’une fausse solution, dont l’effet dissuasif n’est pas prouvé. Les projections réalistes aujourd’hui sont au-delà de 3 degrés. Le Canada lui-même, troisième plus grand pollueur par habitant au monde, en est seulement à 7 % de ses objectifs de réduction de GES pour 2030.
Alors, que les COP se déroulent maintenant dans des états non seulement producteurs de pétrole, mais qui s’en vantent, défie l’entendement. Cela explique que nous nous y intéressons de moins en moins. Allô ! Personne ne vous écoute plus, votre déclaration finale est couverte par le fracas des armes des différents conflits armés dans le monde, et par le smog des incendies et de la pollution ! Seuls quelques ministres et beaucoup de lobbyistes propétroles (grassement payés par des subventions financées à même nos impôts pour la « transition énergétique ») se sont rendus Azerbaïdjan. Quelle blague ! On nomme cela l’écoblanchiment.
La solution n’est pas dans le « gros bon sens », mais plutôt dans les données scientifiques et des solutions inévitables et soutenables. Comme une véritable reddition de compte par les entreprises sur leurs données environnementales, comme une véritable taxation verte « pollueur-payeur », comme un véritable encadrement règlementaire des « fonds ESG » (ou climatiques), censés ne contenir que des compagnies socialement et écologiquement responsables, mais parmi lesquels seuls 5 % le sont. Après vos impôts, regardez un peu où va votre argent déposé à la banque, vous pourriez être surpris.
Merci, monsieur de La Bruyère !
Didier Périès
Kriménos a appris son métier derrière les portes closes. D’un naturel plutôt réservé, le calme qu’il affiche en toutes circonstances n’empêche pas ses idées de tourbillonner jusqu’au vertige dans sa tête. Pourtant, il parait posé et réfléchi : il parle lentement, sans jamais élever la voix, acquiesce très souvent d’un discret signe de tête et marque rarement son désaccord. Le seul écart au décorum qu’il s’autorise est un clin d’œil de temps à autre, mais le plus souvent mal à propos. La spontanéité est pour lui contre-nature.
Il s’est présenté opportunément pour obtenir la mandature suprême, alors que son parti était en crise, et la situation économique plus précaire que jamais. Oh, mais n’est-il pas justement de ses rares individus sur la planète qui font la pluie et le beau temps par leurs politiques monétaires ? N’est-il pas le mieux placé, parce que dans tel ou tel conseil d’administration d’un grand groupe financier transnational ? Il est vraiment le candidat idéal, bientôt plébiscité par la foule désespérée, encline à idolâtrer toute figure de sauveur. Mais il ne rendra jamais public sa fortune ou son goût immodéré pour l’évitement fiscal ; cela ferait inutilement tache sur le beau costume sur mesure qu’il a enfilé pour la cause politique.
Habituellement, aux yeux du monde, qui se fie au ton de sa voix et à son air grave, il ne saurait être question que de sujets sérieux dans les discussions de Kriménos. En réalité, il n’échange jamais en public sur les enjeux cruciaux. En privé, il reçoit, donne audience et congédie.
Lorsqu’il ouvre la bouche, les mots qui en sortent sont à la fois civils et hautains, signe indéfectible de son appartenance à l’élite internationale. Il affiche volontiers une sorte d’honnêteté impérieuse qui peut forcer le respect auprès du petit peuple, impressionné par tant de compétence affichée. Cependant, il use souvent d’hyperboles pour asséner ses objectifs dans ses discours : « Le pays retrouvera sa grandeur, mieux, la sublimera, en exploitant ses meilleurs atouts, il faut le croire : avec moi, le succès est garanti ! ».
En vérité, Kriménos est plein de lui-même, ne perd jamais ses intérêts de vue et ne sort point de l’idée de son grand destin, de sa charge, de l’opportunisme qui l’a conduit à la plus haute fonction politique au pays. Il veut être grand – il le croit — aussi grand que tous les « grands » qu’il a fréquentés depuis des lustres : mener le monde financier ou un pays depuis son bureau en haut d’un gratte-ciel, côtoyer les dieux de l’économie, n’est-ce pas, après tout, son destin ?
Parfois, il réunit les plus distingués dirigeants internationaux dans le paysage majestueux des montagnes de l’ouest ; n’est-ce pas le moins qu’il puisse faire ? Il parade : il est dans son élément et tout le monde le sait ! Doit-il faire un communiqué commun destiné au public ? Seule sa version sera partagée. Veut-il distraire ses invités ? Ce sera un concert privé pour les privilégiés. Dissimuler est un art, être transparent, une faiblesse.
La vie est pour Kriménos une scène de théâtre sur laquelle il faut rester masqué : nourri dans le faux, il ne hait rien tant qu'être naturel.
D’ailleurs, pas plus intéressé par l’urgence climatique que par les relations humaines, il ne jure que par la production, la croissance et l’économie.
Libérez-nous des caquistes!
Didier Périès
Alors, comme ça, après avoir sabré dans le budget de la santé, on profite des vacances scolaires pour faire des annonces identiques en éducation ? Dans ce contexte, on affirme qu’« oser parler de coupures [en éducation] » serait « ésotérique » ? Et on feint de s’étonner que le déficit du Québec soit moindre que prévu ? Bizarre, parce que vu d’en bas, couper dans les dépenses réduit la dette de manière mécanique, c’est évident. Le budget 2024-2025 devrait être déficitaire de 11 milliards de dollars, il l’est désormais de 7,3 milliards. De quoi relever la cote de crédit du gouvernement, certainement, mais à quel prix ? Mesdames et messieurs, applaudissons le ministre Girard, et son effort incroyable pour économiser sur notre dos plus de 3 milliards de dollars, grâce à des coupes historiques en santé et en éducation.
Les caquistes, comme avant eux les libéraux, tenteront de vous rassurer : ce n’est rien d’autre qu’un peu de rigueur budgétaire, cela n’entrainera pas de réduction de services, ni en santé, pour les patients, ni en éducation, face aux enfants. En tout cas, eux ont simplement demandé de « faire des efforts ». Petits coquins, va ! Ils ont juste informé les CIUSS, les centres de services scolaires, et tous les paliers des systèmes de santé et d’éducation, de fonctionner avec des budgets nettement réduits. Quand je dis « demandé », ce n’était pas une suggestion… Mais pas de coupures ou de bris de service s’il vous plaît ! Les patients ou les élèves restent la priorité !
Ainsi, en éducation, ce sont 550 millions que les centres de service scolaire vont devoir trouver et faire disparaitre d’ici un an ; les déficits n’étant d’ailleurs plus permis non plus. Où va-t-on bien pouvoir économiser ? Le fonctionnement de l’école (chauffage, climatisation, lumière) ? Le personnel administratif et technique (l’huile dans le rouage) ? La restauration ? Le personnel de soutien (bonne chance si vous avez un enfant avec des besoins particuliers !) ? Le personnel enseignant (et pourquoi pas des classes de 40 ou 50 élèves ?) ? La rénovation des bâtiments, salles de classe, gymnases, piscines ou terrains d’extérieur ? Mieux, les activités parascolaires et les sports, après tout, les enfants ne viennent-ils pas à l’école pour apprendre les matières fondamentales, surtout ? À bien y penser, les possibilités sont multiples. Un seul détail cloche : les apprentissages seront directement ou indirectement impactés, à court, moyen ou long terme, aucun doute !
Plus concrètement, voici des extraits d’un message envoyé par le CSSPO aux parents, avec pour titre « Informations importantes sur le contexte budgétaire 2025-2026 »… On y parle de « contexte […] difficile », de « compressions majeures », de « répercussions importantes sur l’ensemble des services », à hauteur de « 11 381 834 millions de dollars », sans compter « l’indexation des coûts de système pour les dépenses autres que salariales », tout en rappelant que « 76 % [du] budget est consacré à la rémunération du personnel » et que le nombre d’élèves augmente ! Bref, une « réorganisation [des] services est à prévoir dans tous les secteurs ». Pas besoin d’interprétation.
Mais pourquoi au fait ? La question est cruciale, d’autant plus que François Legault est difficile à suivre… Est-ce par idéologie fiscale ? Ou au contraire par pragmatisme ? Une simple tactique politique ? Tel un pompier pyromane, le gouvernement caquiste veut-il passer pour un sauveur, à l’approche des élections et lâcher les dépenses, l’année prochaine ? Tous les moyens semblent bons pour rester au pouvoir.
La bombe numérique
Didier Périès
Ça y est, les vacances scolaires ont commencé pour de bon, avec les camps qui battent leur plein, les horaires d’été pour nos jeunes qui, sans devoirs, peuvent se coucher plus tard, dormir plus longtemps le matin… et même s’ennuyer. On les penserait presque trop inactifs. Or, pour la plupart, mais dites-le-moi si je me trompe, actifs, ils le sont, au moins face à un écran. Ces écrans qui peuplent leur existence (et la nôtre), avec en tête, le téléphone, mais également l’ordinateur, la console de jeux (sur la télévision) ou encore la tablette. Lire un livre ? Faire des devoirs de vacances ? Aller s'amuser dehors ? Partir en vélo rejoindre ses amis ? Pratiquer un sport d’extérieur estival ? Les options sont nombreuses, mais… Mais, ai-je besoin de continuer ?
Malheureusement, le véritable problème existentiel n’est pas là, même si le temps passé sur Internet et l’emploi d’outils numériques constituent aussi un enjeu de santé publique majeur, autant physique, mental qu’intellectuel. Je vous parle plutôt des conséquences environnementales de la généralisation du numérique dans nos vies. Nos gouvernements actuels, autant provincial que fédéral, reculent déjà sur les mesures nécessaires pour réduire les GES (causes du réchauffement de la planète et des océans), qu’allons-nous donc faire dans cette galère supplémentaire qu’est l’intelligence artificielle (IA) ?
Ainsi, l’Infonuagique, c’est-à-dire la poursuite de l’illusion que l’on peut tout stocker (photos, vidéos, documents et traces en tous genres), sans jamais éliminer quoi que ce soit, sans trier ; que l’on accumule sans limites ces données sur des serveurs de plus en plus puissants, donc de plus en plus énergivores, est un miroir aux alouettes terrible ! La simple accumulation de nos courriels — j’ai fait l’addition de mes quatre boites de réception, pour arriver au chiffre effarant de 50 000 ! — est un symptôme patent de notre inconscience : nos courriels sont virtuels, certes, mais ils sont gérés, stockés par d’énormes serveurs un peu partout sur la planète qui, eux, sont très couteux à fabriquer à tous points de vue, consomment de plus en plus d’eau (pour les refroidir) et d’énergie et qui nécessitent des infrastructures de réseaux tout aussi dispendieuses.
Quant à l’IA, d’où tire-t-elle sa mégapuissance de traitement de l’information d’après vous ? Même sans cette dernière, l’« empreinte numérique » équivaut sans problème à la pollution de l’aviation civile dans un pays comme la France (Agence de la transition écologique). Et ces émissions devraient augmenter de 45 % d’ici 2030, prévisions faites encore sans la contribution des intelligences artificielles génératives, que l’on utilise en ce moment à tout bout de champ, pour à peu près n’importe quelle tâche, même la plus inutile ou superficielle…
À ceux et celles qui croient que c’est cette même technologie dévoreuse de minerais rares, énergivore et polluante, qui nous sauvera, je dis : vous êtes encore dans une illusion qui nous empêche d’avancer vers la seule véritable solution : la sobriété, ou si vous préférez, une consommation différente, plus consciente, plus qualitative que quantitative. Ne suivons pas comme des moutons de Panurge les décideurs, nos politiciens, souvent influencés par des multinationales cupides, peu soucieuses de l’avenir de l’humanité. Une telle inaction climatique, que dis-je, une telle négation des décisions à prendre, est tout simplement criminelle. Lorsque la population en prendra massivement conscience, nos élites exécutives devront faire face aux plus grands procès de l’histoire humaine.
Avis au public : nous encourageons la réutilisation, pas l’abus!
Le Bulletin d’Aylmer cessera de déposer les anciens exemplaires du journal à l’extérieur du bureau pour que le public puisse en prendre afin de les utiliser à la maison. Nous retirerons également les exemplaires du plus récent numéro du journal. Dorénavant, le public est prié d’entrer dans le bureau pour se procurer le nouveau journal et, au besoin, quelques-uns des vieux exemplaires dans les piles à usage domestique.
Oui, il est préférable de réutiliser les vieux journaux plutôt que de les mettre dans le bac bleu. Mais l'équipe du Bulletin en a assez de consacrer du temps et de l'énergie à surveiller les exemplaires du journal placés à l'extérieur du bureau.
Les gens utilisent le papier journal dans leur jardin, pour leurs animaux domestiques, pour allumer leur poêle à bois et pour tapisser leur bac à compost. Nous sommes heureux de faire partie de ce cycle de réutilisation. Sauf quand il y a abus.
Au fil des ans, nous avons vu des gens s'emparer de piles de nouveaux exemplaires du journal (qui est très coûteux à produire!). Récemment, quelqu'un est parti avec tout le contenu de la boîte de vieux journaux – y compris la boîte!
Assez, c'est assez. Étant donné que la production de journaux imprimés est en chute libre dans tout le pays, il est logique que les gens ne puissent pas en trouver pour leur usage domestique. Cependant, vider nos rayons de tous les exemplaires n'est pas la solution.
L’éditrice
Jeter des ponts
Didier Périès
J’ai été frappé en effet par cette tendance redoublée qu’ont nos gouvernements à bâtir des ponts. J’aurais pu y ajouter des oléoducs, des gazoducs et autres trucs. Bref, ces fameux grands projets d’infrastructures. Selon eux, la réponse qui tombe sous le sens : les mesures tarifaires de Trump, appuyée par rien de moins qu’un groupe d’« experts » dirigé par l’ancien président de la chambre de commerce du Canada, un homme d’affaires donc. Difficile de rétorquer à ce « consensus remarquable » de nos décideurs politiques et économiques. Ces derniers nous ont d’ailleurs convaincus qu’il s’agissait de la menace existentielle du moment. Et comme cette épée de Damoclès — économique — serait la plus dangereuse, il n’y aurait qu’un seul bouclier — tout aussi économique — pour s’en défendre : construire, construire, construite, pour relancer une croissance poussive, qui automatiquement créerait des emplois, donc augmenterait notre capacité à consommer, donc nous enrichirait et tout le monde serait heureux. Forcément. Mais n’est-ce pas ce que le Canada fait déjà depuis qu’il existe ? Extraire des ressources naturelles non ou difficilement renouvelables (bois, minerais, énergies fossiles et hydrocarbures, etc.) pour les transformer (OK, on pourrait le faire davantage ici), avant de les exporter, tout cela à grand coût climatique ?
Nous allons donc construire plus de ponts. À commencer à Québec, où, après des années de tergiversations, d’études, de sondages, de tracés divers, un Legault fatigué en fait son nouveau cheval de bataille en vue des élections de 2026, après l’échec retentissant de la filière batterie et bientôt l’avortement du projet « Grand Nord ». On réinjecte 275 millions pour de nouvelles études (équivalent à la moitié des coupes en éducation). En plus, la ministre Guilbault veut le « protéger » des prochains gouvernements et le rendre irréversible. Pourtant, le trafic diminue entre les deux rives ; les conducteurs ne gagneraient que deux-trois minutes dans les bouchons ; ouvrir un pont inciterait plus de gens à prendre la voiture, majoritairement en solo, donc augmenterait pollution et engorgement ; tout un écosystème, et même du patrimoine bâti en subirait les conséquences pour longtemps. Et pourquoi pas en plus un gazoduc ou un oléoduc dans notre jardin ?
Ici, dans la région, on veut un pont d'ici 2034 (et pourquoi pas deux tant qu’à faire?). Un à l’est de Gatineau, l’autre à l’ouest, alors que le pont Alexandra, au lieu d’être reconverti à moindre coût en voie cycliste et piétonne, sera reconstruit à grands frais. On peut discuter des détails, qui restent parfois des enjeux cruciaux (le tracé, les matériaux, les voies d’accès, la connexion avec des pistes cyclables ou réservées, les expropriations et autre réaménagement urbain), le problème fondamental reste que l’on va inciter la population à utiliser la voiture encore davantage. Comme s’il n’y avait pas de meilleurs moyens, moins cher, plus soutenable, d’améliorer la mobilité interprovinciale! Combien d’argent dépensé dans des projets aux coûts faramineux, qui augmentent par ailleurs de 13 % en moyenne par an ? Mesdames et messieurs des gouvernements, vous voulez construire et augmenter notre qualité de vie ? Bien : au lieu de subventionner les entreprises de construction directement, devenez les maitres d’œuvre de logements à coûts modérés en permettant aux gens de travailler depuis chez eux ou dans leur secteur de la ville. Investissez massivement dans la santé et l’éducation. Lancez le « Chantier du siècle » pour combattre la précarisation et l’appauvrissement des Canadiens.
Beignets, Gumbo, muffulettas et jambalaya
Didier Périès
J’ai eu l’opportunité de passer aux États-Unis une semaine. À l’encontre de ce que je me suis promis depuis une dizaine d’années, je l’avoue, et par pur intérêt personnel : c’était à La Nouvelle-Orléans. Un événement professionnel de trois jours, en plein centre de « Nola », que j’ai prolongé de quelques jours.
Partons de mes impressions générales et positives. Comme Canadien d’origine française, j’ai adoré déambuler dans le « Vieux quartier » et profiter de la variété architecturale du centre-ville. Les apports espagnols et français, notamment, y confèrent un charme certain ; et je me suis senti en Europe du Sud, avec tous ces balcons, ces terrasses, ces fenêtres aux volets multicolores… et ces noms de rues aux accents familiers. La chaleur humide aidant, le rythme de vie semble moins frénétique que dans d’autres villes de taille équivalente. On se déplace plus lentement ; une espèce de nonchalance bien agréable prend le dessus. Ce qui n’empêche pas les habitants de travailler fort, pendant de longues journées, pour gagner leurs 7,25 USD l’heure : les commerçants (d’alimentation) auxquels j’ai parlé débutaient leur journée à 6 h et la terminaient à 8 h, quasiment non-stop. Il est vrai que les nombreux touristes participent à cette ambiance de villégiature ; les États-Uniens, surtout des états voisins plus conservateurs, comme les Texans, s’y rendent en grand nombre, pour pouvoir user et abuser des « divertissements » nocturnes qu’offre la « Big easy » ; des plaisirs qu’ils se refusent chez eux, jouent les vierges effarouchées et votent Trump !
Mais pour être franc, au bout de six jours, j’étais carrément en surdose. Surdose de malbouffe (pour les voyageurs, tout est gras et très salé ou sucré, les légumes ou les fruits sont rares). Surdose de gros : « big is beautiful » signifie littéralement que tout est plus grand et gros ; les distances, les lieux, les portions de nourriture… les gens. Phénomène urbain et symptôme de nos sociétés du Nord global, l’obésité saute aux yeux… Elle est un problème de santé publique. Enfin, surdose de religion ; j’ai eu le malheur de me retrouver au beau milieu d’une convention annuelle de la jeunesse luthérienne américaine. Pouvez-vous imaginer combien de ces jeunes blancs (à 95 %) aux t-shirts multicolores, mais déclarant uniformément leur foi en Jésus, se trouvaient rassemblés ? 20 000, répartis dans des centaines de groupes, dont beaucoup dans mon hôtel. Où que ce soit, impossible de leur échapper. Le contraste était saisissant avec l’histoire et la culture créole, métissée, qui caractérise La Nouvelle-Orléans. Le nom de l’évènement ? Vous allez rire (jaune) : « Endure »… Pour moi, il y a quelque chose de malade au sud de notre frontière.
J’ai aussi pu discuter avec d’autres enseignants, pour la plupart étatsuniens d’ailleurs. Le constat est pitoyable quant à la direction que prend l’éducation, malgré des programmes comme le bac international. Le système public était déjà largement sous-financé et assez conservateur dans son approche, traditionnellement — surtout dans les états du sud et du centre — c’est aujourd’hui pire encore. Une vraie régression qui touche même les plus hautes instances de l’Organisation du Baccalauréat International : Michele R., la responsable mondiale en chef de la diversité, de l’équité et de l’inclusion (DEI), est maintenant devenue « Responsable mondiale des opportunités et de l’appartenance ». Si une image vaut mille mots, un changement de lexique peut aussi dire beaucoup.
Canicule, climatisation et compagnie
Didier Périès
J’ai eu le malheur (le bonheur) de me retrouver dans le sud-ouest de la France pendant la récente canicule. Mais qu’est-ce une « canicule » ? Ce terme assez récent est désormais rentré dans le langage quotidien, il a même sa définition dans Wikipédia : « une canicule désigne un épisode de températures exceptionnellement élevées, caractérisé par des températures très chaudes durant plusieurs jours et nuits consécutifs ». Chaudes comment ? La réponse est subjective. Dans les environs de Toulouse, le jour, nous avons subi des 35 à 40 degrés Celsius, et la nuit, jamais en dessous de 25 degrés, plus près des 30. Et cette séquence a duré une bonne semaine !
Il faut avouer que l’on s’habitue à cet état de fait qui, d’exceptionnel, est devenu courant, fréquent. Et on s’y adapte… comme à tous les changements climatiques ! Avons-nous le choix ? Beaucoup vous diront « non, il faut s’y faire ! ». Or, nous avons tout de même le choix de la réponse à ce phénomène extrême, qui va aller s’amplifiant et provoquer d’autres conséquences néfastes : déshydratation, coup de chaleur, aggravation de maladies respiratoires. Cependant, la pire est l’accroissement de l’utilisation de la climatisation.
En effet, au lieu de nous adapter en réfléchissant stratégiquement, en nous informant davantage aux effets à long terme qu’à notre confort à court terme, partout, l’Humanité refroidit son environnement à coups de climatiseurs. Or, les systèmes de refroidissement que l’on retrouve dans les magasins comme à la maison polluent de plusieurs manières. Ils utilisent des fluides (CFC, HFC…) qui, relâchés dans l’atmosphère, s’ajoutent aux autres gaz créant l’effet de serre ; ils font grimper la facture énergétique, puisqu’ils fonctionnent à l’électricité (10 % de l’électricité mondiale), qui, elle-même, provient de la combustion de sources fossiles ; comme toute technologie, les climatiseurs vieillissent, leurs composants s’encrassent, perdent de leur efficacité et, en fin de compte, polluent plus, notamment en émettant encore plus de GES qu’en début de vie ; enfin, plusieurs de ces systèmes libèrent des polluants organiques volatils et des particules qui réduisent la qualité de l’air l’intérieur. Bref, ils ne sont vraiment pas la bonne réponse aux épisodes de canicule. Pas plus que la plupart des technologies que l’on nous présente pour des solutions à la crise climatique, alors qu’elles y contribuent, soit par leur production, soit par leur mise en application.
Il existe d’autres options, tel que le « free cooling » ou air gratuit en français. Il s’agit en fait d’utiliser la ventilation naturelle des bâtiments, par exemple en créant un courant d’air par l’ouverture de fenêtres pendant la nuit, lorsque l’air extérieur est plus frais que celui à l’intérieur. Vous me rétorquerez que c’est évident et que tout le monde l’applique. Pas certain. En tout cas, cette méthode est naturelle, basée sur une ressource renouvelable et disponible en grande quantité. Et surtout, on peut l’associer à d’autres moyens : les échangeurs de chaleur, les tours de refroidissement, les puits ou les planchers refroidissants, tous moins énergivores qu’un climatiseur. Pensez à votre facture d’électricité.
Ce qu’il faut retenir ? Si nous voulons éviter de contribuer aux futures canicules en pensant les contrer, ne nous laissons pas berner par les offres de solution commerciales les plus courantes, soyons proactifs et leaders. Montrons l’exemple à nos enfants en nous tournant vers des options plus naturelles, plus soutenables et au final, moins couteuses!
Place au plurilinguisme!
Didier Périès
Les débats autour de la langue au Québec (et avec le ROC) sont dus pour une bonne part à une confusion dans les termes, qui s’ajoute aux crispations culturelles, parce que la langue possède par définition une dimension identitaire. Cependant, pour commencer, admettons que nous sommes une majorité dans la société canadienne contemporaine à pouvoir communiquer oralement dans plusieurs langues (indépendamment de leur statut) ; la lecture ou l’écriture relevant de compétences distinctes et d’un degré de difficulté souvent plus élevé. Nous sommes « plurilingues » (ou « multilingues »). Est-ce grave, docteur ? Non.
En vérité, l’enjeu crucial pour l’avenir de la société québécoise est le suivant : nous, Québécois, ne pourrons progresser dans la concorde (au sein ou hors du Canada, ce n’est pas non plus tout à fait le débat ici) que si nous prenons en compte la nouvelle réalité démographique et donc linguistique de notre belle province. Rien d’idéologique jusque-là, regardons les faits.
Aujourd’hui, notre croissance démographique provient essentiellement de l’immigration. Et d’où viennent les immigrants francophones au pays ? D’après la recherche universitaire, parmi les 10 premiers pays d’origine des immigrants permanents, l’an dernier au Québec : le Cameroun, la Tunisie, l’Algérie, le Maroc, Haïti, la Côte d’Ivoire et le Liban. On observe une tendance, qui se confirme dans notre région : l’immigration africaine. Notez au passage que le français joue parfois ce rôle entre différents peuples africains : à la base, ils sont donc plurilingues. C’est sans parler des immigrants non francophones, dans la mesure où ils sont scolarisés automatiquement (ou presque) en français, et donc s’intègrent tout naturellement…
Le statut de langue officielle, lui, met de l’avant l’outil de communication administratif, étatique, à travers ses institutions et dans les organismes — juridiques, de santé, d’éducation, etc. — qui structurent notre vie quotidienne. On peut très bien imaginer que, dans la rue, d’autres langues prennent le pas (sans affaiblir la maitrise des langues officielles), quitte à rester « nationales », reliées à une vaste communauté sans être officielles. Il se peut même que des langues régionales, plus locales (« vernaculaires »), s’y ajoutent même (par exemple, le basque, en France). Tout cela, ce sont des langues véhiculaires, qui n’ont pas toujours de liens avec les langues d’étude…
Ou avec la ou les langues de nos parents, qui resteront « maternelles » à tout jamais, quel que soit notre niveau de maitrise. Chez les immigrants, elles peuvent devenir au fil des années et des générations un peu « folkloriques » (NDLA), mais n’en sont pas moins importantes à préserver pour leurs locuteurs. Là, il est question d’identité personnelle. Pourquoi faire semblant que tous ces différents statuts sont exclusifs les uns des autres, alors que la réalité est qu’ils se combinent ? Franchement, où est le problème si le français (ou l’anglais d’ailleurs) est chez certains langue première, seconde ou tierce, tant que leur maitrise est suffisante pour s’exprimer et comprendre, voire écrire, si l’emploi ou la fonction dans la société l’obligent ? Là, nous entrons dans notre identité sociale. Quant à l’identité culturelle, elle est à la fois composée d’un bagage qui provient de nos origines, de notre communauté en tant qu’enfant, mais aussi également de nos communautés, valeurs, modes de vie choisis comme adulte…
Finalement, nous, les Québécois, sommes probablement les personnes les plus multilingues du continent. Peut-on en être fiers et le célébrer ?
Le corps dans tous ses états
Didier Périès
L’été, le soleil, la chaleur, peut-être la plage ou la piscine… Les corps s’exposent, partout sur la planète, pour différentes raisons, selon des contextes et des cultures variées. Nous n’avons déjà pas tous le même rapport à notre corps, avec parfois des conséquences terribles, quand on évoque les maladies mentales qui peuvent en découler, alors, imaginez ailleurs. Par exemple, aux Canaries, où j’ai eu l’opportunité de faire un court séjour récemment.
Cet archipel volcanique, qui comprend sept îles principales, au large du Maroc, en plein océan atlantique, est une destination touristique bien connue. Que l’on s’y rende pour observer la faune et la flore, faire du surf, du trek, ou pour profiter de ses plages de sable fin et de sa vie nocturne, il faut admettre que le corps peut y exulter sous différentes formes. Par l’activité physique intense, sportive, ou en mode farniente, sur une serviette de plage. La particularité des Canaries, surtout à Gran Canaria, la plus grande de ses îles, est la coexistence des nudistes et des non-nudistes, les « textiles ».
Je tiens tout de suite à préciser que les naturistes sont différents des nudistes. En effet, le naturisme implique une sorte de philosophie de la vie globale, plus connectée à la nature et à notre état naturel, qui ne se limite pas à être tout nu-e dans certains endroits, comme c’est le cas du nudisme. En tout cas, aux Canaries, d’après mes observations, il s’agit bel et bien de nudisme, sur les plages, mais avec une certaine approche du corps visible en tout temps assez large. Certains, plus moralisateurs, appelleraient cela de l’exhibitionnisme. Est-ce mal ?
Deux conséquences : cela place les autres personnes en position de « voyeurs » ; se retrouver nu peut causer un sentiment de malaise et de culpabilité : on se sent en faute. Pourtant, quoi de plus naturel que d’être dans la tenue d’Ève ou d’Adam finalement ? C’est ce que j’ai testé… et franchement aimé, à part la gêne que la situation entraine, même si les autres, autour, sont dans le même état. Quel plaisir de se promener sans vêtements, sous la caresse de la brise ou du soleil, dans la fraîcheur revigorante de l’océan !
C’est possible ici, dans des endroits circonscrits, chez soi, au bord de sa piscine, mais pouvez-vous imaginer au Québec ou au Canada des endroits publics où le nudisme soit plus que toléré : intégré aux comportements sociaux sur des plages mixtes, par exemple ? Or, le corps nu ne trompe pas, il est une exposition crue de notre réalité physique, bref, une sorte d’introduction parfaite de la personne que nous sommes, au fond. Et, dans ce domaine-là, il y en a évidemment de toutes les formes, pour tous les goûts.
Je me suis pas mal interrogé à la suite de cette expérience, surtout parce que cette dernière a été suivie de très près par le décès d’un proche… et par l’exposition de son cadavre. Embaumé certes, arrangé, amélioré au point d’avoir les joues roses et le visage comme endormi. J’ai trouvé vraiment étonnant que l’on nie à ce point la mort, synonyme de disparition physique, que l’on veuille donner l’impression du sommeil. Un sommeil éternel. Je retrouve là encore une manière de nier la réalité de notre corps, une sorte de comportement contre nature.
Ironie de l’histoire
Didier Périès
Il y a peu, le conflit israélo-palestinien s’est invité aux activités de la fierté. En effet, des militants du collectif « Queers for Palestine » ont barré la route à la parade sur la rue Wellington, ce qui a entrainé l’annulation de la seconde moitié de ladite parade. Primo, il faut rappeler que cet événement s’inscrit dans un mouvement légitime de reconnaissance des personnes LGBTQ+, qui ont été historiquement invisibilisées, ostracisées et criminalisées. C’est rafraichissant, quand on voit la tendance réactionnaire et conservatrice actuelle à l’endroit des minorités sexuelles et de genre.
Mais « Queers for Palestine » avaient-ils le droit de le faire ? Les organisateurs de la fierté devraient-ils perdre leur financement, puisqu’ils ne sont pas capables de juguler de tels débordements ? Que vient faire la guerre entre le Hamas et Israël à Gaza dans la discussion sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre ? Plusieurs questions que certains se posent, pour des raisons fallacieuses parfois, qui masquent difficilement leur animosité envers les personnes qui ne répondent pas à l’hétéronormativité ambiante…
Il faut donc comprendre le concept d’intersectionnalité pour saisir comment on a pu en arriver là. Les personnes LGBTQ+ constituent une minorité dont les droits ont longtemps été reniés et qui, encore, subissent des injustices ; qui plus est, un désavantage peut s’ajouter à un autre lorsqu’on est, par exemple, une femme d’une minorité visible lesbienne ou queer. Comment ne pas se sentir proche d’autres populations niées dans leur existence, dans leur humanité même, et brimées ? Si les moyens utilisés pour se faire entendre sont discutables, le groupe « Queer for Palestine » fait preuve de compassion et ose défendre des valeurs qui nous sont communes, au fond.
Quoi qu’il en soit, si je vous lance : déplacements forcés, famine, apartheid, épuration ethnique, tactique terroriste (comme déclencher une première explosion et attendre l’arrivée des secours et des journalistes pour en lâcher une deuxième bombe), à quoi pensez-vous ? Et bien dites-vous que cela s’applique à la guerre que mène le gouvernement de Netanyahou à Gaza. Oui, oui, réfléchissez-y quelques secondes.
Et je dis bien Benjamin Netanyahou et son gouvernement d’extrême droite religieuse. En face de ces criminels de guerre, car il s’agit bel et bien de cela, d’autres extrémistes, dont la seule motivation est la destruction de l’État d’Israël et qui refusent obstinément de rendre les armes : le Hamas. Entre eux, le reste de la population gazaouie… et les autres Palestiniens de Cisjordanie, pris entre deux feux, littéralement.
Le pire est que Netanyahou et certains dirigeants politiques occidentaux ajoutent à la confusion en criant à l’antisémitisme dès lors que les actions de l’armée israélienne (Tsahal) sont dénoncées. Ils viennent nourrir un antisémitisme bien enraciné dans l’inconscient collectif européen, mais également chez beaucoup de musulmans dans le monde.
Répétons-le : ce qui se passe à Gaza et dans les territoires palestiniens est aujourd’hui le fait du gouvernement de Benjamin Netanyahou, un dirigeant criminel sous le coup d’un mandat d’arrêt international et d’une droite religieuse fondamentaliste qui le maintient au pouvoir depuis plusieurs années. Ces gens-là ne représentent ni les Israéliens (dans leur majorité) ni les juifs, pas plus que le Hezbollah, le Hamas, ou les Frères musulmans représentent l’Islam et les musulmans dans leur ensemble. Cessons les amalgames, faisons preuve de nuance, ne cédons pas à nos craintes irrationnelles et à nos haines ancestrales.
IA, quand tu nous tiens!
Didier Périès
Comble de l’ironie, le ministère de l’Éducation de Terre-Neuve-et-Labrador vient d’être pris en flagrant délit de manque d’intégrité dans l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA), dans un rapport sur la nécessaire modernisation de l’éducation, qui prônait notamment un meilleur contrôle de l’IA ! Des journalistes ont découvert qu’au moins quinze des sources citées étaient avaient été inventées de toute pièce par l’IA utilisée pour générer ce rapport!
Voilà où nous en sommes en ce début d’année scolaire 2025. La moindre requête via un moteur de recherche se fait inévitablement avec l’aide de l’IA aujourd’hui. C’est automatique, sans notre accord préalable et cela nous donne même une sorte de résumé qui a toutes les apparences d’un travail rigoureux, organisé et pertinent. Souvent un peu vague, en fait, si l’on y regarde bien, ce qui est la marque de fabrique des IA.
Certes un moteur de recherche comme Google prend soin de noter en petit « Les réponses de l’IA peuvent comporter des erreurs » et on trouve sur certains moteurs comme Qwant, la liste des sources employées, il n’en reste pas moins que nous devons comprendre qu’il faut impérativement faire preuve d’esprit critique et, au minimum, consulter les sources de ces informations, afin de vérifier leur existence et le statut de leurs auteurs. Notre paresse intellectuelle a des limites !
Ceci ne représente qu’un des nombreux enjeux reliés à l’utilisation de cette technologie censée nous rendre la vie plus facile. Un autre aspect est plus économique : comme toute technologie, cet outil remplace déjà l’humain dans plusieurs secteurs et branches d’activités.
De plus en plus d’entreprises déclarent sans remords préférer avoir recours à l’IA plutôt qu’embaucher une personne, notamment des jeunes diplômés. Face à une telle concurrence, il va devenir de plus en plus difficile pour nos enfants de s’assurer qu’avoir un diplôme soit suffisant pour décrocher un premier emploi. Surtout quand ces derniers déclarent avoir plus appris dans leurs six premiers mois de travail que dans leurs trois ou quatre années de baccalauréat. Est-ce à dire que le virage « professionnalisant » de l’université n’est peut-être pas la voie à suivre à l’avenir ? Ne vaudrait-il pas mieux équiper les nouvelles générations avec des « soft skills », des compétences transversales et un esprit critique et créatif, qui les rendent capables de s’adapter à des contextes professionnels variés ?
Un autre enjeu est la fausse impression que les résultats donnés par l’IA sont objectifs. Cette technologie a été programmée par des humains, ne l’oublions pas. Il s’avère, par exemple, que l’IA augmente les inégalités sociales, particulièrement envers les minorités et les femmes. L’IA est sexiste. Le documentaire IA. L’angle mort donne pour exemple la limite de crédit accordée aux utilisateurs de la carte Apple, différente d’un sexe à l’autre ; ou Amazon, dont le logiciel de recrutement excluait les femmes ; ou bien encore le fait qu’une simple recherche d’images à partir du mot « pilote » débouche sur des photos d’hommes uniquement… Est-il encore utile que je parle de l’hyper sexualisation des femmes ou des hypertrucages (deepfake) ?
Contre cela, interdire l’usage d’internet ou des médias sociaux ne fera rien, seul le développement de l’esprit critique de nos jeunes pousses dès que possible et le respect d’une véritable intégrité intellectuelle pourront diminuer les impacts négatifs de l’intelligence artificielle.
Après tout, elle n’est qu’un moyen et non une fin en soi.
Attention! Criminels climatiques!
Didier Périès
Le 23 juillet dernier, la Cour internationale de justice (CIJ) a émis un « avis consultatif sur l’obligation des états en matière de changement climatique », en réponse aux questions de l’Assemblée générale de l’ONU. En effet, une résolution avait été adoptée le 23 mars, qui lui demandait cet avis. Le mot « consultatif » est important, puisqu’il n’a pas force de loi a priori ; il n’est pas un jugement.
La CIJ a pour mission de donner des avis et régler les conflits juridiques soumis par les états, sous le couvert de l’Assemblée générale de l’ONU, à laquelle sont représentés tous les pays de la planète. Créée par la Déclaration des Nations unies en 1945, elle a comme langues officielles le français et l’anglais. Elle est indépendante, collégiale, impartiale et dispose d’une compétence universelle ; 15 juges élus pour 9 ans y siègent de manière permanente.
Plus exactement, on parle des sujets suivants dans le texte de la CIJ : « la protection du système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques [ndla : créées par l’être humain] de gaz à effet de serre ». Vous noterez que c’est assez large pour couvrir la grande majorité des pollutions, de l’air et de l’eau en tout cas, ainsi que les conséquences du réchauffement climatique dû aux GES. La CIJ précise que ces obligations valent « pour les « états et pour les générations présentes et futures. »
Si, malheureusement, sa juridiction est seulement acceptée par 58 états (parmi lesquels le Canada, mais ni les États-Unis, la Chine ou la Russie), elle a tout de même par son avis autorisé les poursuites judiciaires pour les changements climatiques, ce qui, de facto, fonde la catégorie de « criminel climatique » à l’échelle d’un pays… ou d’un gouvernement.
Qu’il s’agisse de « petits États insulaires en développement » — qui auront disparu d’ici 100 ans — des « peuples ou des individus […] atteints par les effets néfastes des changements climatiques », nous avons, vous avez désormais le droit d’intenter des procès à nos dirigeants politiques pour leur inaction climatique, voire pour leur responsabilité dans la crise que l’on connait. Une crise, rappelons-le, existentielle pour l’être humain, à court terme, et a fortiori pour le Canada et le Québec.
La CIJ reconnait que les traités relatifs aux changements climatiques, comme ceux de Kyoto ou Paris, imposent des obligations contraignantes ! Les états doivent adopter des mesures, être à l’avant-garde pour atténuer l’augmentation des GES. Ils doivent également coopérer les uns avec les autres et tout faire pour atteindre (revenir, parce dépassée dans plusieurs régions du globe) à une hausse maximale de 1,5 degré d’augmentation de la température moyenne planétaire. Notamment, ils doivent « prévenir les dommages significatifs à l’environnement » et « garantir la jouissance effective des droits de l’homme ».
Oui, mesdames et messieurs nos décideur-e-s, vous êtes désormais imputables pour la détérioration de notre santé à cause de la piètre qualité de l’air, de la pollution des sols, des canicules ou pour la perte de nos maisons suite aux feux de forêt et aux inondations. Oui, vous êtes potentiellement des criminels climatiques dont les mesures économiques ou sociales sont jugées illicites, c’est-à-dire contraires à la loi.
Cessez de nous enfumer avec vos « priorités économiques » et vos dépenses outrancières dans le réarmement du pays, car vous devenez alors le risque majeur menaçant nos vies.
Flemme climatique
Didier Périès
En fin de semaine dernière, j’ai préféré regarder la finale de la coupe du monde de rugby féminin, au lieu de manifester pour la planète. La semaine dernière, j’ai lancé un modeste « J’accuse… » contre nos grands dirigeants, qu’ils soient politiques, économiques ou financiers — souvent les trois en même temps, à l’image de nos premiers ministres, Mark Carney et François Legault. Mais il faut l’avouer, nous avons aussi des devoirs.
Si les entreprises pétrolières connaissent leur responsabilité dans le trou de la couche d’ozone et la production de GES depuis le début des années 1970, la majorité population n’en a pris conscience que dans les deux dernières décennies. Depuis, le mouvement écologiste a montré qu’il n’était plus un groupe de « pelleteux de nuages », même si certains voudraient les cantonner dans cette catégorie. Aussi bien comme partis politiques — surtout en Europe — qu’ONG (Greenpeace, Équiterre, etc.), les écologistes ont retroussé leurs manches, mis leur culotte et ont pris leur responsabilité. Ils sont l’émanation d’une certaine volonté de la société civile, du désir, de l’urgence de faire quelque chose plutôt que de rester témoins muets et angoissés de la dégradation de nos conditions de vie.
Un problème demeure : le train climatique dans lequel nous nous trouvons est lancé à grande vitesse, et nous devons freiner impérativement sa course. Vraiment ralentir. C’est possible. Et y embarquer le plus de gens possible, plutôt que de les laisser sur le bord, victimes des marasmes qui s’en viennent.
Ce que je trouve personnellement étonnant, ce sont nos conduites individuelles. On dirait que nous avons atteint un palier au niveau des comportements à adopter : nous roulons davantage en vélo, nous recyclons (plus ou moins), nous réduisons l’usage des plastiques, nous achetons « biologique » ou roulons à l’électrique, quand nous le pouvons… C’est bien, mais c’est insuffisant. Le mouvement écologique se nourrit de la volonté, mais surtout de la participation des citoyens. Il faut aussi agir politiquement, car les lois qui gouvernent nos vies au quotidien et pour les années à venir sont votées dans les assemblées, telles que les conseils municipaux et les parlements.
Or, non seulement n’allons-nous pas voter en nombre suffisant aux élections municipales, alors que nos villes sont en première ligne contre la crise climatique, mais nous cédons trop aisément au système en place, aux les promesses des partis politiques provinciaux et fédéraux, qui ont intégré le discours écologique à leurs plateformes. Malheureusement, pas les actes. Nous sommes coupables de négligence à cet égard. Pourquoi, là est la question ? Découragement, déni, cynisme, paresse intellectuelle, lâcheté ? Peu importe au fond, puisque le résultat est le même : une catastrophe environnementale, économique et sociale sans précédent.
Parce que, visiblement, nos représentants politiques à l’échelle de la province et du pays veulent nous faire croire — pour leur propre intérêt à court terme et pour les intérêts financiers du secteur industriel et financier — que notre bien-être, que la santé de nos enfants, passeraient par la « relance économique » et par la perpétuation du même système que nous a menés aux problèmes d’aujourd’hui. La leçon de l’histoire ? Allez voter aux municipales qui s’en viennent, manifestez pour une mode de scrutin plus représentatif, ne votez pas pour les partis traditionnels au provincial et au fédéral et impliquez-vous dans une initiative collective et écologique près de chez vous. Aux urnes, citoyens !
Action ou vérité?
Didier Périès
Avec une impression de déjà-vu, j’ai assisté mardi dernier à la cérémonie de la « vérité et de la réconciliation » organisée dans mon école. Quelque chose d’assez impressionnant, auquel étaient conviés à la fois tous les élèves et tout le personnel. À l’extérieur, dans un cercle concentrique formé de chaises ; avec en son centre une table (autel) au pied de laquelle sont venus les différents intervenants. Seule personne allochtone à prendre la parole, notre directeur. Sinon, un élève autochtone, un musicien abénakis et trois autres adultes venant de la réserve de Kitigan Zibi et ayant soit vécu dans un pensionnat, soit dans une école pour autochtones. Ils ont dit leur vérité, une vérité poignante et révoltante sur ce qu’ils subirent dans ces années-là. Pour mémoire, le dernier pensionnat autochtone a fermé en 1996, il y a à peine 30 ans. Cela peut paraitre incroyable, non ?
Grâce à la journée de la vérité et de la réconciliation, notre société, québécoise, canadienne, a l’opportunité de s’informer, de partager ce pan de l’histoire, qui fait également partie de notre identité. Certains diraient : de prendre conscience d’un certain racisme, profondément ancré dans l’inconscient collectif, d’abord, parce que beaucoup de citoyens canadiens, au pays depuis plusieurs générations, croient encore qu’être un « indien », c’est être obèse, alcoolique et dépendant du bien-être social ; ensuite, parce que les nouveaux arrivants ont peine à assimiler cette information, qu’il y a des groupes entiers de personnes indigènes dans leur pays d’accueil. La « diversité culturelle » qu’on leur a vendue n’incluait pas cet aspect-là ! Cela peut être d’autant plus difficile à comprendre si leur pays d’origine n’avait pas de population autochtone…
Ici, désormais, en cet autre jour du Souvenir, seuls les fonctionnaires fédéraux sont en congé, invités à participer aux commémorations qui ont lieu un peu partout, d’un océan à l’autre. Et les autres travailleurs ? Il me semble que le bât blesse déjà à ce niveau. Pourquoi ne pas rendre ce 30 septembre férié pour tous ? Deux commissions d’enquête plus tard, à 30 ans d’intervalle (chacune étant un legs de la dynastie Trudeau), on a tout de même un peu l’impression que si la vérité a un peu avancé, nous sommes loin de la réconciliation.
D’ailleurs, par quoi passerait une véritable réconciliation ? De la bouche même des autochtones, par des gestes, des actes, qu’ils soient privés ou publics. En tant qu’individu, rien ne nous empêche d’aller au Musée canadien de l’histoire pour visiter la salle des Premières Nations, d’écouter un reportage ou de regarder un film sur les pensionnats, d’aller faire un tour à Kitigan Zibi, afin de visiter le très réussi centre des visiteurs des Anichinabés ; collectivement, il y aurait tellement de choses à faire… À commencer par changer le nom de la « Loi sur les indiens », s’assurer que toutes les communautés autochtones à l’échelle du Canada ont l’eau courante et de quoi satisfaire leurs besoins de base, verser à chaque communauté un loyer rétroactif pour l’exploitation systématique des territoires depuis des décennies, consulter les Premières Nations chaque fois que des projets d’envergure en matière de construction ou d’installations publiques sont envisagés, reconnaitre les langues autochtones comme langues nationales… La coupe de la félicité est encore loin de nos lèvres, nous ne sommes pas encore prêts à déguster le délice d’une vie harmonieuse avec nos frères humains.
Memento aqua
Didier Périès
Les discussions sur le temps qu’il fait sont parmi les plus œcuméniques qui se puissent : on n’a jamais vu personne se disputer pour la météo. Vous pourriez rétorquer qu’il s’agit d’une conversation banale, qui ne vise qu’à maintenir le lien social ; que c’est la fonction phatique du langage, absolument nécessaire aux animaux sociaux que nous sommes.
Pas faux. Cependant, derrière ce sujet ordinaire, se cache une situation quelque peu extraordinaire : la sécheresse de plus en plus chronique. Oui, oui, vous avez bien lu. Je vous parle de la disparition, ou tout au moins de la réduction drastique de nos réserves d’eau. D’eau potable, devrais-je dire. Celle qui nous vient des nappes phréatiques, des rivières et des lacs. Et oui, alors que nous sommes dans un des trois pays les plus fournis en eau douce, derrière la Russie et le Brésil (à ce propos, jetez un œil à l’affiche de l’exposition World Press, encore à Montréal pour quelques jours).
Nous avons même des restrictions depuis cette année, et il faudra s’y habituer pour les années à venir. Dans le centre du Québec (et non en Outaouais), notamment dans les bassins versants des rivières Bécancour et Nicolet, et sur l’initiative du gouvernement, afin de « tester une gestion flexible des prélèvements d’eau en fonction des conditions hydriques réelles ». Traduction : pour s’habituer au manque d’eau. Plusieurs municipalités sont « participantes », ainsi que des acteurs des secteurs industriels et agricoles.
Il faut donc s’attendre à l’avenir à des rendements — et donc des revenus — en baisse, peut-être à des pénuries de céréales, telles que le maïs, le soya ; à une augmentation des prix alimentaires… l’Inde, par exemple, premier producteur mondial de riz, fait face au même problème. Pour mémoire, je vous rappelle qu’il existe au Québec une loi 85 qui priorise les usages de l’eau en cas de sécheresse, à condition que le gouvernement le reconnaisse évidemment. Par ordre d’importance : population et services essentiels ; protection d’écosystèmes aquatiques ; agriculture et aquaculture ; usages industriels ou récréatifs. Laver sa voiture ou son devant de maison, vous les mettriez où ?
Nous nous sommes habitués à récupérer l’eau de pluie, à arroser seulement à des moments déterminés de la journée, pas tous les jours, plutôt en soirée, mais ne pensez-vous pas qu’il en faudrait un petit plus ? En écologie existe un principe juste, équitable, pertinent et logique, celui de l’utilisateur-payeur. Pourquoi ne pas l’appliquer vraiment à la consommation d’eau, au moment où la crise climatique connait un développement exponentiel et de manière à prévenir de véritables restrictions qui feraient du tort à tous ?
Je suis un peu excédé de devoir expliquer tout cela encore et encore, de lire que « la consommation d’eau potable à Gatineau [connait] un bilan positif » parce que nous avons atteint un niveau bien inférieur à l’objectif provincial fixé par la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable. Si la ville fait des efforts, la consommation résidentielle, elle, a augmenté ! Et les épisodes de canicule ne vont pas diminuer, au contraire !
Oui, il existe une redevance sur l’eau, mais uniquement pour les entreprises commerciales et industrielles, et elle n’est que de 30 millions de dollars par an. Une blague ! Il est grand temps de faire plus, de faire mieux, à commencer au niveau municipal. Pourquoi pas une taxe municipale proportionnelle à la consommation d’eau potable?
Verba volant…
Didier Périès
Oui, je sais, encore un titre obscur en latin. C’est juste une période, ça va me passer… Vous me permettrez cependant de m’immiscer un peu dans la campagne électorale en cours. Oui, celle qui occupe nos bas-côtés, sur toutes les routes du coin, parfois dans un désordre tel qu'il est difficile d'identifier qui se présente dans notre district ! Le même genre d’élection où l’on a vu il y a un an un taux de participation historiquement bas de 33 % à Gatineau et qui ne cesse de baisser au fil des années.
Un grand mystère d’ailleurs, puisque le gouvernement municipal est en première ligne quand il s’agit de qualité de vie. Pensez aux routes, aux transports, à l’aménagement du territoire, à la police, aux pompiers, au logement, aux écoles, etc. Sans lui, rien ne se ferait. Pire, quand une catastrophe naturelle arrive (inondations, canicule, tornade, feux de forêt), qui est le premier répondant ? De plus, nos conseillers municipaux sont bien souvent des locaux, des personnes que l’on côtoie dans notre quotidien. Et pourtant, non, les gens (je ne m’inclus évidemment pas, dans ce groupe), s’en contrebalancent, littéralement ! Le chalet, nettoyer sa cour arrière ou vaquer à ses occupations quotidiennes prévaut. C’est difficile à expliquer, sinon par un désintérêt de la chose politique, ou par une sorte d’ignorance volontaire, qui frôle la cécité et la bêtise. Mais, là, cela deviendrait insultant, je m’en garderais donc bien.
Mais revenons à nos aspirants à la mairie de Gatineau : une femme, universitaire experte en gouvernance, progressiste, déjà aux commandes depuis un an ; deux hommes : le premier, issu du secteur privé, nouveau dans le « cirque » politique ; le troisième, un vieux briscard de la politique municipale, jamais élu, mais persévérant, un peu iconoclaste.
Si ce dernier, Rémi Bergeron, n’a pas d’équipe à proprement parler, il rode son discours depuis deux élections, avec l’idée globale de réduire les coûts — et donc les taxes — et de revenir à des services essentiels (urbanisme, transport en commun, police…) efficaces. Pour les actions concrètes, plus difficiles de trouver : à part sa page Facebook de 2021, rien n’est vraiment disponible par écrit.
En revanche, avec l’équipe Mario Aubé (l’intitulé pourrait appartenir à un agent immobilier), donc avec cet ex-conseiller municipal de Masson-Angers, issu du milieu du journalisme et de la communication, nous prendrions un virage à droite : le site web prône l’économie avant tout, avec moins d’administration, moins de taxes, mais plus d’Investissements et plus de place au secteur privé… Tout cela en développant des services de meilleure qualité. La quadrature du cercle, quoi ! Et aussi la gestion d’une ville comme celle du « budget d’une famille » : un retour au bon vieux paternalisme politique ?
Enfin, Action Gatineau, fort de son expérience de la gouvernance, dans la lignée de Maxime Pedneault-Jobin, qui a laissé le parti dans un excellent état financier et organisationnel, se veut moins populiste, mais plus à gauche, avec des propositions fortes sur les enjeux écologiques et culturels, malgré les différences d’un secteur à l’autre. D’ailleurs, son programme exhaustif de 35 pages, n’est pas une improvisation : il est le résultat d’un processus de consultation citoyenne de plusieurs mois.
Alors, chers concitoyens, fiez-vous moins à ce que nos candidats disent qu’à ce qu’ils écrivent, car, si les paroles disparaissent et s’envolent, les écrits restent.
Ah! Je me souviens…
Didier Périès
Mais justement, je ne peux pas me souvenir, parce que je ne vivais pas au Québec à cette époque. À 10 ans près, j’aurais pu connaitre ce moment historique qui, en tant que Français, épris des valeurs de la Révolution française et d’humanisme, a toujours attisé ma curiosité. Alors que partout au Québec, nous allons voter pour nos conseillers municipaux et nos futurs maires, nous nous souvenons du deuxième référendum sur l’indépendance, il y a 30 ans.
La question qui me tarabuste est la suivante : et s’il avait été gagné par le camp du « Oui » par 50 000 voix, comme ce fut le cas pour le « Non », que se serait-il passé ? Vous me direz que c’est de l’histoire-fiction, que se poser la question et y répondre ne servira à rien, que c’est chose du passé. Cependant, le fait est que le résultat chiffré en lui-même n’a pas été discuté ; les tenant de l’indépendance, de vrais démocrates, ont accepté que 50 virgule et quelques pour cent constituent une majorité. Une majorité absolue, en fait. Le camp adverse en aurait-il fait de même ? Je reformule : le cas échéant, aujourd’hui (ou demain), l’accepterait-il ?
D’ailleurs, qui se trouvait dans l’opposition à la souveraineté, à l’époque ? Les mêmes que maintenant ? Tous les Canadiens, y compris des Québécois, convaincus qu’on ne peut se séparer sans risquer une implosion du Canada. C’est un risque. Toutes les minorités francophones des autres provinces, qui, sans le Québec, seraient encore plus isolées et vouées peut-être à disparaitre à moyen terme. Ah, j’oubliais, tous les « amoureux » du Québec, certains se découvrant tels lors du fameux love-in (ou « Unity rally ») soutenu notamment par les rabais d’Air Canada ou VIA rail et par plusieurs dépenses électorales déguisées. Le Directeur des Élections l’a reconnu, mais évidemment, trop tard pour invalider les résultats ; on ne saura jamais dans quelle mesure cela a pu changer la donne. Selon plusieurs, l’afflux massif de supporters du ROC, aurait au contraire renforcé la position indépendantiste.
En ce qui me concerne, il parait improbable qu’un seul évènement ait joué un rôle si décisif. Seul, non, mais si l’on y ajoute la campagne de peur et de dénigrement qui avait précédé… Par ailleurs, N’oublions pas que le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes demeure, certes une aspiration naturelle, mais aussi un droit humain fondamental. Et quoi qu’on en dise, combien de personnes le modèle social-démocrate hérité de la Révolution tranquille a-t-il soigné, éduqué, cultivé ? Que nous reste-t-il de cela un demi-siècle plus tard ? Anglos, Francos, allophones, tout le monde en a profité, je crois. Peut-on pérenniser ces acquis au sein du cadre fédéral canadien?
Si vous trouvez que ce sujet est périmé, comme du bon lait ayant tourné, alors imaginez des partis qui en feraient encore leur cheval de bataille ? PQ et PLQ, comme au bon vieux temps, nous voilà revenus 30 ans en arrière. On pourrait même les confronter et leur rappeler qu’à moins de vouloir jouer cette carte par électoralisme, il y a plus urgent à régler… L’anxiété, l’incertitude généralisée que nous vivons, la menace américaine, qui peut justifier la peur d’être noyés dans un 51e état ou le désir de rester entre nous, plus solides, plus « tricotés-serrés », sont-ce là des raisons suffisantes pour relancer la discussion sur l’indépendance du Québec?
Quatre ans pour réaliser quelle vision ?
Didier Périès
Je m’apprêtais à écrire un éditorial au ton jovial à propos du premier sommet Climat Outaouais, organisé sur l’initiative de Radio-Canada et de l’association Action Climat Outaouais (ACO) et tenu le 17 octobre dernier. Réunir tous les acteurs clefs des enjeux environnementaux dans la région était un défi, mais aussi un geste audacieux et optimiste. Il visait à sensibiliser les acteurs économiques, politiques et sociaux sur les thèmes de la biodiversité, des changements climatiques et de la justice environnementale. Dimanche dernier, les Gatinois ont voté à hauteur de 40 % (en augmentation), mais voici le constat d’ACO sur le profil de chacun des candidats à la mairie de Gatineau. Je me demande si les voix que se sont exprimées dimanche dernier se sont véritablement appuyées sur ces questions cruciales.
Mario Aubé (Équipe Mario Aubé) démontrait une bonne compréhension des enjeux, notamment en soulignant l’impact régional de l’étalement urbain. L’engagement de M. Aubé à protéger les milieux humides, dépolluer les sols et renaturaliser les espaces urbains était clair. Certaines réponses manquaient toutefois de précision : les exemples d’écofiscalité étaient hors sujet, et la valorisation des programmes d’Hydro-Québec pour la décarbonation des bâtiments semblait mal informée. Sa référence à la justice environnementale se limitait à ne pas « pénaliser les familles et les travailleurs ». Ses propositions en transport (covoiturage, voies réservées) favorisaient l’automobile, plutôt que des alternatives durables. Et la STO ne pourrait attendre d’aide de sa part pour favoriser le transport en commun.
Maude Marquis-Bissonnette (Action Gatineau) démontrait une compréhension documentée des enjeux et s’inscrivait dans la continuité de plusieurs démarches existantes. Elle planifiait de restaurer 30 % des milieux naturels dégradés et de développer des alternatives à l’automobile. ACO rappelle toutefois que les démarches en cours n’ont pas freiné la hausse des GES ni l’étalement urbain.
Alors, qu’est-ce qui aura penché dans la balance ? La question clivante du transport en commun ? Mais il n’y a jamais eu de consensus, jamais les trois niveaux de gouvernement n’ont été alignés pour financer ce projet structurant, à commencer par les libéraux fédéraux et les promesses creuses de Greg Fergus. Est-ce par peur de ce que cela coûterait ? Mais c’est normal, ça prend vingt ans pour s’entendre dire que l’on va refaire les études, en sachant que les coûts ont augmenté de 40 % entre 2019 et 2023 seulement. Imaginez depuis…
Est-ce la question des taxes (immatriculation, stationnement)? Celle du logement (abordable ou à loyer modéré) ? Plus spécifiquement le problème des itinérants de plus en plus nombreux ou la difficulté de se loger quand on n’a pas ou peu de revenus, quand on est étudiant ? Parce que la manière « historique « de faire depuis toujours, malgré les efforts de l’éclairé Maxime Pedneault-Jobin et puis d’Action Gatineau, ce fut de laisser les promoteurs immobiliers faire ce qu’ils voulaient ! Résultat : une ville tentaculaire, qui pousse dans toutes les directions sans que les structures suivent (et oui ! les promoteurs immobiliers hurlent à la mort, parce qu’on leur impose une taxe à la porte, mais ils ne financent ni les écoles ni les hôpitaux ni les routes). Et les tours à condos pour les fonctionnaires ontariens bien payés continuent de pousser partout ! Dans ce contexte, on peut vraiment se demander ce qui nous attend dans les quatre années à venir.
Des aveugles au milieu du désert
Didier Périès
Ne dit-on pas qu’il n’est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre ? Les directions prises ces derniers temps par nos grands décideurs — je parle là de nos deux premiers ministres, Legault et Carney —en sont l’illustration.
Quoiqu’apparemment ils appartiennent à des formations politiques différentes, leur idéologie est la même. À l’heure où le budget fédéral a été voté sur la colline Parlementaire à Ottawa et celui de Québec a subi une mise à jour d’automne, nous en droit de nous faire du souci. En effet, dans les deux cas, nous avons affaire à une vision purement financière, économique, commerciale. Si l’un vient d’ailleurs du milieu des affaires (ex-patron d’Air Transat), l’autre vient du milieu bancaire international, certes avec une vue globale, mais à travers le prisme des échanges économiques, de la croissance et de l’entreprise comme facteur d’enrichissement collectif.
À cet égard, le budget fédéral 2026 est édifiant. D’abord, par sa séparation entre dépenses de fonctionnement et subventions au secteur privé, oups ! Je voulais dire « investissement », à l’instar de Mark Carney. D’ailleurs ce dernier applique la bonne vieille recette « Investissement public, bénéfice privé » avec l’idée (naïve ou intéressée) que cet argent sera à son tour réinvesti. Or, il a été maintes fois prouvé que les grandes compagnies augmentent leurs profits et arrosent d’abord généreusement leurs actionnaires.
Côté Québec, c’est la gestion à la papa, façon patronat du XIXe siècle. Les décisions sont prises d’en haut et avec pour seul objectif de bien paraitre aux yeux des agences de notation. On coupe mur à mur — mais oui, mais oui, les « services seront assurés » — dans tous les ministères, aveuglément, et ensuite on nous dit que l’on a mal compris, que c’est juste un problème de pédagogie, qu’on va mieux nous expliquer, comme à des enfants.
Ce que l’on appellerait dans mon sud-ouest natal du « foutage de gueule » va quand même assez loin : non seulement va-t-il de la santé à l’éducation, en passant par les transports ou le logement (ces derniers subissant une inflation constante masquée par l’inflation moyenne dont on nous rabat les oreilles), mais, en plus, nous sommes revenus carrément dans le climatoscepticisme et l’écoblanchiment. Comment expliquer sinon que la nouvelle ministre fédérale de l’environnement et du changement climatique, Julie Dabrusin, annonce que les cibles de réduction des GES ne seront pas atteintes et, pire, on pourrait les enlever pour les compagnies pétrolières ; que l’on va parler désormais de « compétitivité climatique (c’est quoi, ce charabia ?) alors que la bourse du carbone a été démantelée ou que les subventions à l’achat de véhicules électriques ont été supprimées ?
Chez les caquistes, ce n’est pas mieux. Bernard Drainville, l’usurpateur portant le titre ronflant de ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs — notez les majuscules —, veut revoir les cibles de réduction de GES et a supprimé sans état d’âme l’aide à l’achat de véhicules électriques, comme son homologue fédéral. Comble du cynisme, il mise même sur le Fonds vert pour financer la baisse du prix de l’essence… avec quel effet, d’après vous ?
Où sont le pragmatisme et le bon sens clamés par nos élites économiques là-dedans ? Leur aveuglement — involontaire ou voulu — est total, toxique et tordu. Ils finiront un jour par prêcher au milieu du désert.
COP 30 : la conférence des perdants
Didier Périès
La trentième « Conférence des parties » de l’ONU pour le climat a lieu au Brésil cette année. Le pays du socialiste Lula, un état pétrolier mais chantre de l’environnement et de la protection de l’Amazonie (qui continue pourtant de disparaitre), aurait pu constituer un cadre adéquat pour une reprise en main solide de la lutte aux changements climatiques. Lui aussi prévoit cependant une augmentation de 36 % de sa production de gaz et de pétrole d’ici à 2035, en même temps que de baisser de 67 % ses émissions de GES. Cherchez l’erreur.
Au fait, une COP sans (contre?) les États-Unis de Donald Trump, est-ce viable ? André Corrêa do Lago, diplomate de haut vol et francophile à la tête de la conférence, croit dans la réussite de ce regroupement annuel. Après tout, l’Accord de Paris n’a-t-il pas été configurés pour faire revenir les Américains dans les négociations, eux qui n’avaient pas signé le précédent accord ? Les villes, les régions, les pays, les institutions internationales, la société civile, les entreprises, tout le monde y est représenté : la COP reste encore la meilleure opportunité d’échanger sur les impacts et les solutions à la crise climatique. Maintenir la communication est déjà un défi et une réussite en soi, d’ailleurs. Avec ou sans les États-Unis, le second plus gros pollueur au monde, les solutions, économiques, financières, technologiques, existent. Aux autres pays de s’en emparer ! Voilà pour la vision optimiste.
Admettons avec lui que sans le multilatéralisme des COP, la situation serait pire, mais reconnaissons aussi alors qu’elles ont été fréquentées massivement par les lobbyistes du secteur pétrolier et gazier récemment, au point que plusieurs ONG et groupes communautaires ont tenu une rencontre en parallèle, la « COP des peuples » ! Au-delà des promesses de financement, qui n’ont jamais été totalement tenues, des professions de foi, qui peuvent servir d’écrans de fumée, ou des plans d’action qui restent lettre morte (ou ne sont pas communiqués, comme dans le cas de l’Europe), le fait demeure : ces accords ne sont jamais contraignants pour les états.
À quoi sert alors de vouloir tripler la production d’énergie renouvelable, comme annoncé à la COP 28, si la production/consommation d’énergies fossiles croît également, comme en Inde ou chez nous ? À quoi sert d’annoncer une augmentation des montants pour « réparation » du préjudice climatique auprès des pays du sud, si ces derniers restent de facto les plus grandes victimes des désastres qui s’intensifient, parce que les sommes ne sont pas versées ? Pourquoi est-on incapable de parler officiellement d’une sortie des énergies fossiles, alors que c’est la condition sine qua non à toute réelle amélioration ? Tout doit-il se résumer à une question d’argent, de finance ? Quid du changement des mentalités (et des comportements), tant des individus que des collectivités ou des compagnies et des organismes publics ?
Le Programme des Nations-Unies pour l’environnement, l’un des acteurs les plus volontaristes et optimistes dans le monde (oui, oui, croyez-le), prévoit désormais une hausse des températures mondiales moyennes de 2,8 degrés d’ici à la fin du siècle. Antonio Guterres, le secrétaire général de l’ONU, peine à trouver les mots. Il parle maintenant d’« effondrement climatique ». Pour ma part, je vous invite simplement à réécouter la chanson des Cow-boys fringants « Plus rien » en pensant à vos enfants ou à ceux de vos voisins.
Humanisme 3.0
Didier Périès
L’IA semble s’être invitée jusque dans nos vies personnelles subitement, en quelques mois. En réalité, la plupart d’entre nous l’utilisent déjà, sans le savoir, mais désormais, elle est là, devant nous, omniprésente, sans aucune chance même de l’éviter. Une véritable intrusion ! En tout cas, c’est un peu comme cela que je le ressens.
Vous en doutez? Que sont donc les assistants vocaux Siri (Apple), Cortana (Microsoft) ou Alexa (Amazon), qui nous aident déjà à trouver des réponses à nos questions générales, à gérer nos agendas ou à contrôler d’autres appareils ? Comment Netflix vous suggère-t-il les films et les séries TV de manière si personnalisée ? Et les plateformes d’achat, qui analysent nos comportements d’achat et « optimisent » notre « expérience utilisateur » ? Sans compter tous les robots conversationnels possibles et inimaginables qui nous répondent ou nous contactent en lieu et place d’un être humain ?
Vous en voulez d’autres, plus actuels ou en devenir immédiat ? Dans les véhicules autonomes pour traiter la masse de données environnantes et rendre ce type de conduite sécuritaire ; en santé, pour analyser des millions de dossiers médicaux et détecter des maladies précocement ou fournir de l’imagerie ; dans le secteur industriel, afin d’automatiser certaines tâches, exploiter les données clients et ajuster la production ou prévoir les pannes…
Mais le vrai sujet brûlant (même si c’est aussi un peu le prof qui parle ici) est le rôle que nous voulons que l’IA joue dans la formation de nos jeunes. Je reformule : quelle est la place de l’humain dans le développement de l’IA que l’on nous propose ? Le rapport Parent (1963-1966), qui façonna les décennies suivantes en matière d’éducation au Québec, entrainant l’éducation secondaire pour tous, les polyvalentes, les cégeps et le réseau universitaire public, ce rapport visait un « nouvel humanisme […] élargi et diversifié en accord avec le monde contemporain ».
Dans cette optique, la maitrise de la langue comme outil de pensée critique et les compétences de pensée et de recherche sont cruciales : nous devons continuer de faire travailler notre cerveau pour mieux comprendre, sélectionner, établir des liens, hiérarchiser et reformuler l’information. C’est ce que l’on appelle l’esprit critique. Au XVIIe siècle, Boileau, l’auteur de l’Art poétique, affirmait déjà que « ce qui se conçoit bien s’énonce clairement/et les mots pour le dire arrivent aisément ». Contenu (connaissance) et contenant (compétence) sont indissociables.
C’est en pratiquant que l’humain apprend, c’est ainsi. Laisser ces opérations intellectuelles à une machine prouve non seulement que nous cédons à la paresse — ce qui n’est pas nouveau, tant l’histoire de l’humanité vise à se faciliter la vie — mais également que nous avons capitulé. Nous acceptons de ne plus penser, de ne pas chercher à développer l’unique capacité qui nous distingue du reste du règne animal ! Nous nous rendons et nous rendons nos jeunes moins intelligents, rien de moins.
Cela constitue une rupture majeure dans l’histoire humaine. Or, qui a pris la peine de vérifier l’innocuité de cette technologie avant d’en généraliser l’implantation ? Ce danger s’ajoute à une conséquence assez bien connue et prouvée par la recherche maintenant de l’utilisation des écrans, des médias sociaux en particulier, quant aux capacités de concentration et de réflexion poussées des utilisateurs. Dès lors, éduquer nos enfants à mieux utiliser l’IA, de manière autonome, change-t-il quoi que ce soit au résultat final ? Aucun bouton magique ne nous rendra plus intelligents.
« Ce n’est pas les médecins qui nous manquent, c’est la médecine » (Montesquieu)
Didier Périès
J’ai failli commencer par une nouvelle qui va changer le monde : Costco vend désormais des tickets de loterie ! Vous imaginez ? Le bouleversement cataclysmique que cette information a déclenché me laisse coi.
Non, moi, plus modestement, j’ai décidé de rester terre à terre et d’écrire sur l’accès aux soins de santé. Un truc simple et sans intérêt, quoi ! Et ma question est simple : comment le Québec, la 22e économie au monde (Banque mondiale, 2023), ne peut-elle faire mieux qu’un pays en développement ? Une chose est claire : il y a assez d’argent au Québec pour nous payer un système de santé aussi efficace que dans n’importe quel pays du Nord global.
Alors, où est le problème, si l’on reconnait que nous disposons (ou pourrions disposer) des ressources humaines, que le financement est suffisant, que les infrastructures (hôpitaux, CLSC, etc.) existent ? Il ne peut être que politique, c’est-à-dire dépendant des choix de nos décideurs, soit dit en passant élus… par nous ! Mais quels ont été ces choix ? Déjà, dans les années 1990, au nom de la rigueur, sans prévoir les besoins grandissants, on a coupé dans les budgets et perdu 3000 infirmières que nous n’avons jamais récupérées. Depuis le début des années 2000, les libéraux ont peu à peu déshabillé notre système de santé pour l’enterrer, les caquistes ajoutant les derniers clous au cercueil.
Vous me rétorquerez que « la critique est aisée, l’art est difficile ». D’accord. Écoutons les médecins : pour eux, ce n’est pas vraiment une question de rémunération, mais plutôt de condition de travail et d’organisation. Ils sont des fonctionnaires, mais sont sur le plan fiscal, en réalité, des entrepreneurs indépendants. Créons donc une catégorie de médecins hospitaliers-fonctionnaires ; une médecine du travail, plus administrative ; des urgentistes dédiés et payés pour cela ; des facultés de médecine et des formations en techniques infirmières plus accessibles, notamment aux immigrants qualifiés (oui, oui !)… Et une pratique privée : acceptons d’avoir un système de santé à trois vitesses (public, privé conventionné avec l’état et 100 % privé), tant que la première est de très bonne qualité et la seconde sous contrôle sévère, parce que les riches s’arrangeront toujours pour aller voir ailleurs, s’ils le désirent, système universel ou pas !
Enfin, au lieu de réclamer que les docteurs s’occupent de tout, réhabilitons les CLSC comme première ligne, avec des équipes multidisciplinaires (psychologues, travailleurs sociaux, infirmières, physiothérapeutes, pharmaciens… médecins). Le fait de réunir ces professionnels en un même lieu permettrait de libérer les urgences et les hôpitaux, le temps de remettre du personnel dans ces derniers, tout en apportant un réconfort aux patients qui n’auraient pas 200 km de déplacement à effectuer, qui connaitraient leurs interlocuteurs, et vice-versa. De la médecine de proximité ! Moins d’administration, plus de praticiens !
Même s’il est élevé, c’est le prix raisonnable à payer pour une véritable amélioration d’ici dix ans. Sinon, essayons de trouver du réconfort en nous disant qu’ailleurs la situation est pire. À la suite du désengagement étasuniens dans l’aide internationale, les autres grandes puissances ont fait pareil, l’argument de l’incertitude économique et de l’instabilité géopolitique leur servant d’alibi. Et depuis, ça dérape, notamment — mais pas seulement — en Afrique : reprise d’Ebola, retour en puissance du SIDA, sans parler d’une probable prochaine pandémie.
Le temps des fêtes
Didier Périès
Nous y sommes : les célébrations de fin d’année approchent ; ouf ! nous aurons un Noël blanc et, quelles que soient nos croyances et notre confession, notre quotidien baigne dans une sorte de générosité ambiante obligatoire, socialement correcte et plutôt factice… comme un rire forcé.
Cadeaux de Noël pour tout un chacun, dons aux banques alimentaires, Guignolé (ici), Téléthon (ailleurs), la générosité règne en maitre. L’histoire du mot est intéressante et peut nous éclairer sur ce trait de caractère que nous partageons tous dans des proportions variées. Le dictionnaire Robert la définit comme cette « qualité qui dispose à sacrifier [notre] intérêt personnel », synonyme d’altruisme et d’abnégation ; mais aussi « qui dispose à pardonner, à épargner l’adversaire »… ou encore à « donner sans compter ». C’est aujourd’hui le sens commun du mot « générosité ». Au XVIIe, la générosité était un véritable concept culturel, un marqueur social : « grandeur d’âme, courage, magnanimité, bravoure », tout cela à la fois. Rappelez-vous qu’il s’agit de la même époque où on pouvait tuer ou être tué pour l’honneur.
Cependant, cela nous dit quelque chose sur notre XXIe siècle narcissique, individualiste et sans foi ni loi (ou bien celles de l’économie et du profit). En effet, pourquoi devrions-nous être plus généreux maintenant, en décembre, plutôt qu’en mars ou au mois d’août ? Quelle surprise que cet élan coïncide avec le moment où l’on dépense le plus en cadeaux (près de 1000 $ au Canada, un peu plus de 600 $ au Québec, pour le Noël 2025, selon les prévisions) ; alors que beaucoup d’entre nous reconnaissent — ironiquement — que l’on offre trop cadeaux !
Le sentiment de culpabilité que l’on ressent, ne serait-il pas justement ce qui motive notre propension à être généreux ? Une manière de nous dédouaner, de laver nos péchés, alors que tout autour de nous exige d’acheter, à rabais ou à plein prix. Soyons généreux et oublions que nous achetons d’abord pour nous faire plaisir ! Au fond, nous le savons, nous, Homo economicus (Mills) ou Homo laborans (Arendt) : « Je dépense donc je suis », comme le dit mon ami Michel. Nous sommes devenus les agents laborieux et serviles d’un système pour qui nous sommes des outils, de la ressource, le produit anonyme qui lui sert à créer davantage de profit, à augmenter le capital… Et pour qui ? Qui en sont les véritables bénéficiaires, au-delà des cadeaux que chacun-e d’entre nous va donner et recevoir ? Pensez-y bien.
Et en plus, il faudrait être joyeux, heureux et, à la limite, faire quelques pas de danse sur la musique de Noël entrainante qui nous sert d’environnement sonore quai-permanent pendant un mois, où que l’on aille. D’ailleurs, un lieu commun nous réunit, qui symbolise cela : le marché de Noël. Ou plutôt, devrais-je dire, les marchés de Noël, tant leur nombre a explosé cette année, au nom de l’achat local et du retour aux anciennes solidarités collectives, chaque école, chaque quartier, chaque paroisse propose le sien ! Au final, cela consiste quand même à acheter. Dans la bonne humeur et dans la « générosité », mais rien de plus, ne nous leurrons pas.
Pourtant, dans le contexte de crise économique, sociale, politique et environnementale actuelle, un contexte plutôt morose, vous en conviendrez, avoir du plaisir, faire plaisir et se faire plaisir, met du baume au cœur. Nous en avons besoin. Mais à quel prix ?
Tristes topiques
Didier Périès
Qu’est-ce qui a pris au magazine Time de reprendre la célèbre photographie de Charles C. Ebbets « Lunch Atop a Skyscraper » (1932) ? Cette image, parmi les plus marquantes du XXe siècle, montre un groupe de onze travailleurs pique-niquant dans le vide, assis sur une poutre d’acier du futur Rockefeller Center de New-York, à plus de 250 mètres du sol, sans aucune protection apparente.
Et oui, les normes de sécurité au travail n’étaient pas ce qu’elles sont ; les États-Unis se sont littéralement bâtis grâce au sacrifice de ces gens-là, au risque de leur vie, issus pour la majorité de l’immigration ou autochtones. Cela illustre également la volonté farouche de ces gens pauvres de travailler, malgré la grande dépression consécutive au krach boursier de 1929.
Par ailleurs, cette photo est une véritable œuvre d’art par le contraste saisissant entre le danger, et l’attitude détendue (il existe même des photos les montrant en train de faire la sieste !) de ces travailleurs se détachant sur le ciel gris clair alentour ; la symbolique est très forte de ces humains repoussant les limites du possible, il y a là aussi une sorte de message optimiste qui s’ajoute, enfin, au caractère symbolique du courage extrême et iconique de cette époque de grands changements.
Aujourd’hui, en cette ère de plagiat, de mèmes et de tendances qui ne font que réinventer la roue, le célèbre magazine anglais a certainement voulu garder cette dernière idée : elle a placé huit des grands « bâtisseurs » de l’intelligence artificielle (IA) en lieu et place des onze ouvriers de la construction pour illustrer son numéro spécial sur les personnalités de l’année 2025. Il s’agit des patrons d’entreprises de modèles d’IA générative Sam Altman (Open AI, Chat GPT), Dario Amodei (Anthropic), Elon Musk (xAI), Demis Hassabis (Google, division IA DeepMind), Mark Zuckerberg (Meta), les dirigeants des deux géants des puces électroniques, Jensen Huang (Nvidia) et Lisa Su (AMD) et, pour finir, de l’experte de l’université Stanford Fei-Fei Li. Si la majorité a fait des études dans les sciences — trois d’entre eux sont même passés par Stanford — tous se rejoignent : ils ont aujourd’hui beaucoup beaucoup d’argent dans un secteur (la « tech ») qui brasse des centaines de milliards de dollars ; ils font la pluie et le beau temps sur les économies du monde entier et sont le moteur spéculatif des marchés boursiers ; enfin, ils s’ingèrent de plus en plus dans la société et la politique en s’immisçant dans notre vie quotidienne et dans les politiques nationales.
En fait, plutôt que des bâtisseurs, ils sont des « architectes » : les petites mains qui ont tapoté et tapotent encore sans relâche sur les claviers pendant des milliers d’heures, ce n’est pas eux. De plus, comme Musk, plusieurs d’entre eux sont devenus des financiers, dont le principal mérite ces dernières années a été d’investir dans des compagnies liées à l’IA, à un moment où d’autres étaient dubitatifs et réticents, ce qui nécessite du flair, convenons-en.
Mais comment peut-on comparer ces ultra-riches à des ouvriers qui gagnaient une misère au péril de leur vie, afin de construire des immeubles appartenant à leurs homologues de l’époque ? Rockefeller n’est jamais monté sur une poutre à 200 mètres d’altitude et n’a jamais risqué un centimètre carré de sa peau pour autrui ! Le Time s’est-il aperçu de l’ironie tragique de son mème ?
Tous ensemble : appel à la solidarité pour 2026!
Didier Périès
Lundi matin, dans mon école, lors de l’assemblée qui réunit élèves et enseignants pour les annonces de la semaine, deux étudiantes s’occupant de la capsule sur l’actualité ont associé à l’attentat perpétré samedi en Australie la photo d’une femme avec un drapeau israélien sur le dos. Vous ne voyez pas où est le problème? La corrélation entre les deux éléments n’est pas avéré, et, même si c’était le cas, il ne justifie pas que l’on entretienne la confusion entre les pro-Netanyahou, les Israéliens et les juifs. Nul doute que la communauté juive australienne était visée lors de cette célébration d’Hanoukka, mais le reste n’est qu’interprétation, conjecture et confusion, y compris probablement dans l’esprit des terroristes, tous deux de surcroît Australiens (le fils y est même né).
Bref, nuançons. Et, au lieu céder à la colère, à la division, observons plutôt que des gens, par pur altruisme et solidarité, ont risqué leur vie pour empêcher qu’il y ait plus de victimes : Jessica, cette mère qui cherchait son fils et s’est finalement allongée pour protéger une petite fille inconnue et seule ; Ahmed al-Ahmed, d’origine syrienne, qui s’est jeté sur l’un des deux meurtriers pour le désarmer ; ces sauveteurs en mer qui n’étaient pas en service et qui ont couru sous les balles pour mettre à l’abri les enfants ; ou encore ce rescapé de la Shoah qui s’est également interposé pour faire diversion…
Dans les jours sombres qui nous attendent, il va falloir resserrer les rangs, non pas au nom d’un nationalisme identitaire qui nous a déjà conduit à des guerres mondiales et à des atrocités inimaginables ; et qui nous conduit également aujourd’hui à désigner comme les boucs émissaires de tous nos maux les étrangers, les immigrants, mais plutôt à nous serrer les coudes au nom de la même solidarité humaine qui a permis de traverser les pires moments de notre passé commun.
La vague de solidarité qui a suivi le massacre de la plage de Bondi est d’ailleurs une preuve que nous sommes capables de mettre de côté nos différences (ethniques, religieuses, politiques, sociales, économiques) afin de reconnaitre la haine aveugle quand elle se présente et lui dire non. Nous, Québécois, qui avons été historiquement entre le marteau colonial britannique et l’enclume autochtone, sur laquelle nous avons frappé plus qu’à notre tour, nous sommes des « spécialistes » du nationalisme, mais nous devons garder le cap sur un nationalisme ouvert, inclusif, progressiste et nous écarter franchement de ce nationalisme fermé, exclusif et conservateur qui envahit notre paysage politique.
Ne cédons pas à l’idéologie du « eux contre nous », à l’heure de la mondialisation économique et culturelle, alors que la crise climatique frappe sans relâche et que les défis sociaux et économiques creusent les écarts. Ceux qui soufflent sur les braises de la haine le font soit par conviction soit par démagogie, populisme et calcul partisan ; dans les deux cas, ces personnes ne nous méritent pas. « Notre » religion, « notre » culture, « nos » valeurs, « nos » symboles, nos traditions… enfin, dans quel univers passéiste et figé vivez-vous ?
Contrairement à l’opinion commune, dans les temps les plus durs, les humains montrent toutes leurs qualités ; l’Histoire en fournit les preuves. Nous ne sommes pas les égoïstes que les cyniques de droite veulent nous faire croire. Nous valons mieux que cela.
Éditoriaux de 2024
Soyez acteurs de la vie dans votre ville, votez !
Didier Périès
Ces temps-ci, je ne cesse de parler d’action politique. Pas plus tard que dimanche dernier, à l’occasion d’un anniversaire, chez des amis. En effet, qu’il s’agisse de mon voisin de table me rappelant qu’il était écologiste depuis ses 13 ans, qu’il avait contribué au livre qui a introduit l’expression « simplicité volontaire », mais de m’avouer dans le même souffle, qu’il n’était toujours pas membre du seul parti avec une plateforme complète axée sur l’écologie ; qu’il s’agisse des enfants de mes amis, respectivement de 17 et 18 ans, qui y sont sans cesse sensibilisés par leurs parents, sans résultat pour l’instant… Autour de moi, les gens ont souvent une bonne opinion de la politique — moins des politiciens — ils abondent dans mon sens, quand je leur rapporte mes propos à mes étudiants : « Si tu ne t’intéresses pas à la politique, la politique s’intéresse à toi : chaque mouvement que tu fais est régi par des règlements, des lois qui ont été adoptées, votées dans un conseil municipal ou une assemblée parlementaire ! »). Mais que font-ils de plus pour faire la différence ?
Dans l’école où je travaille, le comité de rédaction du journal étudiant, constitué de 12e année, s’est penché sur le hiatus entre les discours et les actions, pour en arriver à la conclusion que les bottines ne suivent pas les babines. Les adultes éducateurs (en direction, en enseignement) parlent beaucoup de pluralisme, d’engagement, de changer le monde, mais dès qu’il est question d’agir, ne serait-ce qu’en allant manifester, de s’impliquer physiquement dans une action politique — et qu’est-ce qui n’en relève pas ? — ils se recroquevillent et leur refuse la moindre initiative. Même sur un sujet aussi consensuel que la crise climatique et les injustices sociales.
Pourquoi ? De quoi avons-nous, avez-vous peur ? Du lynchage, de la prison, de l’opprobre de la société ? Quel est le risque de l’engagement politique ici, au Québec, au Canada ? L’inscription à un parti comme le Parti vert du Canada coûte 10 $ et n’engage même pas à voter pour lui ! Et 70 % de tout don à un parti est reversé en crédit d’impôt : vous venez de récupérer 7 $ ! J’essaie de comprendre pourquoi l’on encourage tant mes actions, mais que les mêmes personnes qui me tapent amicalement sur l’épaule, ne s’engagent pas plus. Est-ce une manière de se rassurer (il faut des individus comme moi pour que les choses avancent parfois un peu) ? Est-ce ironique (« Vas-y, épuise-toi et reviens à la raison, dans le giron de ceux qui parlent plus qu’ils n’agissent ») ? À moins de considérer que parler est agir… Parfois émerge le terme « activiste », sur un ton méprisant, comme si l’activisme était une sorte d’action honnie, le côté sombre de cette force de changement qu’est l’action politique.
Bref, ainsi que je le disais, je me sens beaucoup interpellé par l’action politique en ce moment. Ne serait-ce que parce que nous sommes dans une campagne électorale à la mairie de Gatineau. Ce n’est pas rien : le palier municipal joue le rôle de première ligne dans ce qui touche plusieurs de nos conditions de vie quotidiennes. Alors, qu’attendons-nous donc pour agir comme de vrais citoyens, conscients de leur chance et engagés dans la vie politique de leur pays ? Allons voter le 9 juin prochain !
Débattre sans se battre
Didier Périès
À la sortie de la salle Odyssée jeudi soir dernier, je me sentais purifié des émotions envahissantes et négatives, j’étais apaisé. Comment rester dans cette bulle quand « le devoir nous appelle » ? En l’occurrence, à deux semaines des élections municipales, il me fallait replonger dans l’arène politique. Non que cela me déplaise, mais le spectacle des Ballets Jazz de Montréal sur la musique de Leonard Cohen avait été tellement beau ! Décidément, rien ne peut remplacer les arts vivants !
En parlant de « spectacle », je voudrais revenir sur le débat-discussion de mardi dernier au British devant plusieurs centaines de citoyens. Si cet événement ponctuel, soigneusement scénarisé par l’équipe du Bulletin, comportait une scène, des spectateurs et bien sept artistes-interprètes (ayant eu plusieurs répétitions au préalable), qui jouaient plus ou moins bien leur rôle, en revanche, le jeu était un plus sérieux, et les enjeux plus concrets, plus immédiats, plus palpables. Tout comme la tension à certains moments de la soirée…
Au-delà des anecdotes, qu’il s’agisse de l’échange violent entre Maude Marquis-Bissonnette et Yves Ducharme, de l’interruption ô combien pertinente des employés de Videotron-Gatineau, en lock-out depuis sept mois ou de la question soulevée à la dernière minute par un citoyen concerné à propos des itinérants, il faut retenir le caractère éminemment démocratique de l’exercice. Il est nécessaire pour la vitalité de notre système politique, pour le peuple et par le peuple, faut-il le rappeler, 1) que les candidats, nos représentants, s’affrontent et fassent valoir leurs idées 2) que ce soit face à des citoyens qui peuvent s’exprimer et - dans une certaine mesure - interagir. Finalement, nous avons pu nous faire une idée un peu plus nette du profil et du programme de chacun-e des candidat-e-s, même s’il faut se méfier du talent de communicateur et d’acteur de plusieurs d’entre eux.
De toute façon, plusieurs questions sont restées en suspend, la plus importante étant : est-ce suffisant pour redonner confiance dans le système et pousser les gens à se rendre aux urnes le 9 juin prochain en masse ? Le score à battre est 35 % ; on doit pouvoir faire mieux. Et puis il y a également les questions qui n’ont pas été posées, soit parce que les personnes présentes n’y ont pas pensé, soit par manque de temps.
Alors en voici quelques-unes en vrac :
- Croyez-vous être capable de faire partie de la solution en ce qui concerne la pénurie de travailleurs de la santé ? Si oui, comment ?
- Quelles sont les différences entre la gestion d’une entreprise et celle d’une ville ?
- Quelles sont vos propositions pour renforcer la démocratie participative, redonner aux citoyens le goût de croire en la politique municipale et en fin de compte les pousser à aller voter en plus grand nombre ?
- Quelles sont les mesures d’adaptation climatique que vous mettriez en place dans la première année ?
- Y a-t-il moyen de faire mieux avec l’argent que l’on a, sans couper dans les services ? Comment ?
- Que pensez-vous du concept de coopérative comme outil de développement socio-économique ?
- Un ticket d’autobus gratuit pour les moins de 25 ans et les plus de 65 ans et à 1 $ pour les autres Gatinois, est-ce possible ? À quelles conditions ?
Sur ce, bonne réflexion, si vous n’avez pas encore fait votre choix !
Attention, terrain miné!
Didier Périès
On a fait grand cas des 80 ans du débarquement allié en Normandie, le 6 juin 1944. Cet évènement a certes constitué un tournant de la Deuxième Guerre mondiale, mais pas moins que le débarquement en Sicile, le 10 juillet 1943, plus vaste en hommes, en équipement et en navires, ou que la Bataille de Normandie, plus violente et plus longue — trois mois. Ceci au moment où l’URSS lançait plus de deux millions de soldats dans l’opération « Bagration », qui forcerait les Allemands à reculer de 500 km en quelques semaines…
On pourrait remarquer que ces célébrations, immenses spectacles aux accents nationalistes, où l’on vante et idéalise bien souvent l’action destructrice qu’est la guerre, sont des écrans de fumée qui nous distrairaient des véritables enjeux. En effet, nous sommes flattés que ces gens, dont la plupart n’avaient pas vingt ans, aient agi au nom de belles et grandes valeurs, qu’ils aient vécu une « épopée des plus brillants exploits ». Mais il n’y a pas de guerre propre ni de belle guerre : près de 35 000 civils ont été blessés ou tués dans les mois de bombardements ayant précédé l’opération Overlord et 20 000 autres pendant les trois mois de la bataille de Normandie. Sans compter les centaines de milliers de soldats morts… La guerre est la plus laide des manières de régler un désaccord et elle n’est pas non plus un show.
Quel parti politique n’a pas tari d’éloge sur le « sacrifice de nos soldats », portés par des « idéaux » de « démocratie, de liberté » pour « libérer l’Europe [et le monde] de l’oppression », qui sont les « fondements mêmes de la paix et de la sécurité mondiales » (Trudeau, Macron et les autres)? Même Poilièvre a vanté « l’héroïsme collectif », la « bravoure » pour « rétablir la paix et la liberté » et « contre le fascisme ». Ils semblent y croire quand ils le disent, la société — vous, moi, nos voisins — semblons y croire. Pourtant, même le meilleur taux de participation à des élections au Canada dépasse difficilement les 60 % ; 33 % aux municipales… Et c’est sensiblement identique dans les autres pays du Nord global (à peine 45% en France, lors des élections européennes du week-end dernier). Ce manque flagrant d’implication contredit l’adoration apparente que nous vouons aux idéaux qui ont conduit à l’engagement militaire dans les dernières guerres. Hypocrisie ? Ignorance crasse? Abêtissement général? Regardons cela de plus près.
D’abord, ces chiffres prouvent que la population adhère de moins en moins à la démocratie représentative telle qu’on la connait : on ne voit plus l’intérêt à exprimer notre voix dans l’isoloir. Préférerions-nous ne plus avoir à le faire ? Comment s’appelle le type de régime où l’on ne vote plus, parce qu’il n’y a qu’un candidat à sa propre succession déjà ? Ensuite, les partis de la droite radicale (ou extrême droite) connaissent un succès grandissant, avec leur discours soi-disant antisystème ; leur démagogie, loin des sujets de fond ; leurs attaques ad hominem, loin de la promotion des idées. Ces partis « illibéraux » s’appellent RN en France, PCC, Parti populaire au Canada ou Parti républicain aux États-Unis. En Europe, ces anti-européens acharnés sont quasiment devenus la deuxième force au parlement, ce qui est quand même ironique ! Leurs discours et leurs valeurs sont aux antipodes de ceux qui guidaient les valeureux soldats que l’on encense par ailleurs. Ne sommes-nous pas en train de vivre la mort à petit feu de la démocratie?
Nos religions païennes
Didier Périès
Avez-vous remarqué comment une sorte d’énergie collective semble s’être emparée de nous dans les dernières semaines et combien la présente semaine culmine en nombre de partys, de concerts, de festivals, etc. ? Ce n’est pas dû au hasard. Le solstice d’été s’en vient, le 21 juin, journée la plus longue de l’année.
Les changements de saison sont depuis l’aube de l’humanité l’opportunité de célébrations, parce que signifiant une transformation physique dans notre environnement (température, humidité, végétation, animaux), mais aussi symboliquement : nous, humains, modifions nos habitudes, nos activités, nos tenues vestimentaires et notre état d’esprit. Bien plus déconnecté de la nature que par le passé, notre corps réagit néanmoins aux changements naturels ambiants.
D’ailleurs, les religions monothéistes, en particulier le christianisme, ont habilement repris les fêtes des anciennes religions païennes (babylonienne, celtique, romaine), en les habillant de nouveaux oripeaux : la Toussaint, ou jour des Morts ; Noël ; la Saint-Valentin ; le carême, période de jeûne avant Pâques ; Pâques elle-même… Même si l’institution religieuse ne le reconnait pas, force est d’admettre qu’en agissant ainsi, on a utilisé des célébrations souvent reliées à la marche de la Nature, pour leur conférer une dimension symbolique et religieuse déconnectée de cette réalité.
Et puis de nos jours, elles sont de simples réunions de famille ou entre amis et surtout pour les commerçants, une opportunité commerciale. Les rituels qui accompagnaient ces fins d’étape, marques du temps qui passe, et qui ponctuaient notre existence sont moribonds ou ont été abandonnés… ou plutôt ont été remplacés. En effet, la société s’est tournée vers d’autres dieux, d’autres croyances, tout aussi irrationnelles en vérité.
Le dieu argent (la « richesse monétaire », si vous préférez) en est un, au moins aussi puissant que le dieu qui l’accompagne, le matérialisme (la « richesse matérielle ») ; ces deux divinités nous inculquent un principe directeur : « Plus, c’est mieux ». Une autre déité commande plus que jamais nos existences: la technologie. Cette dernière est tellement puissante que, selon ses nombreux adeptes, elle va même nous sauver de la crise climatique ! Ironique, quand on sait que ces technologies qui doivent régler les effets de la surexploitation des ressources naturelles sont construites avec ces mêmes ressources…
Cependant, la croyance qui me parait à la fois la plus incroyablement belle, mais qui a conduit l’humanité au bord du gouffre, est la foi aveugle en l’humain. Attention, je ne le dis pas au nom d’une entité immanente — un dieu — pour défendre une religion (je suis athée et plutôt anticlérical). Je l’affirme avec d’autant plus de déception et d’effroi que je me considère comme un humaniste, qui considère que nous avons bien fait de reléguer Dieu à la périphérie de notre vision du monde pour le remplacer par l’être humain, au tournant du XVIe siècle. Ce faisant, au fil des siècles, nous sommes malheureusement devenus anthropocentrés et individualistes à l’excès ; notre orgueil démesuré nous a conduits à croire que l’humanité devait/pouvait dominer le monde. Une distance, physique et mentale, a peu à peu grandi entre nous et notre environnement. Et nous voilà maintenant, avides de spiritualité (pensez à la montée des religions partout autour du monde), de relations avec autrui (à quoi servent les médias sociaux ?), de connexion avec la « Nature », mais si réticents à renoncer à notre confort personnel pour infléchir la course folle vers le mur devant nous.
L'hôpital Asticou
Ian Barrett
Cette semaine, le gouvernement provincial a annoncé que le nouvel hôpital CHAU (Centre hospitalier affilié universitaire) serait situé à l'emplacement de l'actuel Centre Asticou, sur le boulevard de la Cité des Jeunes, près du secteur du Plateau.
Des critiques ont été émises par un certain nombre d'intervenants, dont la mairesse Maude Marquis-Bissonnette, qui s'inquiétait de la façon dont la ville pourrait aménager cette artère pour qu'elle convienne au grand nombre de véhicules qui y passeront pour accéder à l'hôpital, qu'il s'agisse de patients ou de travailleurs. D'autres se sont plaints du fait que l'accès à l'hôpital ne serait pas central pour la majorité des habitants de la ville.
Il s'agit néanmoins d'une très bonne nouvelle pour Aylmer. Depuis des années, l'ouest de la ville fait l'objet d'importants projets de développement, dont beaucoup s'adressent aux personnes âgées. La zone entourant les Galeries Aylmer a été essentiellement transformée en une communauté de retraités. Action Gatineau a largement piloté ce plan d'urbanisation pendant les huit années de l'administration Pedneaud-Jobin, et maintenant qu'elle est revenue au pouvoir, de tels projets près du corridor Principale/Wilfrid Lavigne pourraient prendre de l'ampleur.
Un service essentiel pour les personnes âgées est de disposer de soins de santé raisonnablement accessibles. Le nouvel hôpital signifie que l'ancien, situé à Hull, fermera ses portes. La ville avait insisté pour que l'hôpital soit situé à proximité du casino. Bien que la distance entre le centre d'Aylmer et le casino ne soit que légèrement plus grande qu'à Asticou, la principale différence est que les patients d'Aylmer auraient dû traverser les ponts.
(Trad.: BA)
Entre deux eaux
Didier Périès
Je vous écris depuis cette zone étrange et flottante, entre la Saint-Jean et la fête du Canada. Suis-je seul à percevoir cette période comme un vacuum multicolore — on passe du bleu au rouge en l’espace de quelques jours — un peu inconfortable ?
Le même marketing qui installe les décorations de Noël le lendemain d’Halloween, ou celles de Pâques juste après la Saint-Valentin, propose à un attirail fleurdelysé bleu et blanc peu avant le 24 juin et, sans transition, nous inonde de produits « érablisés » rouges et blancs avant le 1er juillet. Le pire est que nous suivons : nous nous décorons pour l’occasion, puis… nous oublions jusqu’à l’année suivante. Cela étant dit, ce que je ressens m’a amené à réfléchir plus d’une fois, et encore aujourd’hui, à cette identité changeante, à cette double identité si vous préférez. Pour certains, immigrants originaires d’un pays ni francophone ni anglophone, il s’agit même d’une triple identité ! Et je conçois qu’il n’y ait aucune difficulté à passer d’une célébration à l’autre pour plusieurs d’entre nous, plus caméléons. Mais moi, je m’interroge.
Les Québécois, davantage les francophones que les anglophones, se sentent différents ; pour les allophones, je ne sais pas… Je me dis également que si la société québécoise s’est progressivement dirigée vers le français comme langue commune avec les lois 85 (1967), 63 (1969), 22 (1974) et surtout 101, en 1984, il reste étonnant que la « fête nationale » n’inclue pas de performances en anglais : après tout, la communauté anglo-québécoise fait aussi partie — historiquement et socialement — de la « nation » québécoise, non ? Ce sont nos voisins, nos amis, nos collègues. Parallèlement, c’est aussi l’histoire qui explique la Révolution tranquille, comme exigence de reconnaissance de la part d’une population majoritaire dans la province, mais dominée sur le plan culturel, économique et social, par une minorité qui avait accaparé les leviers décisionnels du Québec au fil des décennies, depuis le XIXe siècle.
Qui se souvient que dès le début du XXe siècle, les francophones ont essayé de légiférer pour plus de bilinguisme, notamment dans les commerces, parce que l’affichage était très majoritairement en anglais ? Qui se souvient qu’il fallut attendre les années 1960 pour que l’on prenne conscience que le risque d’assimilation était réel, avec l’augmentation d’une immigration qui allait surtout vers l’anglais ? N’oublions pas non plus que les lois qui consacrent les traits distinctifs du Québec ont été votées par une assemblée élue démocratiquement. Cela se respecte. Le gouvernement fédéral qui a utilisé massivement ses moyens logistiques et financiers pour influencer le vote du deuxième référendum, en 1995, a-t-il été poursuivi en justice ? Les Canadiens se sont-ils érigés contre ce mépris du droit d’un peuple à disposer de lui-même ?
Par ailleurs, cessons la démagogie en agitant le spectre de la disparition du français : même si une majorité des Montréalais ont aujourd’hui l’anglais comme langue « à la maison », que les cégeps anglophones ont abusé du système en anglicisant les élèves qui sortaient du secondaire francophone, que l’anglais progresse dans certains domaines professionnels, le français se porte vraiment mieux qu’au moment où la loi 22 a été adoptée. C’est prouvé. Toutefois, dans une société plus diverse et multilingue, notre identité collective peut et doit se définir autrement que sur notre (nos) langue(s), mais l’on doit simultanément s’assurer que les Québécois maitrisent le français.
Chroniques martiennes I
Didier Périès
Vous allez tiquer à la lecture de ce titre, mais il est venu si vite et naturellement ! Comprenez que la semaine dernière, je suis parti en France, terre des trente-six premières années de ma vie… et je l’ai à peine reconnue. Un peu comme si j’étais sur une autre planète. J’aurais pu fermer les yeux sur la réalité, rester dans les clichés : « Paris reste Paris » ou « Ah ! Ces Français, toujours en grève ou en train de râler », ou encore « Les baguettes, le vin et les chocolatines, c’est la vie ! ». Mais là, je parle d’autre chose, de la France hors des clichés, celles vue d’en bas : je suis originaire de la région toulousaine, d’un milieu très modeste, à l’instar d’une majorité de Français, et pas de l’élite bobo parisienne.
Et si j’ai été frappé par la détérioration du climat social et économique depuis pas mal de temps (peut-être l’une des raisons de mon immigration), l’actualité de ces derniers mois n’a fait que confirmer mon analyse. Notez bien que la polarisation grandissante de la vie politique ou les heurts sociaux ne sont pas l’apanage de la France : la plupart des pays du nord global connaissent la même évolution. Au plus fort d’une globalisation angoissante pour plusieurs, le réflexe est souvent au repli identitaire, « national », en opposition aux étrangers - immigrants ou pas - alors que les systèmes démocratiques craquent sous la pression des extrêmes et que le tissu social se détériore, que les solidarités se défont. Le spectre politique s’est « droitisé » depuis 20 ans, à une vitesse alarmante et même dans les pays à la tradition sociale la plus forte. Comme la France.
Alors, ce premier texte venu outre-Atlantique portera évidemment sur les élections législatives, équivalentes à nos élections parlementaires. Suite aux résultats des élections européennes, il y a un mois, qui ont vu le Rassemblement national (RN) obtenir le plus de députés français à Bruxelles, contre la gauche, fragmentée en au moins quatre partis (les écologistes, les socialistes, les communistes et La France insoumise — LFI — du polémiste Mélenchon) et contre la droite, représentée principalement par le parti du président Macron et par le parti des Républicains (LR), respectivement en troisième et quatrième position. Premier coup de tonnerre donc dans un paysage politique français déjà largement recomposé hors des partis traditionnels, puisque LFI (extrême gauche) et le RN (extrême droite) se retrouvaient en tête !
Là-dessus, deuxième coup de tonnerre, le président Macron dissout l’Assemblée nationale. Il en a le droit, et je pourrais écrire un autre éditorial uniquement sur les raisons de cette décisions. Mais plus importante est la conséquence immédiate : pour la première fois depuis la deuxième Guerre mondiale, l’extrême droite (oui, oui, la même que l’on retrouve en partie dans les rangs de notre Parti conservateur ou du Parti populaire), cette droite nationaliste, populiste, ultraconservatrice, xénophobe, avait une chance d’accéder au pouvoir, comme parti majoritaire au parlement. Or, même s’il reste le président à la tête de l’exécutif (élu lors d’élections présidentielles aux 4 ans), le premier ministre est par convention choisi parmi le groupe parlementaire dominant ! Finalement, il s’avère que, malgré le doublement de son nombre de députés qui le place en tête de tous les autres partis, le RN ne constituera pas une majorité… Ainsi, le pire semble évité, mais est-ce vraiment le cas ?
Chroniques martiennes II
Didier Périès
Je disais dans mon éditorial précédent que j’avais eu l’impression d’atterrir sur une autre planète lors de mon arrivée en France, il y a deux semaines, et combien le paysage de la France avait changé, au moins politiquement… et en fait socialement aussi, alors que les disparités de revenus augmentent partout dans nos sociétés du nord global ; les riches toujours plus riches et les pauvres encore plus démunis voient se creuser le gouffre entre eux dans tous les domaines : accès au logement, à la santé, à l’éducation, aux opportunités économiques et à la qualité de vie en général.
En France, cette situation a pour corollaire une grave détérioration du climat politique, sur la place publique comme au parlement, où on ment, où on s’insulte et on s’oppose à tout sans rien proposer en retour (ça vous rappelle quelqu’un ?). Poliment, les commentateurs appellent cela la polarisation. En fait, il s’agit plutôt d’un déversement mutuel de haine. Or, désormais, les positions sont tellement campées, la confrontation tellement radicale que la paix sociale s’en trouve compromise.
Pour preuve, le nombre d’agressions verbales et physiques qui ont eu lieu pendant la campagne : 51 candidats chahutés ou militants attaqués pendant l’affichage, des manifestations et contre-manifestations qui ont fini par être interdites, des insultes racistes et homophobes à foison… J’ai vu sur les murs des graffitis du style « Mort aux fachos [fascistes] ! », « Mort aux woke [les Insoumis] » !
Sérieusement ? On ne devrait pas menacer ainsi ce qui n’est finalement qu’un adversaire politique, pas un ennemi, avec des amalgames erronés : le RN n’est pas un parti fasciste, il est juste xénophobe, antisémite, homophobe, populiste, ultranationaliste et à la limite du complotisme ; LFI n’est pas un parti « woke », elle défend aveuglément toutes les minorités, est démagogue, brutale, antisémite, « anti-élite » et populiste. Les points communs sont évidents entre ces deux formations politiques, ils sont normaux dans un contexte, où l’on ne peut plus que s’insulter et démoniser l’Autre, au lieu de discuter et d’échanger des arguments.
L’affaire des gilets jaunes en 2018-2019 montrait déjà la fracture profonde entre la France « d’en bas » et celle « d’en haut » — personne n’a-t-il jamais pensé que nous sommes tous dans la même galère en réalité ? — après les deux années de CoVid-19 et les manifestations massives contre la réforme des retraites en 2023, les dernières semaines l’ont définitivement confirmé. La question est maintenant de savoir si nous faisons face à une situation sans retour. Quelle réponse y apporter ? La démocratie peut-elle laisser des partis qui ne jouent pas « le jeu » prendre le pouvoir ? Le taux de participation record — près de 70 % — semble illustrer une prise de conscience… Mais maintenant les résultats connus, les différentes parties en présence ne veulent pas négocier ou s’entendre entre elles au nom de la démocratie…
Désormais, à l’Assemblée nationale française, trois blocs minoritaires — incluant celui du président sortant — s’affrontent ; cela masque un éclatement en onze formations, (malheureusement) assez représentatif de la société française : autant de factions aux visions figées et antagonistes. La société française, une fois passée la ferveur inquiète du front républicain contre une éventuelle prise de pouvoir de l’extrême droite, n’a pas avancé d’un pas dans la résolution des conflits existentiels qui la parcourent. À nous de rester vigilants, ici au Canada, de ne pas tomber dans les mêmes travers.
Une vie sans voiture
Ian Barrett
L'environnement est au cœur de la couverture médiatique et de la politique gouvernementale. Un certain nombre d'avancées technologiques contribuent à réduire notre empreinte carbone, notamment l'efficacité énergétique des voitures, ainsi que la transition vers les véhicules électriques. Cependant, même les véhicules électriques ont une empreinte carbone, principalement au cours du processus de fabrication.
Par ailleurs, le coût d'une voiture est également devenu un défi. Les prix des assurances et des réparations dans les garages ont connu une hausse à deux chiffres depuis le début de l'année 2023. Une nouvelle taxe municipale sur l'immatriculation des véhicules devrait également entrer en vigueur l'année prochaine. Les voitures pèsent de plus en plus lourd sur nos budgets.
Dans la région de la capitale nationale, rares sont les endroits où il est possible de vivre sans voiture. Pratiquement tous les quartiers construits au cours des 50 dernières années ont été conçus pour permettre aux habitants d'avoir leur propre véhicule. Pourtant, il existe une exception notable : le centre d'Aylmer.
Tout d'abord, une grande partie de la région dispose de l'un des meilleurs services offerts par la STO. Si vous habitez à distance de marche d'un arrêt des lignes 59 ou 55, vous bénéficiez d'un service fiable et fréquent vers le centre-ville. Les lignes 49 et 50 offrent des options pour se rendre dans les cégeps de Hull, et la ligne 58 permet de se rendre au Pré Tunney.
Nous sommes très chanceux de disposer d'un certain nombre d'autres commodités. Quatre épiceries se trouvent à distance de marche d'une grande partie du quartier. Plusieurs proposent des commandes en ligne qui peuvent être livrées à domicile, Laflamme livrant à votre porte en quelques heures.
Il est parfois nécessaire d'avoir accès à une voiture pour se déplacer en dehors des zones desservies par les bus. Or, Aylmer dispose d'une bonne flotte de voitures CommunAuto, disponibles à court terme et que vous pouvez louer à des prix très raisonnables pour quelques heures. C'est d'autant plus vrai par rapport aux prix pratiqués par les agences de location de voitures traditionnelles de nos jours.
Lorsque nous voulons sortir pour dîner ou prendre un café, nous disposons de l'une des meilleures sélections de cafés et de restaurants, tous situés sur notre rue principale ou à distance de marche de celle-ci. Le port de plaisance se trouve également à quelques pâtés de maisons.
Et nous avons accès à l'un des meilleurs réseaux cyclables que l'on puisse imaginer, en particulier la piste qui longe la rivière. Pouvoir faire du vélo jusqu'au centre-ville sans franchir un seul feu rouge est incroyable, sans parler des magnifiques paysages qui s'offrent à nous tout au long du parcours.
Les écoles sont également nombreuses et généralement accessibles à pied.
Pour les achats d'articles plus importants, nous avons bien sûr Amazon et Walmart qui peuvent livrer la plupart des produits à nos portes en un jour ou deux. Des magasins comme Rona et Lowe's offrent également de bonnes options de livraison, de même qu'un nombre croissant de petits magasins.
De toute évidence, bon nombre de ces avantages ne s'appliquent pas à des quartiers comme Deschênes et certaines parties de Wychwood. Pourtant, ceux d'entre nous qui habitent le centre d'Aylmer ont la possibilité de se passer de voiture, ce qui n'est généralement le cas que dans les grandes villes comme Montréal, New York ou Londres. Nous sommes très chanceux. (Traduit)
Chroniques martiennes III : Savoir (bien) vivre
Didier Périès
Je reviens d’Europe, mais surtout de France et d’Allemagne. J’ai passé une semaine complète à Berlin pour la deuxième fois. Les connaisseurs me diront que Berlin ne représente pas forcément l’Allemagne. Et à maints égards, je suis tout à fait d’accord. Chose certaine, il y a une manière de vivre et de vivre en ville typiquement berlinoise, et elle est très agréable.
Outre le fait que l’urbanisme est novateur (architecture variée, avec de l’ancien – malgré les ravages des guerres – et du nouveau, plus design), il vise clairement la densification. La nature déteste le vide, alors on construit, mais des immeubles à trois ou quatre étages, respectant ainsi l’échelle humaine et les données scientifiques sur la perte d’énergie et de chaleur au-delà de trois étages. Parallèlement, les voies pour se déplacer sont larges : du côté est de la ville, comme l’architecture de style soviétique donnait la primeur aux grandes avenues rectilignes et aux grands ensembles, elles prédominent ; côté ouest, par principe, parce qu’une voie n’est pas seulement faite pour les voitures, les camions et les transports en commun, mais aussi pour les vélos, les trottinettes et les piétons. Tout cela peut se côtoyer en bonne intelligence, à condition de laisser l’espace pour et d’avoir un minimum de discipline. Nous, ici, au Canada, possédons cette dernière - on peut le constater quotidiennement aux intersections avec quatre arrêts - mais où est la volonté de libérer la place à tous les autres? La voiture est encore trop souvent reine sur l’asphalte.
Se déplacer à Berlin est un bonheur en général: bien que les odeurs soient parfois désagréables – je vais y revenir – on passe aisément d’un mode de transport à l’autre. La fréquence, le maillage et le coût des transports publics sont incitatifs : un ticket unique pour tout! Il faut être fou pour utiliser sa voiture dans Berlin, et il y a de toute façon des Uber et des taxis… ou des véhicules du genre de Communauto, mais que l’on peut laisser n’importe où après utilisation! Il y a tout et pour tous : métro, tramway, autobus et, pour les plus individualistes, trottinettes ou vélos. Les vélos sont d’ailleurs partout en ville, plus nombreux que les humains!
Enfin, partout l’on perçoit un esprit d’ouverture et de liberté, certains diraient de laisser aller, je dirais plutôt de lâcher prise afin de mieux savourer l’instant présent : la propreté laisse à désirer dans les espaces publics, c’est vrai ; les espaces verts sont souvent en jachère, mais, il y en a tellement… On peut s’habiller comme on veut, être qui on veut, sans recevoir de regards effarouchés, lubriques ou réprobateurs, dans un éclectisme parfois étonnant visuellement, mais si rafraichissant!
Les gens semblent prendre le temps de vivre, de flâner, de s’arrêter à une terrasse : les parcs, les cafés et les restaurants sont pléthores et bien remplis. Aller au boulot, puis revenir vite chez soi pour profiter de sa maison, de sa cour arrière, de son bain à bulle, de son chalet ; sortir seulement pour faire les courses ou quelque autre activité « utile », sans prendre le temps d’apprécier le moment présent, tout cela est aux antipodes du savoir-vivre berlinois. Pensez, comme dit le poète que « le temps passe, hélas, mais nous passons… ».
Ceux qui vont mourir pour toi…
Didier Périès
Il est vrai que nous n’en sommes pas rendus là, dans le style « Squid game », cependant, et alors que nous venons de célébrer la fin des Jeux Olympiques de Paris 2024, une ou deux choses me taraudent.
D’abord, j’ai failli intituler ce texte « Grandeur et décadence », tant le faste et la somptuosité ont caractérisé la cérémonie d’ouverture, en plein Paris, mais également toutes les épreuves. Imaginez faire votre combat de judo sur le Champ de mars, celui de Taekwondo au Grand Palais du Louvre, vos épreuves d’équitation au Château de Versailles, d’athlétisme sur la place des Invalides ou au Stade de France, le skateboard, place de la Concorde, le tennis évidemment à Roland-Garros, mais le volley-ball de plage au pied de la Tour Eiffel, etc. l’idée du comité français de placer les jeux au cœur de la ville est géniale… et mégalo!
La France en plein chaos politique, dans une Europe en crise (politique, sociale, économique) nous sort les Jeux du siècle ; elle nous a procuré une quinzaine haletante, captivante, spectaculaire. Justement, l’autre titre auquel j’avais pensé, était « Panem et ludus », du pain et des jeux, en référence à la fameuse maxime romaine, qui fut même, pour certains empereurs de l’époque, leur seule politique. Comment distraire le bon peuple des véritables enjeux et acheter la paix sociale? Et bien là, si l’inflation alimentaire peine à baisser, en France comme à l’étranger, pour le reste, nous avons été servis.
Je dirais même, plus que jamais. Avez-vous remarqué les rituels qui se sont installés désormais? Je ne parle pas des trois coups de bâton théâtraux au début de chaque compétition, ils viennent en fait du théâtre classique, où ils inauguraient les représentations. Selon les organisateurs, un lien avec la culture, pour moi, toujours plus de spectacle. En effet, ajoutez-y le meneur de claques au micro, la musique tonitruante à la moindre pause, le compte à rebours à voix haute, les spectacles pendant le mi-temps et les « personnalités » de tous horizons – pas que sportives – impliquées (Lady Gaga ?), cela ressemble de plus en plus à un Superbowl!
On ne peut nier la qualité des athlètes eux-mêmes, leurs performances parfois surhumaines, leur persévérance et leur abnégation : combien de sacrifices pour quelques minutes de gloire (relative)? Et voyez l’adulation de la foule! Ce sont nos dieux modernes, à l’instar des gladiateurs ou des conducteurs de char de la Rome antique. On passe sous silence les séquelles psychologique et physique, à vie, que laisse la quête plutôt vaine du record ou de la médaille. « Altus, fortius, citius… », plus vite, plus haut, plus fort… Une quête à la mesure de l’esprit humain et de son orgueil démesurés, qui font aussi parfois, certes, sa beauté.
Enfin, comment ne pas parler de la déferlante d’esprit patriotique, de ferveur nationaliste, surtout des Français, une passion pas comme les autres, parce qu’elle a notamment conduit à tous les grands conflits armés de l’époque moderne… Dire que certains voient en elle une solution à la mondialisation et à ses désastres! Cette émotion est puissante. Et mieux vaut que nos pays se battent à travers les sports qu’avec des armes. Certainement, mais pas au prix de notre silence sur les grands enjeux de notre époque.
Le doigt dans l’engrenage
Didier Périès
Hiroshima? Nagasaki? Vous connaissez forcément. Ce n’est ni de la fiction ni de l’abstraction. Juste la triste réalité d’une invention civile, et même purement théorique à ses débuts (merci la recherche fondamentale !) qui a conduit à la mort de quoi ? 110 000, 150 000, 200 000 personnes? Les chiffres varient selon les analyses, mais la vérité est que les premiers ont littéralement fondu sous l’effet de la chaleur de l’explosion nucléaire et les derniers sont morts dans les souffrances horribles des métastases qui envahissaient leur corps depuis des mois ou des années sous l’effet des radiations… je vous passe les détails.
On dit souvent que « la mémoire est une faculté qui oublie », nous ferions bien de nous en rappeler à l’heure où le débat est vif autour de Chalk river chez nous, en Outaouais, mais beaucoup moins à plus grande échelle. En effet, au Québec, notre ministre de l’économie, de l’innovation et de l’énergie et des amis bien placés dans l’industrie prépare le terrain en déclarant à toutes occasions qu’il faut réfléchir à la relance du nucléaire ; Doug Ford, en Ontario, promet monts et merveilles avec ses mini-réacteurs nucléaires – une technologie inaboutie, très loin de pouvoir fournir la quantité d’électricité demandée ; et ailleurs dans le monde, de grandes compagnies AtkinsRéalis (SNC-Lavalin) se lèchent les babines en annonçant des opportunités monstres.
Pourquoi? Reconnaissons-le, les besoins en électricité augmentent aussi vite que la température moyenne autour du globe et la fréquence des épisodes de canicule ou d’inondations… de 470 TWh aujourd’hui, nous devrons trouver 555 TWh en 2050 : 20% d’augmentation en une génération? Par quels moyens les moins polluants possible (on doit simultanément freiner la crise climatique) ? Donc, s’il est nécessaire de réduire l’utilisation du charbon, du pétrole ou du gaz, il n’est pas certain que la biomasse, les parcs éoliens, l’énergie solaire ou marée-motrice réunies puissent satisfaire cette demande. Pas « besoin », « demande » plutôt : si nous surveillions mieux notre consommation, nous faudrait-il autant d’électricité ? Et où se situe le nucléaire dans tout cela?
Vous vous rappelez mon topo historique du début? Et bien, il faut comprendre qu’une centrale à fission nucléaire – ce que l’on fait déjà depuis 1938 – et une bombe nucléaire, c’est la même source d’énergie… et les mêmes dangers pour toute forme de vie. La fission, soit la séparation de deux atomes d’uranium ou de plutonium, produit des déchets, notamment les restes du noyau lui-même, qui contaminent tout ce qui l’entoure ; il faut donc décontaminer ou à défaut les isoler, les enterrer, etc. en espérant que les radiations n’en sortiront jamais… Quid des tremblements de terre ou autres fuites dans les nappes phréatiques? Il ne reste qu’à croiser les doigts ou à prier.
Nous devrions tous nous sentir concernés, en tant que citoyens globaux, quand on voit la surenchère actuelle de menaces militaires (Corée du Nord, Russie), mais plus près de chez nous, avec des sites comme Chalk river. Le nucléaire, on sait comment cela commence, mais pas où cela s’arrête… Et de fait, si la plupart des produits de la fission de l’uranium 235 ont une courte durée de vie (quelques dizaines d’années), les 10% restants, qui concentrent 99,9% de la radioactivité, demeurent actifs jusqu’à plusieurs milliers d’années.
La fiction américaine
Didier Périès
Quel spectacle ! Quelle leçon ! Je reviendrai sur ces aspects-là, mais il faut avouer que la Convention démocrate aux États-Unis, la semaine dernière, a été incroyable ! Même moi, qui ne suis pas américain, mais un peu, je l’avoue, anti-américain, même moi, j’ai été bluffé. Qui n’eût pas été inspiré, galvanisé, attendri et renforcé dans son humanisme par ces trois soirées menées tambour battant, selon un scénario et une scénographie soigneusement étudiés ?
Par où commencer tant il y a à dire ? D’abord, l’objectif était de lancer pour de bon la candidature de Kamala Harris à la présidence du pays, d’une part par le vote des représentants démocrates de chaque état et l’acceptation de ladite candidate, mais également en la présentant au public, au grand public (20 millions de spectateurs et plus chaque soir). Par un savant mélange de témoignages, du simple citoyen jusqu’aux anciens présidents, en passant par toutes sortes de personnes, y compris des républicains ! il s’agissait de montrer différentes facettes de la personnalité et des compétences de la potentielle 45e présidente des États-Unis, de l’humaniser, de faire en sorte que les citoyens lambda puissent s’identifier à elle.
Parallèlement, puisque la campagne est déjà lancée et que Kamala Harris y embarquait avec du retard, il fallait contre-attaquer, proposer une alternative à Trump (et à Biden), une vision politique — « For the future » n’est d’ailleurs pas très original, mais s’oppose parfaitement au « MAGA » du milliardaire — offrir une tête différente. Très rapidement le ton a été donné : Kamala Harris et tous les démocrates présents ont apparu souriants, affectueux, gentils, respectueux, optimistes, enthousiastes, j’allais dire à l’excès, mais je crois sincèrement que la candidate est ainsi naturellement : Trump ne se moque pas de son rire sans raison ; elle rit souvent. Où est le mal d’ailleurs ?
Mais le ton, le message autant que la mise en scène, aussi spectaculaire a été cette dernière (« Big is beautiful » chez nos voisins du sud, c’est confirmé), ce que l’on peut retenir de tout cela, c’est l’optimisme, la pensée positive qui s’en dégagent, l’espoir. Espoir qu’une seule personne peut tout changer, dans le pays et hors du pays ; espoir que l’avenir peut-être plus brillant que le passé, le système économique plus équitable, la société moins polarisée, la crise climatique prise à bras-le-corps, parce que nous le voulons. Ces trois soirées ont été une ode à l’humanisme — et je pèse mes mots — au potentiel humain de prendre en main son avenir, d’embrasser son destin et de changer les choses… pour le mieux. Non pas en cherchant sa force dans les sentiments de revanche, de haine et la division, mais par un combat intègre, respectueux, avec amour et dans l’union. Non pas contre, mais avec. Quoi de plus enthousiasmant pour toute personne qui croit en la démocratie ?
Certains fâcheux, desquels je suis peut-être, remarqueront que la réalité américaine est tellement loin du portrait positif qui a été peint en creux lors de ce spectacle outrancier, au jovialisme exagéré et artificiel, qui n’est finalement que de la poudre aux yeux. Parce que finalement, la vraie question n’est pas si Kamala Harris peut battre Trump, mais plutôt si elle est réellement capable de changer ce qu’est l’Amérique. On aimerait tant y croire et par le fait, on souhaiterait tellement trouver ici, au Canada, des candidat-e-s avec pareille stature !
La rentrée
Didier Périès
Vous vous attendez à ce que j’aborde la rentrée scolaire, qui constitue une actualité d’autant plus brulante que nous faisons face ici, au Québec, mais plus largement au Canada et dans les pays du nord, à une désaffection de la profession enseignante. Il s’agit même d’une crise existentielle de nos systèmes d’éducation, dont le modèle, les objectifs, la reconnaissance et les moyens semblent de plus en plus dichotomiques.
Mais non ! Je vais parler d’une autre rentrée, qui concerne quand même près de la moitié d’entre vous, celle des fonctionnaires fédéraux. En effet, la semaine dernière marquait une nouvelle étape dans le « retour à la normale » que souhaite l’équipe Justin Trudeau pour les employés du gouvernement canadien. De quoi s’agit-il ? Tout simplement, de venir une fois de plus dans la semaine, en présentiel, au bureau. Ce qui porte à trois jours semaine l’obligation légale de se rendre au bureau (et d’y rester la journée) pour les 367 000 fonctionnaires en question ; en fait, c’est quatre jours pour les cadres ou gestionnaires.
Rappelons-nous que, passé le soulagement de voir la pandémie de Co-Vid19 officiellement derrière nous et de revenir (progressivement) au travail, déjà un mouvement de grogne s’est amorcé depuis 2023 à l’idée de quitter le télétravail… avec une perception plutôt négative de cette réticence dans la population active qui, elle, est revenue à temps plein en présentiel. Les fonctionnaires, déjà considérés comme des privilégiés paresseux, d’éternels râleurs qui profitent du système, voudraient donc continuer de vivre dans le confort de travailler depuis chez eux, quelques heures par jour, avec leur salaire incroyable et tous les avantages sociaux qu’offre leur statut ? Le beurre et l’argent du beurre, quoi !
Or dans toute grande structure, par exemple les très grandes entreprises, on trouve en fait des tire-au-flanc, des employés dans leur niche dorée, où ils peuvent faire peu tranquillement et avoir un bon salaire. Soyons honnête et reconnaissons que la plupart de ces employés sont intègres, font leurs heures — et pour ceux que je connais, même plus — sans rechigner, conscients qu’ils sont au service de la population et qu’ils sont privilégiés de se trouver ici et maintenant, employés du Gouvernement du Canada.
À vrai dire, la convoitise et le mépris qu’ils subissent de plusieurs ne servent pas le grand public. Pourquoi ? 1. Parce que reconnaitre et bien payer les fonctionnaires permet en général d’éviter la corruption, ce qui est un fléau dans les gouvernements autoritaires ou ultralibéraux. 2. Parce que la fonction publique est un baromètre du progressisme d’une société (l’état est là pour réduire les inégalités et équilibrer les chances de tous) 3. Enfin, parce que l’échelle salariale et les avantages sociaux de nos fonctionnaires servent de modèle pour le secteur privé, dont les employés peuvent dès lors, à juste titre, réclamer de meilleures conditions d’emploi et de rémunération. Cela titre tout le secteur de l’emploi vers le haut.
Et l’argument économique ne tient pas : la productivité des employés fédéraux n’a pas baissé. Au lieu de perdre du temps et faire des dépenses dans les transports, ils ont davantage consommé autour de chez eux, revitalisant leur coin de ville — et gagné du temps (ce qui revient à être plus efficace dans leurs tâches), tout en vivant mieux. Où est le crime ? Inspirons-nous d’eux plutôt que de retourner en arrière.
« Ma petite entreprise ne connait pas la crise… »
Didier Périès
Officiellement, nous ne sommes pas en récession, le Canada connait même une croissance… de 1,1 % en 2023 et au deuxième trimestre 2024, plus forte que prévu ! La Chine, par exemple, était en pleine crise existentielle avec ses 3 % à la sortie de la CoVid-19 en 2022… En tout cas, la neuvième puissance possède aujourd’hui une économie à 103 % de ce qu’elle était avant la pandémie. L’inflation est à 2,5 %, et pour plusieurs, cela semble si bon que la Banque du Canada a baissé son taux directeur de 0,25 %, pour atteindre 4,25 % ; le chômage est à 6,6 % (en hausse) ; les salaires croissent, mais de moins en moins, parce que la main-d’œuvre disponible augmente l’offre de travail… Tout le monde a de quoi se loger de façon abordable, de quoi manger « santé » à prix raisonnable et de quoi se déplacer pour trois fois rien, histoire de ne pas s’endetter et polluer davantage. On est heur-eux !
À part que l’on peut faire dire aux chiffres à peu près ce que l’on veut : avez-vous compris quoi que ce soit au jargon que j’ai employé ? Ce que ces indices abscons signifient et leurs implications ? Ainsi, sur quoi se base-t-on le concept de croissance ? Il s’agit du taux de variation du le Produit intérieur brut (PIB) entre le début et la fin de la période étudiée, disons sur la durée d’une année… Mais sur quoi se fonde le calcul du PIB ? Il s’agit de la valeur du total de ce qui est produit comme biens et services dans un pays par les entreprises nationales et étrangères qui s’y trouvent. Plus précisément et sous forme d’équation : PIB = Dépense de consommation finale + Formation brute de capital + Exportations — Importations. Et tenez-vous bien, il est donné en dollars. Par exemple, au Canada, en 2021, il était d’environ 2 000 milliards de dollars, aujourd’hui équivalent à 45 000 dollars par habitant.
Bref, nous produisons plus. Et alors ? Où va tout cet argent ? Que cela signifie-t-il en termes de pouvoir d’achat ou de solidarité sociale ? Qui s’enrichit vraiment ? Qui est en meilleure santé, mieux éduqué, avec un avenir plus favorable ? Comment ces milliards sont-ils répartis entre nous ? Sommes-nous plus heureux ? Parce que s’il me semble voir toujours plus de voitures et de condos de luxes, de gens qui partent dans le sud ou qui consomment frénétiquement des produits et services électroniques au détour du moindre solde, le caddie rempli à ras bord au Costco du coin.
Vous me rétorquerez qu’il se trouve également une population grandissante au Super C, à Un dollar ou deux, dans les banques alimentaires ou en faillite personnelle. Sont-ce les mêmes personnes ? Non, mais premièrement, les écarts de revenus grandissent chaque année et deuxièmement, quelle sorte de société « riche » et « en croissance » accepte une telle situation ? Ce qui se passe entre nous ici, le système le reproduit entre pays tout autour du monde. Je parle ici d’injustice à grande échelle, d’iniquités flagrantes. Le pire est que toute cette réalité un peu abstraite parfois, quand on écoute nos experts économiques ou financiers, mais finalement concrète et proche de notre quotidien, est consubstantielle du véritable défi de notre époque, le mal du siècle : la crise climatique.
Une grogne justifiée
Didier Périès
Je ne parle pas ici au nom des fonctionnaires fédéraux, mais bel et bien de toute la population qui se retrouve sur les routes de Gatineau, d’est en ouest et du nord au sud. Le fait était difficile à ignorer la semaine dernière : aux heures de pointe, le matin entre 7 h et 9 h, et l’après-midi, entre 15 et 18 h, les automobilistes et les passagers des autobus ont vécu l’enfer. Bien sûr, il faut nuancer la formulation : c’est à l’échelle de la région et des gens qui transitent entre le Québec et l’Ontario surtout, après l’épidémie de Covid-19, où les déplacements étaient réduits à deux fois par semaine pour les fonctionnaires fédéraux… Désormais, avec un retour au travail en présence de trois jours pour les employés et de quatre jours pour les gestionnaires, la donne a changé.
Or, les observations sur le télétravail sont claires et indéniables : pas de perte de productivité, un meilleur aménagement famille-travail, des économies de budget transport, moins de fatigue et de stress dus au transport, moins d’émissions de CO2… et même plus de disponibilité — et oui, on commence à travailler seulement quand on arrive au boulot, pas au lever du lit, et plusieurs ne ramèneront pas leur ordinateur à la maison. Attention, je veux bien admettre qu’il y ait eu des tricheurs qui aient abusé de leur « présence obligatoire » chez eux afin de faire l'école buissonnière, mais c’est marginal.
Le gouvernement fédéral canadien aurait même pu se montrer leader en inaugurant un aménagement du travail plus efficace : si les assistants administratifs dont plusieurs tâches relèvent de la vie de bureau, de l’organisation de réunion, etc., pourraient rentrer plus souvent au bureau, pour plusieurs autres, dépendant des départements, des secteurs d’activités ou des ministères peuvent tout aussi bien œuvrer depuis la maison la plupart du temps. Forcer le retour en présence à trois — et pourquoi pas bientôt à quatre ou cinq jours ? — pour faire des réunions sur Teams ou Zoom, bonjour l’esprit d’équipe et la socialisation !
De surcroît le gouvernement fédéral a réduit son parc immobilier (pour réduire ses dépenses) et a dans plusieurs ministères réaménagé les espaces de travail, au détriment des bureaux individuels, au point de ne plus pouvoir accueillir tous les employés simultanément…
Finalement, après réflexion, j’ai trouvé un seul motif rationnel à cette obsession de l’équipe libérale de Trudeau de jouer ce jeu-là ; elle n’est ni économique ni altruiste, mais politique : vous croyez vraiment à l’influence du maire Suthcliffe pour revitaliser un centre-ville déserté pendant la pandémie ? Non, c’est plus simple et pathétique : face aux conservateurs de Poilièvre en période pré-électorale, faire bonne figure en justifiant que les fonctionnaires canadiens ne sont pas payés pour rester chez eux (sous-entendu, pour ne rien faire), que leur temps de présence est comptabilisé exactement (les contrôles vont augmenter).
Ce qui ajoute au chaos ambiant de ces allers-retours quotidiens et qui risque fort de continuer, c’est la quantité de travaux de construction, le nombre hallucinant de déviations, de rues coupées, de rétrécissement de chaussée partout sur les axes routiers les plus fréquentés. Qui a eu la brillante idée de les prévoir en août et en début d’année scolaire? Tous les paliers de gouvernement se sont-ils donné le mot? Y a-t-il un pilote dans l’avion?
Une cigale devenue fourmi
Didier Périès
Le premier ministre Legault s’est déjà pas mal commis à faire ce que Trudeau et la majorité des autres avant lui ont fait : dire n’importe quoi pour rester au pouvoir ! Cela, bien que nous le connaissions très axé sur l’économie, adepte d’une idéologie qui ne voit pas de problème à la collusion entre le politique et la finance ou l’industrie. Mais là, il pousse le bouchon un peu loin dans l’aveuglement volontaire.
Au nom de l’optimisation, que d’autres avant lui ont appelé « rigueur » ou « réingénierie de l’état », il a décidé de sabrer sans vergogne dans tous les secteurs névralgiques du bien-être collectif. Personnellement, j’avoue que le déclic a été l’annonce récente de la baisse de 50 % du budget de fonctionnement dans les Cégeps. Comme ça, du jour au lendemain, et quelques jours à peine après la rentrée scolaire. Remplacer des toilettes, installer de nouveaux laboratoires ou rénover les installations sportives ? Pourquoi donc ?
Si lors de la pandémie, il a de manière très pragmatique ouvert les cordons de la bourse, comme un bon père de famille qui prend les moyens de s’occuper de ses enfants malades, il a aussi subrepticement déplumé les CLSC : qu’y fait-on aujourd’hui ? Nul ne le sait, d’ailleurs, la plupart d’entre nous ne savent pas non plus où ni comment faire des analyses médicales, se faire vacciner ou obtenir une visite de routine.
Il a utilisé nos impôts pour augmenter les dividendes des actionnaires de Northvolt. Il a dilapidé des milliards de dollars, à coup de 500 $ pour chaque ménage québécois, ce qui a rempli notre panier à l’épicerie le temps d’une semaine ou deux, au lieu de plafonner les prix des denrées de base. Entre les chambres à 800 00 $ pour les ainés des maisons des ainés, le salon bleu et un sixième lien à Québec, on ne sait plus où son jugement de chef d’entreprise peut l’amener… Maintenant, il s’attaque à ce qu’il peut, parce que, ô surprise ! son gouvernement a creusé un déficit public qui atteint 11 milliards.
Bon, comme tout le monde, je joue l’effarouché, sans avoir aucune idée claire de ce que cette somme représente… Tiens, c’est comme si chacun-e des résident-e-s du secteur Aylmer touchait un revenu annuel médian après impôt de 70 500 $. Est-ce que Legault craint que les agences de notation baissent la côte du Québec et que cela dissuade les investisseurs étrangers de venir chez nous ? Les mêmes (Northvolt, Volkswagen et Stellantis-LGES) à qui on promet 43,6 milliards d’aides publiques sur 10 ans ? En tout cas, comme je le disais, c’est la valse des coupures drastiques : demandez aux CISSO ou aux universités du réseau public, qui ont vu leur budget d’entretien fondre de 80 %.
Ironiquement, la CAQ renie un paquet d’engagements auxquels elle semblait tenir mordicus, tels que le programme de subvention à l’achat de véhicules électriques (début de la baisse à partir de janvier 2025, pour disparaitre le 31 décembre 2026) ; ou la francisation, qui, dans certains centres de service scolaires, a été amputée de 90 %. Un grand enjeu d’intégration des immigrants et de cohésion sociale, en plus de défendre le fait français en Amérique du Nord ? Voyons donc ! Il ne le sait pas, mais le roi Legault est nu, et c’est plus évident que jamais.
Un long samedi de trouvailles
Didier Périès
Il y a de ces coïncidences ! Ou bien est-ce mon esprit, un peu tordu parfois, qui fait des liens incongrus ? En tout cas, samedi dernier, alors que les traditionnelles manifestations avaient lieu contre la crise climatique et les demi-mesures de « transition « ou d’« adaptation » de nos gouvernements, se tenaient d’autres évènements à saveur environnementale qui pouvaient élargir notre vision.
D’abord, la création originale de l’une de mes anciennes élèves de l’école secondaire Grande-Rivière, Clémence Roy-Darisse : un déambulatoire théâtral et horticole dans le boisé en arrière de l’UQO, qui avait pour thème « le deuil écologique des arbres incendiés », certes conçu cette fois-ci comme un laboratoire, mais une œuvre déjà unique et interactive à laquelle le public était invité à se joindre, pour être mieux conscientisé sur notre rapport à la Nature ! Et coïncidence, elle s’était adjoint la collaboration de deux « sorcières » de ma connaissance : Nicole McIvor (ancienne collègue de Grande-Rivière) et Charlotte l’Orage, avec qui j’ai fait de la création poétique. Incroyable !
Mais ce n’est pas tout. Samedi après-midi avait également lieu le premier événement sportif d’une série que l’on espère longue : « Courons Gatineau ». Les organisateurs de la Gatineau Loppet, qui ont connu divers échecs ces dernières années, à la suite d’hivers trop doux notamment (merci la crise climatique !), ont opportunément lancé cette série de courses d’automne (2 km, 5 km et 10 km) dans le quartier Saint-Louis, le long de la rivière des Outaouais et dans le Parc Leamy. Une véritable célébration des beautés naturelles de notre région, qu’il faut entretenir, pérenniser au maximum. D’ailleurs, une partie des revenus de l’évènement allait à « Garde-rivière des Outaouais » (Ottawa Riverkeeper), un organisme dont la mission est la protection et l’éducation autour et du bassin versant de ce cours d’eau. Si personne ne remet en question l’importance et l’avantage que constitue l’Outaouais, combien réfléchissent vraiment à ce qu’il faut être prêt à y investir en temps et en argent ?
Enfin, et non des moindres, le Cinéma 9 diffusait le documentaire « La très (grande) évasion » de Yannick Ergoat. Le film de 2022, bien que franco-français à première vue, n’a pas pris une ride et a même gagné en pertinence. Le titre un peu cabochard, en faisant une variation sur le titre du film célèbre de John Sturges, ne doit pas cacher le sérieux — journalistique — de la démarche… et la pertinence des propos. Il nous annonce que le capitalisme est devenu incontrôlable, au point que l’évasion fiscale est aujourd’hui systématique et détourne l’équivalent du budget du Canada chaque année… avec l’accord tacite de nos gouvernements. Ce n’est pas un complot, c’est le fonctionnement de notre environnement économique et financier.
En tant que citoyens lambda, ne voulons-nous pas pourtant plus de justice sociale (le corollaire de la justice climatique)? Mais celle-ci a un coût financier. Or, depuis des décennies, notre pouvoir d’achat décline, les taxes aux entreprises baissent, les services publics (éducation, santé, transport, environnement, transports) se dégradent irrémédiablement, parce qu’on nous serine que l’on vit à crédit, que les caisses sont vides… Ne pourrait-on pas envisager sérieusement, courageusement, d’aller chercher l’argent là où il se trouve : dans les paradis fiscaux. Le seul et unique problème est de savoir ce que cela prendra pour que l’un de nos premiers ministres aille jusqu’au bout de la démarche.
Les oiseaux se cachent pour mourir
Didier Périès
Les deux ouragans majeurs qui ont frappé la Floride ces deux dernières semaines amènent plusieurs résidents à se poser des questions. Mais, non, pas sur les causes de ces événements de plus en fréquents et intenses, qui pourraient provenir de… voyons voir… des océans par exemple, dont le réchauffement produit tant d’humidité atmosphérique que la moindre tempête peut se transformer en ouragan dévastateur en 24 h.
Si les Floridiens ne se posent pas de questions sur l’origine des pluies diluviennes, des canicules accablantes et des sécheresses implacables, et sur leur lot de morts, d’extinction d’espèces animales et végétales, sur la diminution des récoltes ou de l’assèchement des cours d’eau, ils ne s’interrogent pas davantage sur l’impact de leurs gestes sur le climat !
Leur mode de vie — qui ressemble d’ailleurs beaucoup au nôtre ? La pollution de leur grosse maison climatisée 10 mois sur 12, de leur camion ou pick-up de ville, de leur hors-bord, de leur quad et autres engins à moteur ? L’ineptie de leurs villes étendues indéfiniment, bétonnées et parcourues d’autoroutes qui permettent de se rendre n’importe où… mais seulement en automobile ? La surconsommation, les soldes à longueur d’année, la « fast fashion » et l’obsolescence programmée ?
Peut-être devraient-ils, en bons croyants et climatonégationnistes, se demander ce qui dans leur comportement mérite une telle punition ; ou bien encore comment ils pourraient, en corrigeant leur approche, leur perspective, changer les choses à l’avenir. Parce que juste admettre qu’il faut s’adapter à la crise climatique serait déjà un premier petit pas pour eux, mais un pas de géant pour le reste de l’Humanité souffrante. Ils sont, nous sommes, les plus gros pollueurs par habitant du monde !
Même les experts des affaires et du marketing le disent. Je vous invite à lire le court essai dialogué que Jacques Nantel, professeur à HEC Montréal, a coécrit : C’en est fait de notre consommation ! Cet homme, qui se dit volontiers de droite, admet tout simplement que nous avons atteint la limite de ce que nous pouvons produire (donc extraire) de la planète, sans répercussions irréversibles sur nos conditions de vie.
Alors, je comprends que l’on fasse nos Une sur ces millions de gens qui se retrouvent les pieds dans l’eau, sans électricité : nous sommes proches d’eux géographiquement et une bonne partie d’entre nous habitent « dans le sud » la moitié de l’année. Parmi eux, peut-être nos swowbirds ont-ils mérité cette retraite dorée, après une vie de labeur… Peut-être, mais si c’est synonyme pour eux d’oublier leur responsabilité dans la situation actuelle, nier la crise climatique et continuer de vivre comme des Nord-américains typiques du dernier siècle, alors j’ai plus de difficulté à compatir. Aujourd’hui tous ces gens se posent une seule question, ô combien essentielle : devrais-je renoncer à mon paradis ensoleillé à l’avenir, et trouver un autre lieu de villégiature pour fuir le rigoureux hiver canadien ? Ils « devraient attendre » avant de se rendre en Floride, selon leur association, parce qu’il faut « laisser le temps aux gens de faire leur travail ». Euphémisme pour signifier que l’on attend que les locaux se débrouillent pour tout rendre pimpant et praticable avant de venir en profiter. Un bel exemple de solidarité, alors qu’il s’agit de leur seconde maison et de leur communauté d’adoption ! Cet égoïsme en dit malheureusement beaucoup sur notre mentalité actuelle.
Nos traces finissent par s’effacer
Didier Périès
Je suis pas mal remué. Je voulais écrire — hasard des lectures — sur les croyantes, oui, sur les femmes et Dieu, pour faire court. Mais j’y reviendrais dans mon prochain éditorial, car ma grand-mère est morte. En fait, ne me restait qu’elle, puisque mon autre grand-mère et mes deux grands-pères sont déjà disparus. Notez que les euphémismes (comme « disparaitre ») que l’on utilise habituellement pour atténuer l’impact de cette situation plutôt grave (si, si, quand même) en disent beaucoup sur notre déni: un jour, pourtant, notre corps va être effacé ; nos proches, nos amis, nos enfants et petits-enfants, tous les gens que l’on a croisés, plus ou moins longtemps, au fil des années, que nous les ayons influencés ou qu’ils nous aient marqués, ils ne nous verront plus, pire, ils nous oublieront peu à peu. Pensée insupportable.
Certains répondraient qu’au lieu de m’apitoyer sur ma condition de mortel, je devrais plutôt 1) penser à mon père, son fils, qui désormais n’a plus de parents vivants 2) apprécier d’avoir connu et pu profiter de ma grand-mère tant d’années ; moi ayant 53 ans, elle étant morte à 95 ans ! Il est vrai que le confort affectif, le sentiment d’appartenance familiale et même le témoignage d’une personne ayant traversé le XXe siècle, tout cela en partage a nourri l’adulte que je suis. Même si au fond, je connaissais peu ma grand-mère : mes yeux d’enfants me l’ont forcément montré plus grande que nature et pleine de bontés envers moi ; plus tard, le jeune adulte a appris et compris maints comportements et non-dits pour se faire sa propre opinion sur la personne. Cependant, si ce sont ses qualités humaines que je retiens finalement, c’est tout ce qu’elle a vécu avant que je naisse qui constituent pour moi un mystère. C’est ce que j’aimerais savoir et que je ne peux qu’imaginer.
Noyé dans le travail et la routine accaparante, je n’ai pensé à elle que sporadiquement la semaine dernière. Bien sûr, j’ai téléphoné à mes parents chaque deux jours afin de partager un peu le poids de la peine et accomplir ce moment du souvenir incontournable, quand décède un proche, mais j’avoue avoir peut-être un peu évité d’y penser. Toutefois, son fantôme était là, quelque part au-dessus de moi, je sentais son ombre tutélaire. La messe, l’enterrement, la crémation, l’inhumation, autant de dernières étapes où je ne fus pas ; je n’ai pas pris l’avion pour franchir les 7000 km me séparant de mon Occitanie natale. Notre dernière rencontre datait du mois d’août dernier… Par extension, j’ai repensé à mes autres grands-parents, et même à mes arrière-grands-parents (toujours du côté de mon père), que j’ai eu la chance de fréquenter jusqu’à mes 20 ans ! En vérité, je pense à eux assez souvent. J’essaie de ne pas les oublier, parce qu’il ne reste que cela de leur existence, des souvenirs et mon affection.
Surtout, depuis, j’ai visionné le film Adieu Berthe, un film français de Denis Podalydes, œuvre originale, fantaisiste et difficile à classer, qui raconte l’histoire d’un homme d’âge mûr découvrant réellement la vie de sa grand-mère, après sa mort, alors qu’il doit s’occuper de ses funérailles. Il est entrainé dans une série d’événements quelque peu insolites qui l’entraînent en fait à explorer son identité et à se découvrir lui-même. Fruit du hasard ?
Mesdames, pouvez-vous vraiment parler ?
Didier Périès
Les religions sont d’actualité ces derniers temps, avez-vous remarqué ? Et pas de la meilleure des manières. Certes, c’est un sujet sensible dans un Québec captif d’une société canadienne, où, excepté pour en défendre la pratique au nom de la liberté d’expression, elles sont louées, au point que l’on dirait que les athées n’existent plus. Tout le monde, au sein du beau multiculturalisme canadien, devrait croire en Dieu…
En tout cas, autant le Canada que le Québec prônent l’égalité homme/femme ; c’est pourquoi j’ai coché la case « oui », en remplissant le questionnaire qui me demandait si j’adhérais au principe de l’égalité entre les sexes, avant d’obtenir la citoyenneté canadienne. Et c’est aussi l’une des raisons majeures à la décision, en 1997, de faire payer 5 $ par jour aux parents qui mettraient leur enfant de 4 ans à la garderie : cela libérait des dizaines de milliers de femmes de leurs tâches domestiques et leur permettait d’entrer sur le marché du travail et de gagner leur indépendance financière.
Toutefois, il faut l’admettre, quoi qu’en dise les « modérés », qu’ils soient de confession juive, chrétienne ou musulmane, l’un des grands points communs entre ces trois religions monothéistes et cousines (si, si) réside dans leur caractère patriarcal, voir misogyne. Évidemment, leurs radicaux vont plus loin encore dans la stricte, et souvent littérale, lecture des textes, qu’il s’agisse des juifs hassidiques, des évangélistes ou des islamistes, mais les textes sr lesquelles elles reposent parlent d’eux-mêmes. Le problème est qu’elles sont toutes des religions révélées : Dieu a parlé aux hommes, en fait à un seul homme (Moïse, Jésus, Mohammed), qui a rapporté ses paroles à l’écrit dans un livre. Les livres sacrés sont la parole de dieu, rien de moins. Comment dès lors en déroger, sinon en en interprétant le sens, quand ce n’est pas clair ?
Cependant, je ne veux pas ici revenir sur les extraits de la Bible ou du Coran qui montrent tout le mal que les femmes incarnent, mais simplement m’intéresser à leur place aujourd’hui dans le débat public. Et parmi ces milliers de croyantes, les musulmanes sont les plus visibles, parce qu’elles arborent des vêtements caractéristiques, qu’ils soient traditionnels ou purement religieux, malheureusement pour elles ; ce qui entraine leur stigmatisation. Il n’empêche : on les entend peu pour défendre l’égalité hommes/femmes. Dans le débat social, elles semblent n’apparaitre que lorsqu’il s’agit de manifester contre l’éducation à l’identité de genre, contre la laïcité, ou dans les écoles, pour demander des exemptions au cours à la sexualité… Bref, rarement dans des causes progressistes. Qu’est-ce à dire ?
Pourtant, plusieurs d’entre elles s'estiment féministes. La vérité est qu’on ne les entend pas, en grande partie parce qu’elles sont « subalternisées », c’est-à-dire que, même si elles parlent, agissent ou participent, leurs paroles, leurs actes sont relégués au second plan. Pire, elles sont sans cesse victimisées, et le groupe majoritaire, duquel je fais partie, se considère alors comme le garant de leur émancipation. Et si elles revendiquent en tant que musulmanes, juives ou chrétiennes, on les ignore ou on les voit comme une menace. C’est particulièrement le cas des musulmanes, dans un contexte où l’Islam s’est politisé depuis les 40 dernières années… Elles doivent être sauvées et, en même temps sont les symptômes du danger. Comment sortir de cette dialectique fallacieuse ?
Notre COP16 à nous
Didier Périès
Une COP est une conférence des parties ou « Conference of the Parties », sous l’égide de l’ONU. Depuis 1995, à Berlin, il s’en tient une grande chaque année — d’où le numéro qui l’accompagne — pour permettre surtout aux 196 états de faire le point, de discuter de la crise climatique et, en théorie, de s’accorder sur des objectifs et mesures à prendre. On se souviendra de la COP21 à Paris, avec la signature de l’objectif mondial de ne pas dépasser 1,5 degré Celsius de réchauffement de la planète ou de la COP26, reportée d’un an à cause de la pandémie. Les COP ont été conçues comme des événements décisionnels qui font suite à une consultation par tous des « communications nationales et des inventaires des émissions de GES » (ONU). La présidence est tournante, afin que tous les continents ou grandes régions du monde puissent montrer leur leadership en la matière. Ayant lieu fin novembre habituellement, elle a tendance ces dernières années année à réunir plus de lobbyistes climatosceptiques (ou négationnistes) que de groupes et organismes environnementaux. La COP29 se déroulera à Bakou, en Azerbaïdjan, dans 8 jours.
Parallèlement, il y a des mini-COP thématiques, comme celle qui s’est tenue à Cali, en Colombie, toute la semaine dernière, à propos de la biodiversité. Elle s’est doublée le 28 octobre, d’une journée à ce sujet à Montréal, « Finance et biodiversité », coorganisée par Finance Montréal et le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. Elle était la seizième du genre, d’où son titre : COP16. On nous avait avertis : « C’est une négociation très complexe, avec de nombreux intérêts ». Son ambition ? Dans la foulée du cadre mondial sur la biodiversité, signé à Montréal (déjà) en 2022, un accord signé (mais non contraignant) sur le financement par les états et le contrôle des efforts (toujours par les gouvernements) que l’humanité s’est engagée à accomplir pour arrêter de détruire les terres, les mers et les océans. Rien de moins. Et de fait, pour ne pas changer, elle n’a abouti à aucune entente. Quelques avancées pour la reconnaissance des afrodescendants et des peuples autochtones ou la mise sur pied d’un fonds multilatéral, mais rien sur les 200 milliards de dollars par an de dépenses mondiales pour sauver la nature. Personne ne veut payer, surtout pas les pays riches comme le Canada.
Et nous, en Outaouais, sur une initiative éclairée et pionnière du CREDDO, nous avons eu également notre mini-mini-COP16, qui réunissait à Chelsea le gratin des parties impliquées dans l’environnement dans notre région, afin de parler biodiversité, en particulier dans le parc de la Gatineau. Concept clef et ô combien méconnu : la connectivité du territoire, connue sous le nom de « corridor écologique ». Il s’agit de permettre aux animaux de tout simplement se déplacer d’une zone à une autre de leur habitat naturel… au lieu d’y construire une route en plein milieu ou de déboiser pour édifier des constructions. Et autant je fustige volontiers le gouvernement libéral de Trudeau pour ses hésitations, autant il faut louer la députée de Pontiac, Sophie Châtel, pour ses efforts à conférer au parc de la Gatineau un statut légal qui fige ses limites géographiques. La question demeure toutefois: comment embarquer le secteur privé, entreprises et constructeurs, dans le train fou des dérèglements climatiques afin d’en ralentir la course ?
La « der des der » ?
Didier Périès
Je ne sais pas ce qui doit me déprimer le plus : le fait qu’à l’occasion du 11 novembre, on se souvienne de nos morts, « sacrifiés pour la liberté et la démocratie », tout en entonnant un « Ô Canada » ou une « Marseillaise » aux accents bellicistes et au vocabulaire guerrier, au nom d’un nationalisme (la patrie ? Le pays natal ?) qui a conduit à toutes les dernières grandes guerres ? Et qui encore aujourd’hui, en 2024, jette des voisins les uns sur les autres comme autant de bêtes féroces ? Ou bien la réélection de Donald Trump, symptôme du recroquevillement croissant des pays du Nord global sur eux-mêmes, dans des nationalismes réactionnaires et xénophobes, qui laissent de côté les vrais enjeux existentiels pour l’humanité et la vie sur Terre telle que nous l’avons connue jusqu’à présent ?
Grosses et grandes questions, me direz-vous ; grands enjeux qui font peur et nous dépassent, songent beaucoup d’entre nous, qui préfèrent rester dans le déni, détourner le regard et parler économie. Je reviendrai sur Trump : après tout, les discussions à son propos sont hypothétiques : il n’entre en fonction qu’en janvier… à moins qu’il ne soit pressé de franchir le seuil de la maison blanche et du bureau ovale avant. L’actualité, c’est la guerre, ou plutôt, devrais-je dire, les guerres.
Les guerres dans le sens traditionnel de « luttes armées entre deux états, considérées comme des phénomènes historiques » (le Robert). Ces conflits, loin de réduire en nombre, ainsi que l'on pourrait s’y attendre au XXIe siècle, augmentent. Certes, dans un monde multipolaire sans véritable grand jeu d’alliance — à part l’OTAN — elles ressemblent davantage à de lointains conflits régionaux, qu’à des guerres mondiales, comme celles du XXe siècle ; d’où notre difficulté à nous sentir concernés. Cependant, elles nous déstabilisent en réalité dans notre vie quotidienne, parce que nos économies sont interdépendantes et le monde plus global que jamais : énergie, production de biens et de services, approvisionnement alimentaire, etc. Le moindre risque sur le transport maritime dans le canal de Suez ou la moindre explosion d’une raffinerie au Moyen-Orient peuvent déclencher une hausse des prix à la consommation que tous ressentiront durement aux quatre coins du globe ! La question reste toujours dans ces cas-là : à qui profite le crime ? Certainement pas aux populations civiles des pays concernés ou à nous, simples citoyens anonymes…
Et puis, il y a également les guerres que l’on qualifie de culturelles. Après plusieurs décennies d’amélioration des droits des femmes et une certaine reconnaissance vis-à-vis des homosexuels et des personnes non binaires, nous vivons depuis quelques années à la fois une radicalisation de la lutte au nom des droits des minorités en tous genres, parfois au détriment des droits collectifs, et parallèlement un backlash, un retour de bâton très préoccupant. L’hétérosexualité comme norme « naturelle » et le « masculinisme » comme posture au sein de ce même couple binaire se répandent encore dans nos sociétés. La fermeture d’esprit que constituent ces systèmes de pensée, rétrogrades et conservateurs pour ceux-ci, niant la science et les faits pour ceux-là, constitue selon moi un profond recul moral et conduisent à de la violence physique. Alors que les êtres humains vivent de plus en plus sous la houlette de pouvoirs autoritaires (75 % de la population mondiale!), ils sont une forme de guerre à la démocratie.
L’écoblanchiment ou comment détourner nos économies
Didier Périès
Parlons un peu finances, parce que, si nous avons l’impression d’en avoir moins dans les poches aujourd’hui qu’hier, on nous dit également qu’il n’y a pas assez d’argent quand vient le temps de payer pour des transports publics, une meilleure éducation pour nos enfants ou simplement pour accéder à un médecin. Quant à prévenir l’aggravation de la crise climatique, n’en parlons pas !
Dernièrement, la capitalisation sur les places boursières de nos pays n’a jamais été aussi haute, ce qui signifie : des montants astronomiques échangés (et non taxés), et des bénéfices incroyables pour les détenteurs d’actions (très peu taxés en comparaison avec les impôts sur le revenu du travail). Dois-je aborder la question des salaires des « stars », du sport à la musique, en passant par la technologie ou celle des paradis fiscaux ? Dans une époque où les états, les pouvoirs publics, peinent à équilibrer leurs comptes, l’argent ne manque pas. Y compris et surtout dans les états pétroliers, comme ceux de la péninsule arabique… ou en Azerbaïdjan, où se déroule la COP 29.
Là, cette fois encore, la montagne accouche d’une souris, même si on y a parlé finances, parce que les pays du Sud réclament à cor et à cri un dédommagement pour les dégâts historiques – et actuels - infligés par les pays du Nord global. En effet, ils subissent plus que jamais notre mode de développement extractiviste, et leurs plus gros impacts environnementaux : submersion des îles dans le Pacifique ; pluies et inondations diluviennes en Asie forçant des déplacements de population massifs ; désertification du continent africain et de plusieurs régions en Amérique du Sud. Grosso modo, la moitié des GES dans le monde provient de l’exploitation et de notre prodcution/consommation des énergies fossiles.
Il faut donc réduire notre utilisation des hydrocarbures pour infléchir la croissance exponentielle du réchauffement climatique. Et la « bourse du carbone », soit payer pour pouvoir polluer, n’est qu’une fausse solution, dont l’effet dissuasif n’est pas prouvé. Les projections réalistes aujourd’hui sont au-delà de 3 degrés. Le Canada lui-même, troisième plus grand pollueur par habitant au monde, en est seulement à 7 % de ses objectifs de réduction de GES pour 2030.
Alors, que les COP se déroulent maintenant dans des états non seulement producteurs de pétrole, mais qui s’en vantent, défie l’entendement. Cela explique que nous nous y intéressons de moins en moins. Allô ! Personne ne vous écoute plus, votre déclaration finale est couverte par le fracas des armes des différents conflits armés dans le monde, et par le smog des incendies et de la pollution ! Seuls quelques ministres et beaucoup de lobbyistes propétroles (grassement payés par des subventions financées à même nos impôts pour la « transition énergétique ») se sont rendus Azerbaïdjan. Quelle blague ! On nomme cela l’écoblanchiment.
La solution n’est pas dans le « gros bon sens », mais plutôt dans les données scientifiques et des solutions inévitables et soutenables. Comme une véritable reddition de compte par les entreprises sur leurs données environnementales, comme une véritable taxation verte « pollueur-payeur », comme un véritable encadrement règlementaire des « fonds ESG » (ou climatiques), censés ne contenir que des compagnies socialement et écologiquement responsables, mais parmi lesquels seuls 5 % le sont. Après vos impôts, regardez un peu où va votre argent déposé à la banque, vous pourriez être surpris.
Le monde à l’envers
Didier Périès
Je vous parle d’un monde où, en novembre, il neige en France et pleut au Québec.
Je vous parle d’un monde où certains leaders politiques (Marjorie Taylor-Greene, pour ne pas la nommer) n’hésitent pas à avancer que le gouvernement de leur pays (aux mains du parti adverse, évidemment) a le pouvoir de jouer avec le climat, créer des ouragans comme Hélène, par exemple. Devinez quoi ? Elle a été élue quand même !
Je vous parle d’un monde où le parti que vous allez élire (si, si…) affiche fièrement sur son site web : « Nous ne MANGERONS PAS d’insectes », parce que son chef, qui se vante d’avoir du « gros bon sens », croit que le gouvernement libéral de Trudeau suit un agenda woke mondial pour nous faire abandonner la viande au profit des insectes ! Venant d’un gars qui nous fait avaler des couleuvres chaque fois qu’il ouvre la bouche, c’est savoureux, non ?
Je vous parle d’un monde où ce même parti libéral du Canada nous affirme vouloir réduire la pollution en donnant de l’argent aux pollueurs à coup de milliards de dollars !!! Du coup, quelques milliards de nos impôts vont chaque année dans les poches des compagnies pétrolières et gazières ; on les accueille sous le pavillon du Canada dans les COP aux frais de la princesse (du roi, plutôt) ; on achète un pipeline (Transmountain) 4,5 milliards de dollars, avec 7 milliards de dépenses prévues pour le développer… qui se montent aujourd’hui à 30 milliards ! Et que le gouvernement Trudeau prévoit de revendre la moitié de son prix… Cherchez l’erreur !
Je vous parle d’un monde où, au palier provincial, ce n’est pas mieux : prenez une poule sans tête, pendez-la par les pattes et vous avez le gouvernement de la CAQ. Dans le domaine de la santé, qui est non seulement un service essentiel, mais qui ne devrait littéralement pas avoir de prix, le budget accuse un déficit de 1,5 milliard. Et alors ? Bon papa Legault se veut rassurant : on va maintenir la « qualité des services » tout en réduisant tous les budgets (fonctionnement, administration, etc.), en comprimant/coupant dans le personnel soignant ou dans les gardes de nuit ?
Mais dans ce monde-là, où nous nous retrouvons pas mal cul par-dessus tête, avouons-le, si l’on veut s’engager, intervenir pour changer les choses, en s’opposant pacifiquement, mais par l’action, à des mesures assassines, là, on se retrouve devant un juge ! En ce moment a lieu le procès du collectif Antigone (rapport à l’héroïne tragique grecque), parce que certains de leurs membres ont osé bloquer le fonctionnement du pipeline 9B d’Enbridge il y a deux ans… Le sable bitumineux que transporte cet oléoduc est le plus cher et le plus polluant de tous les types de pétrole au monde ! Et avec la bénédiction des gouvernements actuels, on prévoit d’accroître son extraction… pour une raison tellement pertinente : il faut répondre à la « demande » !
Même une action « perturbatrice » aussi inoffensive que s’enchainer à une fausse pompe à essence sur la voie publique peut mener à une arrestation ! Voyons donc ! Ah, oui, j’avais oublié : la scène s’est déroulée devant le domicile du fameux dirigeant sur le point de devenir premier ministre du Canada, un « progressiste » surtout conservateur pur beurre qui va nous aider à mettre notre monde un peu plus à l’envers.
Un fasciste?
Didier Périès
Historiquement , le terme « fasci » (en français traduit par « faisceau ») est utilisé par Benito Mussolini, en 1919, à Milan, pour son mouvement national-socialiste. Ce faisceau de flèches ou de baguettes symbolise en effet l’unité, parfois avec une hache au milieu pour la vie/la mort. Dans la Rome antique, il était porté par les licteurs, des officiers accompagnant les tribuns militaires dans leurs sorties. Mussolini, qui rêvait de recréer un nouvel empire romain, le choisit sciemment. Cependant, s’il avait été déjà employé sporadiquement en Italie à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, c’est en fait Staline qui va le répandre, sous sa forme adjectivale (fasciste), afin de désigner les adversaires du mouvement communiste international, à partir de 1936.
Après la Seconde Guerre mondiale, et surtout à partir des années 1960, le terme qualifie les mouvements d’extrême droite, antidémocratiques (voire révolutionnaires) et nationalistes, parfois simplement la droite réactionnaire, qui préfère se tourner et croire dans le passé pour faire face au défi de l’avenir. Si, dans le cas des États-Unis, vous y ajoutez, la division américaine traditionnelle démocrate/républicain (renforcement du pouvoir central vs autonomie des États et libertés individuelles, qui a changé quelque peu — une certaine gauche est arc-boutée aujourd’hui sur les droits des minorités et des individus —), une chose semble assez claire. Si une partie de son électorat l’est, Donald Trump n’est pas un fasciste.
Qu’est-il véritablement ? Pour répondre, il faut connaitre le creuset familial et social dans lequel le jeune Donald a grandi. Donald est resté le quatrième enfant d’une famille multimillionnaire, celle de Fred et Mary Trump, loin derrière les trois premiers, qui a su très vite se placer dans les bonnes grâces d’un père tyrannique et ne plus jamais revivre le sentiment d’abandon qui le traumatisa lors de la longue absence de sa mère pour cause de dépression post-partum. Il s’est détaché totalement de ses émotions — à part la colère, la jalousie et le sentiment de puissance —, est devenu un intimidateur incapable de reconnaitre ses torts, sans cesse défiant l’autorité pour son bon plaisir et ne respectant que plus fort que soi. Cette stratégie d’adaptation, qui ne visait que sa propre survie initialement, s’est transformée en pathologie, selon les dires de sa nièce Mary L. Trump : Donald est un enfant de 8 ans dans le corps d’un adulte de 78 ans ; un sociopathe doublé d’un narcissique qui a pour la deuxième fois les pleins pouvoirs sur les États-Unis. On a mis à la tête de l’un des plus puissants pays au monde un « garçon apeuré qui joue au géant pour écraser ce qui l’effraie : l’altérité, le féminin, le vulnérable et le différent. » (Nathalie Plaat, Le Devoir).
Pour Pierre Milza, grand spécialiste de l’Italie, Trump représente plus un nouvel autoritarisme qu’un totalitarisme fasciste, « nationaliste, révolutionnaire, antilibéral, antimarxiste, organisé en parti-milice » ; a contrario, Roger Griffin, dans The Nature of Fascism, distingue 3 composantes : le mythe de la renaissance, l’ultranationalisme populiste et le mythe de la décadence. En est-on si loin ? Ce qui est certain, c’est qu’au vu des nominations faites par le nouveau président élu, au vu de son empressement (rappelez-vous, le petit garçon de 8 ans), du degré de préparation et de son équipe et de leur agenda extrêmement clair, la présidence qui s’en vient défie notre imagination !
Cinq conseils pour avoir une business millionnaire
Didier Périès
J’ai laissé retomber la poussière. Cependant, je dois l’avouer, je n’ai pas profité du « Vendredi fou » ou du « Cyberlundi ». En fait, je fais peu de cas en général des périodes de soldes et autres grandes célébrations de notre société surconsommatrice. D’ailleurs, nous arrivons à la fin de l’année et je me rends compte que, sans trop me forcer, j’ai respecté ma résolution, prise en janvier passée, de ne pas acheter de vêtements neufs ; et je n’ai même acquis aucun nouveau vêtement ! Alors, la « fast fashion », qui nous fait croire qu’acheter chaque mois de nouvelles tenues pour rester dans la tendance, elle me passe à des kilomètres au-dessus !
Mais, quitte à aborder la question de la consommation et du chiffre d’affaires, donc du business, revenons à ce sujet crucial qui emballe tant nos jeunes : comment monter sa propre entreprise et faire rapidement des millions ? Et bien je vous propose un résumé de la réponse magique et définitive. Mais j’avoue qu’elle ne vient pas de moi, même si un certain candidat conservateur ajouterait probablement que c’était pourtant le gros bon sens. Pourquoi ne se l’applique-t-il pas alors à lui-même ?
Je remercie donc Nic Stacey pour son documentaire Buy now — The shopping conspiracy et sa très créative manière d’aborder la question de notre mode de vie basé sur la consommation ; un documentaire qui se présente comme un long-métrage visant à guider les entreprises à atteindre la réussite, c’est-à-dire à maximiser leurs profits. Il est mon nouveau gourou et sa formule sera mon mantra pour les années à venir : « Vendez plus, gaspillez plus, dissimulez plus, mentez plus, contrôlez plus ». Comme vous le voyez, on est pas mal dans le « plus », donc dans l’exagération, un peu comme notre mode de vie qui fait de notre monde une poubelle : 92 millions de tonnes de déchets textiles par an, 400 millions de déchets plastiques, 62 millions de déchets électroniques.
Reprenons par le menu la recette en question. D’abord, vendre plus, ce qui signifie produire davantage, il faut rendre votre produit indispensable ; puis gaspiller (les invendus), donc jeter ce qui est devenu obsolète, plutôt que vendre au rabais ; ensuite, mentir (aux consommateurs) sans vergogne, « la fin justifie les moyens » ; mais également cacher (les déchets) quitte à se faire passer pour plus écolo que les écolos ; et enfin, contrôler, les employés — que les lois de la province ou du pays ainsi que les règles internes de la compagnie sont bien faites ! — et le message, car la communication est le nerf de la guerre.
Toutefois, si l’on pouvait en conclure que nous sommes manipulés de début à la fin, nuançons : cela ne se fait pas tout à fait contre notre volonté, nous avons notre responsabilité, en tant que consommateur qui effectuons des choix et en tant que « producteurs », à partir du moment où nous travaillons souvent dans des entreprises qui appliquent ces stratégies. Vous rétorquerez que nous sommes que les simples rouages d’une énorme machine, et des rouages remplaçables, parfois, mais il suffit d’un petit caillou, d’un grain de sable, pour gripper une belle mécanique, non ? Ne vous sous-estimez, réfléchissez à la nécessité absolue (ou pas), que vous ayez, d’acheter tel ou tel article (ou pas. Il ne s’agit pas d’arrêter de consommer, mais de savoir quand s’arrêter.
Un négociateur?
Didier Périès
Trump n’est encore que le « président désigné », il n’est pas en fonction avant fin janvier 2025, mais nos responsables politiques semblent l’oublier. Biden semble déjà être passé aux oubliettes de l’Histoire et peine à se faire entendre.
Aujourd’hui, nos dirigeants s’excuseraient presque de ne pas l’avoir invité avant… Certains, comme Trudeau, ont même devancé l’appel en se rendant à Mar-a-Lago, le fief du bonhomme, une stratégie pour amadouer le futur 47e président des États-Unis, qui adore être flatté… et ne respecte également que les personnes plus fortes, plus intimidatrices que lui. L’approcher, peut-être ; gagner son respect, bonne chance ! Parlez-en à notre « gouverneur ».
C’est surtout parce qu’il a annoncé la couleur rapidement après l’élection sur les mesures qu’il comptait prendre, avec son assurance et sa hargne habituelles. Et surtout après l’annonce d’une hausse de 25 % des tarifs douaniers sur les importations depuis le Canada. Là, c’est carrément un vent de panique qui a soufflé sur nos élites économiques. Quel sang-froid !
Et quel manque de jugement et de connaissance sur cette tactique qui est la base même de la négociation (je ne parlerais pas de stratégie chez un Trump soumis à son impulsivité et à ses passions). La ficelle est archiusée : tu annonces 25 pour que ton interlocuteur lâche à 15, voire peut-être seulement à 10 ; et il te remerciera en plus de ta générosité !
De surcroît, avec de pareilles annonces, tu fais le buzz, tout le monde te regarde. C’est la zizanie dans le camp adverse. Observez le tapage médiatique, politique et économique auquel nous avons eu droit depuis : ça gesticule, ça discutaille sans fin sur les contre-mesures à adopter… Bref, ça nous occupe d’un côté, pendant qu’il se passe des choses de l’autre. Encore des tactiques simples et aussi vieilles que Sun Tzu : la diversion et ne jamais être là où on nous attend.
Quant à l’affirmation du futur plus vieux président américain en exercice, qu’il réglera la guerre en Ukraine en 24 h, grâce à son « art » de la négociation, rien n’est plus faux. Les principaux bailleurs de fonds de l’Ukraine sont les États-Unis, en financement autant qu’en armement ; Elon Musk, le zélote numéro 1 de Trump (pour l’instant), prête son réseau de satellites aux Ukrainiens. Sans tout cela, Poutine pourrait gagner la guerre en quelques semaines probablement. Alors, devinez comment Trump va amener Zelenski à la table des négociations…
OK, certains me diront : « Mais il a publié un Art of the deal qui a fait école. » ! [Ndlr : écrit évidemment par un autre que lui, Tony Schwartz] .
Certes, mais à l’épreuve des faits, il ne tient pas la route selon les experts ne montrant ni créativité ni empathie, deux qualités qui caractérisent les vrais négociateurs. Ses résultats parlent d’eux-mêmes d’ailleurs… L’ALENA ? Le remplacement d’Obamacare ? Le mur frontalier avec le Mexique ? La dénucléarisation de la Corée du Nord ? Il est plus facile de tout casser, par exemple en sortant des Accords de Paris, de l’accord avec l’Iran sur le nucléaire, de l’entente transpacifique sur le libre-échange ! Trump n’est pas davantage doué pour la négociation sur le plan personnel : alors qu’il gagnait 50 000 $ pour animer la télé-réalité The Apprentice, il a exigé 1 million l’année suivante… pour finalement accepter 60 000 $. Pas de commentaire.
Édititoriaux de mai
Dune
Didier Périès
Je cherche toujours la cohérence de la politique du gouvernement caquiste à propos du transport électrique : après avoir prolongé la subvention provinciale à l’achat d’un véhicule électrique, Legault la réduit maintenant pour la faire disparaitre d’ici à 2027 ; il coupe également dans les aides à la construction d’autobus électrique et, par la voix de sa ministre des Transports, refuse de financer davantage les transports collectifs locaux. Alors qu’il donne des milliards de nos impôts pour une usine de batterie électrique !
Excusez-moi, je voulais parler de Dune, des dunes, du sable à venir, du sable dans l’engrenage plus ou moins bien huilé de nos existences modernes. Et puis, par association, mes pensées ont dérapé… En tout cas, le film de Denis Villeneuve est extraordinaire à tous les niveaux, on peut le dire, mais pas plus que le roman qui en est à l’origine. Vous me rétorquerez que l’histoire du cinéma est remplie de bonnes histoires écrites qui ont donné de mauvais films. C’est vrai… Mais revenons au récit de Frank Herbert. Ce dernier était déjà un activiste dans les années 1960 dans sa propre ville hyperpolluée de Tacoma ; il adhérait à l’idée de certains peuples autochtones que l’être humain était en train de transformer notre monde en désert… « une immense dune » ! Admettons que les pays africains ne nous contrediraient pas.
Herbert ne cessera de placer dans les intrigues de ses romans ultérieurs la cause écologique, au point même d’influencer l’animé écologique majeur de Hayao Miyazaki, Nausicaä de la vallée du vent (1984). L’idée principale, au fond, est simplement que nous ne sommes en aucun cas maitres de la nature, mais plutôt ses débiteurs. Mais devinez de qui l’auguste pionnier américain de science-fiction s’est inspiré. Je fais cette parenthèse, parce que nous, francophones, avons de quoi à en être fier… Jules Verne et son intérêt pour la biodiversité. Certes, il ne se disait pas « écologiste » (bien que le terme existât en 1870), mais il dénonce dans des romans comme 20 000 lieues sous les mers les actions néfastes de l’humain sur la nature.
Dans la série originale de six romans, les habitants de la planète Dune, les Fremen, sont un peuple pacifique (quoiqu’entrainé au combat) qui n’a jamais tenté de reprendre sa planète ni aux Harkonnens ni aux Atréides, ces familles nobles à qui l’empereur confie pourtant l’exploitation éhontée de l’épice, une ressource unique qui permet les voyages interstellaires. Même lorsqu’ils entreront en guerre sous l’influence de Paul, devenu le prophète Mua’dib, ce sera pour rendre à nouveau fertile leur planète ! En attendant, les Fremen se sont adaptés à un environnement où il ne pleut jamais, ils n’ont pas essayé de provoquer la pluie ! Ils ont créé des pièges à vent, recyclent même l’eau des corps de leurs morts et sont surtout actifs la nuit. Ils vivent en harmonie avec les multiples animaux de cet écosystème singulier, y compris avec les vers géants qui produisent l’épice, au point d’avoir changé leur manière de marcher sur le sable…
Pour Herbert, les humains seraient des « surfeurs sur une mer infinie ». Nous n’avons pas d’« épice » pour nous rendre voyants, comme dans Dune, mais nous aussi pouvons être des faiseurs, des « poètes » (faire en grec est « poien », d’où vient poésie). La condition ? Reconsidérer notre rapport à notre environnement et les conséquences de nos actions.
Amour plastique
Didier Périès
« Dans mon esprit tout divague… », ainsi commence la chanson du défunt groupe pop Vidéoclub. Parfois, j’ai la même sensation, quelque peu irréelle, face à l’incapacité de nos gouvernants à s’entendre. Le texte parle d’amour, et quel amour ! Un peu comme l’amour immodéré du Canada (et donc de vous et moi) pour le plastique.
La seule avancée libérale depuis 2015 dans ce domaine si crucial pour l’environnement et notre santé (pensez à toutes ces microbilles qui pénètrent partout, y compris dans notre sang) est le « Règlement interdisant les plastiques à usage unique » de juin 2022. Ce dernier interdit la fabrication, l’importation et la vente de 6 catégories de ces PUU : sacs d’épicerie, ustensiles, récipients alimentaires, anneaux pour emballer les boissons, pailles et bâtonnets à mélanger. Mesure nécessaire certes, mais qui s’accompagne d’une production croissante de pétrole au pays, l’un des constituants principaux du plastique ; de la mise en service de l’oléoduc Transmountain, au coût de plus de 30 milliards de nos impôts et de milliards supplémentaires de subventions, au nom de la « transition écologique », comme si l’extraction, la transformation et l’usage des énergies fossiles pouvaient être propres !
Maintenant, veux-je vraiment vous infliger le blabla politiquement correct qui suit, sur le site du Gouvernement du Canada (« mesures ambitieuses », « approche globale », « économie circulaire »…), en référence à la non moins fameuse et visionnaire Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ? Non, mais la série continue… son dernier épisode ? Le Traité international contre la pollution plastique. Le Canada, 4e producteur de pétrole au monde et leader de l’écologie (selon notre ministre du désenvironnement, en tout cas), en a accueilli les délégués la semaine dernière, pour une nouvelle ronde de négociation avant l’ultime étape, qui se déroulera en Corée du Sud, en novembre prochain.
Apparemment, tout le monde désirait que ce traité soit juridiquement contraignant (comme les précédents ?) et s’attaque à la production… mais sans la réduire ! Ah, mais oui, parce qu’on va recycler ! C’est de l’économie circulaire. Une autre expression magique, comme adaptation climatique, technologies vertes ou captation du carbone : il suffit de les dire et, tout de suite, on est écolo ! En psychologie 101, on appelle ça la méthode Coué ; pour d’autres, c’est de l’hypocrisie climatique. Pour moi, c’est tout simplement — excusez mon langage — du foutage de gueule ! Parce que contrairement aux déclarations jovialistes de Guilbeault, assénées à coup de « j’aimerais », « je souhaiterais », le seul résultat est que ces 175 pays présents ont finalement convenu de maintenir le dialogue, rien de plus.
Au lieu de s’intéresser à la production et à l’utilisation des plastiques, on a décidé de tergiverser : comment mieux évaluer les substances chimiques qui le composent ? comment financer l’application du traité ? Bref, on a surtout décidé de se perdre dans les détails pour éviter de poser les vraies questions, et surtout d’aborder les vraies réponses. On pourra ensuite toujours accuser la Chine, l’Inde ou la Russie pour l’échec de ces palabres. La vérité est que plusieurs autres pays, dont le Canada, se sont abstenus de soutenir les pays qui proposaient de recentrer les débats sur la production. De toute façon, que fait vraiment le Canada, aujourd’hui, pour traiter ses 4 millions de tonnes de déchets (qui augmentent chaque année en plus), alors qu’il a un plan qui prévoit « zéro déchet de plastique d’ici 2030 » ?
“Extrémistes […] pleins de marde”
Didier Périès
Je sais, le titre est vulgaire, le titre choque. Cependant plus que les mots, c’est à quoi (ou à qui plutôt) fait référence la locution qui a choqué le député libéral franco-ontarien Francis Drouin. J’ai précisé « franco-ontarien », parce que son origine sociolinguistique explique probablement en partie sa réaction, comme nous allons le voir.
Revenons un instant aux faits : deux chercheurs universitaires québécois se présentaient la semaine dernière devant le comité permanent des langues officielles du parlement du Canada, dans le cadre de consultations sur le financement des institutions postsecondaires anglophones au Québec et francophones dans le reste du Canada (ROC). Messieurs Bourdon et Lacroix, respectivement professeurs de Cégep et d’université, étaient deux témoins entendus par ce comité, parce qu’ils présentaient les conclusions d’une étude de données de Statistiques Canada. Ils établissaient une corrélation entre la fréquentation d’un établissement postsecondaire en anglais au Québec avec la langue parlée ensuite, notamment dans la vie professionnelle. Rien de nouveau en réalité, parce que le lien de cause à effet existe, on le sait depuis plusieurs années. C’est un fait. Dans quelle proportion, là est plutôt la question, mais il ne s’agit pas non plus d’extrapoler à toute la province, un peu de nuance tout de même !
Pour ce qui est du député Drouin, comme franco-ontarien ayant étudié en anglais après le secondaire, il peut évidemment témoigner qu’il n’est pas devenu un anglophone. Même si, on peut reconnaitre à son instar que l’anglicisation est générale dans le monde, admettons également qu’en dehors de communautés rurales francophones, dans le reste de l’Ontario, comme on dit, c’est en anglais que cela se passe… même entre francophones. Enseignant en Ontario depuis quelques années maintenant, combien de fois ai-je vu deux francophones se parler en anglais, avant de découvrir (ou pas) qu’ils auraient pu tout aussi bien communiquer en français ? Mais ils n’ont pas le réflexe ; c’est ce que l’on nomme en anthropologie l’assimilation, avec son corollaire l’insécurité linguistique.
D’ailleurs, le dernier rapport du Commissaire aux langues officielles confirme l’enracinement profond d’une « francophobie passive » (dixit le journaliste Michel David) : le ROC, que ce soit dans les services publics ou au privé, ne cherche pas à améliorer les choses. Il épingle certaines commissions, telles la très récente Commission Hogue sur les ingérences étrangères, dont tous les documents (sauf un) n’étaient qu’en anglais. Comble de l’ironie, sa présidente est francophone !
Parallèlement, le fait est — et reste, lui, aussi indiscutable — que le poids démographique des francophones baisse d’année en année dans le ROC. Or, le nombre commande la langue de communication, c’est logique. Et le fait que le français soit quasi absent de l’espace public ne donne aucune motivation particulière aux nouveaux arrivants, en particulier aux allophones. Croyez-vous vraiment que la simple perspective d’obtenir un meilleur salaire un jour dans un emploi peut être un moteur suffisant au maintien ou au développement du français comme langue seconde au Canada ? Dès lors, les opinions se radicalisent et peuvent conduire à des décisions qui agrandissent le fossé, surtout entre le ROC et un Québec, dont le gouvernement trouve dans cette cause — peut-être cyniquement — un argument de vente… qui nourrit la colère des Anglo-Québécois, le mépris du reste du Canada et la crainte des minorités francophones d’en subir les représailles. Dommage que la dispute éclate entre francophones !
L’éléphant dans la pièce… en feu
Didier Périès
Si personne ne le dit, j’ose croire que beaucoup le pensent. Mais avant d’aborder mon sujet de la semaine, je dois avouer que je ne m’informe absolument pas sur les médias sociaux, je ne sais pas comment l’information y est retransmise. Je lis des journaux papiers, regarde les nouvelles à la télévision sur différentes chaines… et sur ces dernières, on en parle beaucoup ; jusqu’en France, dans le très respecté journal Le Monde. Les feux dans l’Ouest canadien occupent depuis la semaine dernière à nouveau le devant de la scène.
Avec cette impression de déjà-vu… qui n’est pas une impression. La réalité est qu'elles ne sont pas nouvelles ces images prises d’avion de flammes gigantesques, qui avalent des hectares de forêt dans un nord de l’Alberta, du Manitoba qui ressemble à tous les autres « nord » canadiens. Nous avons déjà assisté au long défilement de véhicules remplis en extrême urgence devant l’avance fulgurante du brasier. Nous avons déjà entendu ces pères ou mères de famille, ces personnes âgées pleurer sur leur vie et leur maison détruites, peut-être à tout jamais perdues, sur leur dénuement et leur désespérance. Ils ne le méritent pourtant pas…
Or, avez-vous remarqué que ces scènes de dévastation géographique et humaine tendent à se répéter chaque année ? Nous, simples spectateurs, feignons alors de compatir, alors que le visionnement d’images en boucle finit par banaliser la nouvelle. Mais ce pourrait être nous, nous le savons en notre for intérieur ! Hiver doux et sécheresse aidant, nos forêts n’attendent qu’un éclair ou une étincelle pour s’embraser. Qui mériterait cela ? Et en même temps, certains ne peuvent pas s’empêcher de songer qu’il y a là quelque ironie, à ce que certaines des provinces les plus touchées pas une « saison des feux » de plus en plus longue et rapprochée soient parfois celles qui plombent nos efforts à réduire les GES, à lutter contre la crise climatique. Voulons-nous entendre cette vérité inconfortable que c’est le prix grandissant que nous allons devoir payer collectivement pour déforester, assécher les rivières et réchauffer l’atmosphère ?
Sans entrer dans la logique d’une justice immanente, où la nature se vengerait de ses agresseurs, épurerait la Terre de ses parasites afin de mieux respirer — littéralement — on ne peut s’empêcher de remarquer l’ironie du sort. Et franchement, cela me rend triste que l’on soit à ce point aveugle que le sujet ne soit même pas abordé sous cet angle-là. Ou bien est-ce notre goût pour les tragédies, le plaisir sadique que nous nourrissons ainsi, en songeant que, finalement, nous sommes plutôt bien lotis dans notre coin de pays ? Un simple « patch » sur une réalité que nous commençons à comprendre, que nous nions de moins en moins, mais pour laquelle nous ne sommes pas encore prêts à sacrifier grand-chose.
L’incendie qui a ravagé Fort McMurray en 2016 a coûté près de 10 milliards de dollars à lui seul. C’était il y a huit ans. Avec l’inflation aujourd’hui, quel va en être l’impact sur notre croissance cette année ? Et la pression démographique qu’exerceront ces déplacements de population récurrents ? Comment la sacrosainte économie, si chère au cœur de nos décideurs, va-t-elle reprendre dans ces régions ? Quels postes budgétaires les différents paliers de gouvernement devront-ils amputer pour redonner aux populations déplacées et sinistrées des conditions de vie acceptables ?
Editoriaux d'avril
Sacro-sainte automobile!
Didier Périès
Cela me démange depuis quelques temps. Je me permets d’y revenir à la lumière de ce qui se passe autour de l’implantation dans notre belle province de Northvolt, l’entreprise suédoise de construction de batteries électriques, et peut-être bientôt du constructeur automobile Honda. Pour le gouvernement caquiste, nous sommes dans la même logique : développer la « filière électrique » et en devenir l’un des leaders mondiaux, en proposant une intégration verticale de cette branche d’activité (extraction des minéraux rares comme le lithium, fabrication de la batterie électrique grâce à l'énergie hydroélectrique et construction de voitures qui utilisent ces batteries). Une synergie qui constitue pour beaucoup de compagnies un certain idéal de croissance… Et une manne financière qui se compte en milliards de dollars de subventions publiques !
Depuis 2000, il y a 50 % plus de véhicules, moteurs à combustion ou électrique confondus ; parallèlement, ils sont de plus en plus gros, tels les VUS, qui, eux, se sont multipliés par trois quasiment (184 % !). Résultat : le transport constitue aujourd’hui 43 % des émissions de GES. C’est un problème évidemment. Cependant, l’industrie automobile a déjà sa réponse et accompagne la tendance : combien de nouveaux modèles ou de conversion de modèles connus en version hybride ou électrique ? Même les Américains et leurs gros « trucks » électriques arrivent sur le marché !
Bref, tout irait « pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles », pour reprendre la formule optimiste de Pangloss. Or, agrandir le parc de véhicules consacre le règne de la voiture solo. Imaginez nos routes, qui coûtent si cher et qui sont en si mauvais état, envahies par encore plus de voitures à toute heure du jour et de la nuit ! Qui y gagnerait réellement ? Pire, nos décideurs n’ont décidément rien compris à la réponse à apporter à la crise climatique : le développement soutenable signifie ne pas épuiser nos ressources naturelles, ne pas polluer davantage nos territoires, ne pas dépenser plus, ne pas accroître notre consommation. Non le contraire. Tous ces véhicules électriques sont beaucoup plus lourds, ils nécessitent plus d’énergie et abîment les routes plus rapidement. Mais, poussés par les constructeurs automobiles, on croit régler la crise climatique tout en continuant de rouler égoïstement… Alors on en veut plus. C’est un cercle vicieux !
La véritable réponse est à la fois simple et difficile : rouler à l’électrique mais surtout investir massivement dans le transport en commun. Simple, parce que l’idée est claire, l’application évidente, en finançant les sociétés de transports partout au Québec et les chantiers pour métro, tramway et autres pistes cyclables. Difficile, parce qu’il s’agit de changer les mentalités, de rendre attractifs ces modes de transports collectifs en termes de prix, de couverture du réseau et de fréquence. Sommes-nous prêts à franchir le pas dans les grands centres urbains ? Il faut en faire le pari.
En plus, aucune source d’énergie n’est vraiment propre, ne serait-ce qu’à cause des matières premières nécessaires et des coûts inhérents à sa captation et à sa transformation. Ainsi les barrages hydroélectriques, desquels la construction requiert la destruction d’écosystèmes entiers et que le gouvernement du Québec voudrait plus nombreux. Toutefois, rien comparé à l’exploitation des énergies fossiles (pétrole et gaz), qui est cent fois plus polluante et destructrice. Alors, tant que l’on voudra dépenser plus pour produire plus pour consommer plus, la situation empirera.
Flânerie le long de la Principale un beau dimanche de printemps
Didier Périès
Dimanche dernier, j’ai déambulé quelques heures sur une rue principale victime de son succès, à l’occasion de « La principale se sucre le bec ». Je ne reviendrais pas sur cet évènement, qui est un des temps forts de la vie aylmeroise, et, tout bien pesé, de la vie gatinoise aussi. La tempête de la semaine dernière, avec ses 15 cm de neige, semblait avoir réveillé notre appétit de soleil et de plein air. Ce fut donc une réussite tant par le volume de visiteurs tout au long des deux jours que par la diversité des kiosques et activités. Bravo à toute l’équipe organisatrice et aux commerçants !
Cependant, mon œil a été attiré par la présence d’une « zone politique », dans laquelle on retrouvait notamment de l’affichage en vue des prochaines élections municipales et même une tente d’Action Gatineau, LE parti municipal (fondé à l’origine par Maxime Pedneault-Jobin) qui a laissé la place à l’indépendante France Bélisle, avec la réussite que l’on connait… et nous voilà avec des élections partielles le 9 juin !
Tout en marchant avec un ami le long de la Principale depuis la Marina, j’ai pu rencontrer plusieurs de mes connaissances qui, à chaque fois, ont apporté de l’eau au moulin de ma réflexion, car depuis les péripatéticiens de l’Antiquité, nous savons que marcher aide à réfléchir. Je vous livre donc une part de ces cogitations sur notre bonne ville de Gatineau, sa politique et la « mairietude »…
D’abord, si être maire est difficile, a fortiori dans une grande ville, du fait des responsabilités et des enjeux à plus grande échelle, des pressions diverses (surtout si l’on est une femme et/ou issue des minorités), on ne peut tout mettre sur les facteurs externes qui contribuent à ces problèmes. Les qualités et les défauts personnels, ainsi que le style de gestion, de management, les compétences interpersonnelles ou l’expérience professionnelle jouent probablement aussi leur rôle. Par exemple, un professionnel qui a travaillé dans le secteur privé toute sa vie pourrait arriver avec sa conception et les pratiques de ce secteur, en pensant que les citoyens sont plus des clients que des usagers… Une municipalité n’est pas « une business », elle ne vise pas le profit ou la meilleure rentabilité, mais d’offrir à ses habitants les meilleures conditions de vie possible à court, moyen et long terme, au meilleur coût possible. Autre exemple : un individu ayant un profil, disons un peu individualiste, qui aime contrôler son (petit) monde et qui a de la difficulté à déléguer, aura plus facilement l’impression d’être débordé et sera vite sur la défensive ; il nourrira la défiance de ses employés et bientôt le climat de travail pourra devenir invivable : les gens hésiteront à prendre des initiatives, resteront dans leur zone de confort et, finalement, renâcleront à suivre les consignes. Le leadership nécessite plusieurs qualités qui n’apparaissent pas toujours lors d’une campagne électorale.
Et puis, quelles seront les priorités lors de la prochaine mandature ? Quelle vision, quels changements positifs majeurs vont proposer nos candidats ? De vraies questions que vous vous posez tous, non ? Non ? Que vous fassiez partie des 70 000 Gatinois (35 %) qui ont exprimé leur voix en 2021 ou non, ne pensez-vous pas que notre « centre-village » a souvent des allures de centre-ville ? Alors, exprimez votre voix !
Tous les grands hommes français sont petits
Didier Périès
Ne croyez pas que je veuille faire mon « Français donneur de leçon », mais l’occasion était trop belle en fin de semaine dernière de commenter la visite du premier ministre français, Gabriel Attal. Non pas pour alimenter la rubrique people à propos de son âge ou de son orientation sexuelle, mais plutôt pour aborder des questions de fond…
D’abord, même si nos cousins français se considèrent davantage comme de grands frères et tendent à penser que nous sommes comme eux, mais habitant sur le continent américain, plutôt que comme des Nord-américains parlant français, au même titre que les minorités francophones hors Québec (incluant les Louisianais et tous les autres groupes francophones aux États-Unis ainsi que les Franco-Caribéens), on ne peut nier que nous avons plusieurs points communs en plus de la langue. En effet, la langue, dans son aspect diachronique (historique) reflète un parcours sociohistorique plus ou moins commun, mais porte également des valeurs, une culture — certes largement métissée dans les Amériques — et une vision du monde distinctes. Distincte, différente des perspectives anglo-saxonne ou hispanophone par exemple, pour ne citer que les grandes cultures mondialisées du Nord global, anciennement colonisatrices.
Bref, nous, Québécois, francophones (et j’ose espérer anglophones et allophones), nous nous sentons différents du Reste du Canada. Même si ce sentiment ne repose que sur une perception, elle est un fait. Donc, nous sommes différents. Dans quel sens ? De quelle manière plus précisément ? Pas tout à fait dans notre mode de vie en tout cas, qui reste très nord-américain, comme je le mentionnais plus haut : économie, alimentation, transport, activités récréatives, habitudes de consommation en général, etc., sont pas mal identiques au ROC, avec quelques nuances près, je le concède. Peut-être dans une certaine conception des relations sociales, plus décomplexée, plus artistique, plus extériorisée et bruyante ; comme un parfum d’Europe, pourrait-on dire… Plus certainement à travers certaines valeurs partagées, qui, conséquence d’une histoire où religion et conservatisme social, ont longtemps commandé aux existences, rejettent précisément ces derniers. Le ROC plus multiculturaliste et religieux, par ignorance ou par mauvaise foi, peine à le comprendre avec son « secularism » qui ne peut traduire à lui seul le concept de laïcité. Au fil des années, il a reconnu progressivement et plus ou moins
explicitement les avancées sociales québécoises de la Révolution tranquille comme des standards valables pour tous les Canadiens.
Sinon, comment expliquer les programmes fédéraux en santé ? Enfin, Anglos comme Francos, nous nous distinguons par la place que nous accordons au français ; il est l’une des trois langues historiques du Canada, mais a été voté « langue officielle » du Québec. Qui le remet vraiment en cause aujourd’hui ?
Et bien, finalement, nous partageons bien plus que nous le croyons avec nos cousins français! C’est ce que la visite de Gabriel Attal — et bientôt d’Emmanuel Macron — vient souligner. Des visites historiques puisque le dernier discours d’un premier ministre de la République française devant l’Assemblée nationale datait de 1984 ! Il s’agissait à l’époque de Laurent Fabius, sous la présidence de François Mitterrand. Certes, la France, à travers Attal, maintient la ligne « ni ingérence, ni indifférence » des dernières années, loin du « Vive le Québec libre ! » du Général de Gaulle, mais reconnaissons qu’il était plus que temps que nous recevions le soutien d’un des rares pays dans le monde qui nous ressemble.
Un pas en avant, deux pas en arrière
Pour apprécier l’action d’un gouvernement, il faut comprendre ses prérogatives, ses champs de compétence. Et à moins d’être libertarien (l’état devrait juste s’occuper de battre monnaie et de défendre le territoire), il est évident que les actions de nos différents paliers politiques, municipal, provincial, fédéral, sont étendues et complémentaires. D’autant plus dans une confédération. D’où, avouons-le, une certaine complexité parfois, qui peut entrainer de la confusion. Une confusion que certains partis, certains politiciens, exploitent sciemment pour en tirer crédit. Malheureusement, cela renforce ensuite le cynisme et une indifférence délétères vis-à-vis de la chose politique, qui minent la démocratie.
Le gouvernement fédéral libéral a publié la semaine dernière son budget. Nous pourrions pousser des cris d’orfraie, nous exclamer, l’accuser à coup de formules assassines et simplificatrices… ou simplement examiner les faits, constater et formuler des critiques nuancées et pertinentes. Non, messieurs, les conservateurs, le gouvernement ne s’est pas « enrichi ». Pourquoi ? Parce qu’il n’est pas une entreprise à but lucratif ; si économies il y a, elles serviront à financer des programmes, de services aux citoyens. Il faut comprendre que le fédéral s’occupe finalement peu des actions concrètes, qui nous touchent au quotidien, il est surtout un « grand argentier » : il redistribue beaucoup d’argent à tous les échelons de la société, sous forme de subventions, de bourses, d’allocations, etc., dans le cadre de milliers de programmes, de contrats et d’ententes ; en plus de réglementer dans des domaines aussi variés que les banques, la recherche et les inventions, les lois criminelles, l’immigration, le transport, le commerce, les pêcheries, etc., et de gérer la monnaie, la défense, les relations diplomatiques ou les travaux interprovinciaux.
Toutefois, 1) selon la constitution, il ne devrait pas interférer dans les champs de compétences des provinces, où des assemblées démocratiquement élues votent les lois 2) il veille à ne pas trop endetter le pays, car cela nous rend vulnérables face aux institutions financières et autres pays. Remarque : il agit en fait comme nous, avec nos trois cartes de crédit, non ? 3) il priorise les domaines où dépenser en fonction de l’importance réelle des enjeux du moment et surtout à venir. Sur ces derniers points, rectifions quelques vérités.
Les libéraux font un peu n’importe quoi en s’arrogeant le droit de financer directement l’éducation (systèmes de garderie hors Québec), la santé (assurance dentaire) ou le logement (récent plan pour le logement abordable) ; je ne parle même pas de l’ingérence dans les débats autour des lois 21 ou 96. C’est peut-être louable — merci au NPD pour le coup de pression ! — mais anticonstitutionnel. Par ailleurs, le budget Freeland prévoit non seulement une réduction des dépenses, y compris celles de son administration, mais le Canada reste le pays de l’OCDE le moins endetté ! Quand on se regarde, on se désole, quand on se compare… En fait, la seule grande critique que l’on peut asséner à l’équipe Trudeau est son manque de vision pour l’avenir, sa myopie stratégique. Il place au second plan le seul véritable grand enjeu de notre temps et pour longtemps, qui commande autant l’économie que nos rapports sociaux et notre qualité de vie : la crise climatique. Au lieu de faire un pas en avant et deux en arrière, un bon gouvernement s’y attaquerait vraiment et nous rendrait définitivement moins pauvres !
Éditoriaux de mars
La tête de l’emploi
Didier Périès
Alexei Navalny (assassiné par un pouvoir autoritaire), Brian Mulroney (mort de maladie), France Bélisle (démissionnaire). Qu’ont en commun ces trois personnes ? La réponse est évidente : ce sont trois personnalités politiques qui disparaissent, d’une manière ou d’une autre. Certes ils résident dans des pays différents, ont eu des statuts — élu-e ou pas — et des fonctions politiques différents, mais ils nous invitent finalement à nous interroger sur les qualités qui font un bon politique. Nous aurons des élections dans les deux années à venir et des choix devront être effectués. Indépendamment de la plateforme et des valeurs portées par les candidats, pourquoi voteriez-vous un tel ou telle autre ? Et si vous envisagez d’être candidat-e, en avez-vous les qualités ?
Étant arrivé au Canada en 2005, je n’ai pas connu la période sous la gouverne de Brian Mulroney. J’ai lu et entendu pas mal autour de ce personnage qui restera comme un exemple d’« homme d’État » : on affuble les hommes politiques de ce titre, lorsque leurs actions semblent indiquer qu’ils ont fait passer l’intérêt supérieur du pays avant le leur ; qu’ils ont également une vision au-dessus de la mêlée. Dans le cas de Mulroney, au-delà de ses compétences et réalisations politiques, ce sont ses qualités personnelles qui sont souvent ressorties dans les commentaires posthumes : rassembleur, généreux, chaleureux… un pygmalion pour plusieurs autres grandes personnalités canadiennes ; parlez-en à Jean Charest ou à Lucien Bouchard !
En ce qui concerne Navalny, si au début des années 2000 il appartenait à un parti social-libéral et il était très nationaliste, il est difficile de jauger de ses idées et encore moins de ses réalisations politiques, puisque très rapidement, il était devenu l’opposant politique numéro 1 du dictateur Poutine et que, de ce fait, 1) il était facile de se démarquer d’une telle idéologie en prônant simplement plus de démocratie et de liberté d’expression, moins de corruption 2) jamais la chance de mettre en place des réformes ne lui avait été donnée, il n’avait même pas été élu. Là encore, ce sont ses qualités personnelles que l’on retient davantage : son intégrité, son courage physique et sa détermination jusqu’au-boutiste.
À notre échelle locale, l’annonce par la première mairesse de l’histoire de Gatineau, il y a deux semaines, de sa démission doit nous amener à réfléchir, même si l’issue actuelle est nettement moins dramatique. Après tout, une « majorité » (relative : sur les 35 % de citoyens qui ont voté, elle a obtenu une majorité de 42 %, soit 14 % des inscrits) d’entre nous ont coché son nom sur le bulletin en 2021. Or, il semble que le « climat politique » au conseil municipal ait joué un rôle dans sa décision. Est-ce que la joute politique était plus facile, moins âpre, il y a 20 ans, 50 ans ou au XXIe siècle ? Je serais tenté de dire non… il aura également été question de désillusion, d’intimidation sur les réseaux sociaux en particulier, parce qu’elle était une femme ? Possible. Mme Bélisle a voulu « préserver [sa] santé pour l’avenir, car la vie politique est éprouvante ». On peut le comprendre, mais se pose alors la question suivante : a-t-on élu la bonne personne à ce poste ? A-t-on bien mesuré sa pugnacité, sa résilience aux multiples pressions de ce que l’on appelle — et pas pour rien — l’arène politique ?
Abstenez-vous… ou quoi?
Didier Périès
J’ai enfin reçu le livre que j’attendais depuis plusieurs semaines : Glucose Goddess, la méthode de Jessie Inchauspé. Approche de notre alimentation à la mode, mais intéressante, qui se base sur les données de la biochimie afin de mieux réguler notre glycémie, source de plusieurs de nos maux. Une méthode et non une diète, et encore moins un jeûne. En matière de diététique, il existe d’ailleurs d’autres approches, notamment celle du jeûne intermittent, qui consiste à espacer les repas, souvent après une nuit de sommeil en ne « déjeunant » pas avant tard dans la matinée. Mais après tout, pourquoi jeuner ?
Dans l’histoire de l’humanité, le jeûne volontaire est essentiellement associé aux religions, depuis les plus anciennes — païennes, polythéistes, chamaniques — jusqu’aux plus récentes — Judaïsme, Christianisme, Islam — toutes le pratiquent. Certes, pas de la même manière. Restons donc sur les trois grandes religions monothéistes d’aujourd’hui, qui regroupent à elles seules plus de la moitié de l’humanité, au moment où les musulmans (avec le ramadan) et les chrétiens (avec le carême) entament leur grande période de jeûne annuel. Dans l’Ancien Testament, plusieurs fois, de simples juifs, des figues royales ou des prophètes pratiquent le jeûne pour montrer leur dévotion à Dieu, les remercier ou l’implorer : c’est un sacrifice qui leur permet de se rapprocher de Dieu. Aujourd’hui, il est comme un examen de conscience, un retour à la « pureté », et dure rarement plus de vingt-quatre heures (Yom Kippour et cinq autres jours).
Plus tard, Jésus Christ, en bon rabbin un peu radical, commencera son ministère par quarante jours de jeûne, pendant lesquels il est dit qu’il résistât à Satan (l’envie de manger ? Les « passions terrestres » ?) ; ensuite, il demandera à ses disciples d’y associer la prière. L’ensemble restait personnel, privé. Aujourd’hui, les catholiques font carême, en mangeant frugalement nuit et jour, en réduisant leur consommation, en renonçant à toute forme de péché pour marquer symboliquement la mort et la résurrection du Christ. Les protestants, quant à eux, le pratiquent de manière moins rigoriste.
Ce dépouillement (en étant plus charitable, moins sur nos téléphones ou les réseaux sociaux), cette humilité (en mettant de côté nos besoins et désirs) pour mieux se rapprocher de Dieu, les musulmans le partagent avec les chrétiens. Il est même l’un des cinq piliers de l’Islam, mais qui ne s’applique que pendant les heures de la journée ; la nuit tout est permis… ou presque. En effet, ce mois de célébration du moment où « le Coran descendit comme direction pour les hommes » doit quand même rester une remise en question, un retour vers Dieu, un test de piété qui conduirait l’individu à devenir meilleur. Se priver de manger, boire et faire l’amour nous rappelleraient que ce sont des actes sacrés, créés par Dieu…
Finalement, dans toutes les religions ou approches spirituelles (le bouddhisme, une ascèse du corps et de l’esprit devenue religion, vise le même objectif), la raison profonde du jeûne est toujours plus ou moins identique : se priver de nourriture conduirait à un état de réceptivité « supérieur », un état second où l’on accéderait à une réalité supérieure… Il me semble pourtant que cela peut se faire assez simplement, plus naturellement, sans rite particulier ou contraintes autres que celle d’arrêter manger ; ne pas boire est plus compliqué, puisque, sans hydratation, l’être humain meurt au bout de trois jours.
Attention à la dilution… du français!
Didier Périès
Mars est le mois de la francophonie canadienne ; le 21 mars, la Journée internationale de la Francophonie et, le 11 mars, l’anniversaire de la disparition du « père » de la Charte de la langue française (ou Loi 101), une initiative d’abord — et j’insiste là-dessus — culturelle. En 1984, le fameux livre blanc de Camille Laurin (et de Fernand Dumont, son principal rédacteur) relevait de la stratégie à long terme plutôt que de la tactique et juridique à court terme de la CAQ aujourd’hui avec sa loi 96.
Dernièrement, Statistiques Canada a publié ses plus récentes données à propos des langues maternelles au Canada. Admettons d’abord que cette question dépasse largement la dualité linguistique anglaise et française du pays. Le Canada est un pays multilingue. Et le Québec aussi ! Quand je regarde autour de moi les jours de célébration publique sur la rue Principale, ou quand je me trouve à la Marina et dans les commerces, je vois une société plurielle, diversifiée, pas de doute. Malgré le nombre grandissant d’Ontariens anglophones qui prennent Gatineau comme un dortoir plus abordable, le facteur commun des Gatinois reste encore la langue française… Et à l’échelle de la province, ce phénomène n’est pas nouveau, même si la situation n’est pas non plus si ancienne : jusque dans les années 1970, l’immigration francophone est essentiellement européenne. Avant la Loi 101, 80 % des immigrants au Québec passaient à l’anglais ! Mais deux générations ont passé !
Reste que, quelle que soit l’importance démographique — et même historique — de langues telles que les langues chinoises, le pendjabi (en Colombie-Britannique et à Toronto) ou les langues autochtones, nous avons encore au Canada deux langues officielles, le français et l’anglais. Ramener le français à une langue, une culture comme les autres n’est rien d’autre que de l’assimilation. Si c’est ce que veulent certains, et bien, qu’ils aient le courage de se manifester !
Devant l’anglicisation rampante de la société québécoise, davantage dans les grands centres urbains, et surtout à Montréal, observons qu’il y a d’un côté ceux qui pensent que pour sauvegarder le français et la culture — même si elle est toujours en évolution et se nourrit d’influences extérieures — la seule solution est l’indépendance ; et de l’autre côté, ceux qui avancent que ce caractère distinctif du Québec pourrait s’épanouir au sein de la fédération, dans un Canada respectueux de ce dernier… Et puis, il y a ceux qui tentent de jouer sur les deux tableaux en flattant la « nation » tout en se subordonnant aux décisions d’Ottawa.
Quant à notre jeunesse, elle ne ressent pas cette urgence d’agir, parce que notre société mondialisée baragouine le « globish » et elle baigne dans des références culturelles et économiques anglophones, tout en jouissant du privilège de vivre en français, grâce à la loi 101, ironiquement ! Alors que le nombre de Québécois employant uniquement le français au travail a quasiment baissé de 10 % (de presque 40 % à 32 %) en 8 ans, selon l’Office québécois de la langue française, chez les 18-34 ans, c’est seulement 22 %.
Finalement, être Québécois ne signifie peut-être pas être unilingue francophone, contrairement à ce que déclare Elvis Gratton quand il peine à se définir, mais comment peut-on vivre en Outaouais, au Québec, et ignorer volontairement le français ? C’est un mystère auquel je me bute régulièrement.
Rougeole, vaccination et régression sociale
Didier Périès
Les cas augmentent chaque semaine, mais pas de panique : on est à peine à une vingtaine de personnes et elles se trouvent principalement à Montréal. Cependant une maladie qui devrait avoir disparu de nos radars médicaux ressurgit encore. La dernière fois, c’était il y a cinq ans et l’on avait atteint 113 cas dans tout le Canada, un tiers provenant du Québec.
Alors, pourquoi parler de la rougeole ? D'abord, parce qu’elle est très contagieuse — elle se transmet par voie aérienne. Ensuite, parce qu'elle peut être grave. Certes, la caractéristique de la rougeole est que des rougeurs se développent sur le visage et tout le corps, mais surtout elle peut présenter un danger mortel pour les femmes enceintes et les bébés ! Or, jusqu’à récemment, et grâce à la vaccination des bébés depuis 1970, elle avait été presque éradiquée.
Que s’est-il donc passé entre-temps ? Vous pouvez le deviner… Le nombre de personnes vaccinées a baissé. Dès lors la vraie bonne question porte sur la cause de ce recul. Plusieurs experts pointent du doigt la CoVid-19. En effet, plusieurs parmi nous sont (moralement ou mentalement) fatigués qu’on leur parle de vaccination. Vous en faites partie ? C’est humain. Toutefois l’autre explication provient de manière dont les gens sont informés, ou plutôt mal informés : par les réseaux sociaux, sur lesquels de plus en plus de désinformation circule, alimentant la méfiance de la population.
Exemple : « Une vaste étude mondiale confirme les liens entre les vaccins et de potentiels problèmes de santé » (Journal de Montréal, 20/02/2024) a enflammé les médias sociaux, il y a deux semaines… Antivacs, vous qui lisez un peu trop vite, préparez-vous… Cette étude a été faite sur 99 millions de personnes vaccinées contre la CoVid-19! un échantillon plus que représentatif qui montre tous les effets possibles mieux que si c’était sur 10 000 individus. Eh bien, oui, elle confirme que les vaccins à ARN messagers sont susceptibles de provoquer un peu plus de myocardites ! Mais seulement 7 cas sur 10 millions (ayant reçu leur première dose de Moderna) ont eu des effets. De plus, cette corrélation ne signifie pas causalité. Mais les chercheurs ont également conclu que les effets de la maladie sont bien pires, en qualité et en quantité, que le vaccin ! En fait, sachez que vous avez plus de chance d’être frappé-e par la foudre !
De toute façon, plus généralement, le principe de la vaccination est indiscutable : un organisme exposé plus d’une fois à un agent pathogène (ou antigène : virus, bactérie, parasite, champignon), envoie une réponse plus rapide et plus efficace, grâce aux cellules mémoires qui sont prêtes à produire les anticorps. Donc, un vaccin composé d’éléments affaiblis ou inactifs d’un l’antigène provoque une meilleure réponse immunitaire. Point. Ce procédé a largement prouvé son efficacité : la poliomyélite, la diphtérie, la variole ou le tétanos ont disparu dans les pays du Nord global, et combien d’autres maladies sont devenues rares ?
Pour revenir à la rougeole, ou toute autre maladie pour laquelle vous auriez dû être vacciné-e, il est aisé de vérifier : regardez votre carnet de vaccination (vous aviez entre 12 et 18 mois) ; si nous n’en disposez pas, consultez sur Internet le Registre de vaccination du Québec. Au pire, prenez rendez-vous sur Cliq Santé, c’est gratuit. Maintenant vous êtes informé-e !
Éditoriaux de février
Nos centres-villes
Didier Périès
Il y a quelques semaines, un sondage commandé par la ville de Gatineau a révélé qu’un Gatinois sur deux ne sait pas où se trouve le centre-ville de Gatineau. Un tiers des répondants pensent qu’il se situe près de la place de la cité et des promenades de l’Outaouais. Pour d’autres, il serait encore dans le Vieux-Hull ; le conseiller municipal Steve Moran le justifie par les indicateurs suivants : une « concentration de transports, une concentration d’entreprises et une économie ». Cela s’applique aussi pourtant au quartier de la Cité, dans le secteur Gatineau ? Et au Vieux-Aylmer ? Nous avons donc un vrai problème, qui explique peut-être pourquoi la ville semble dans l’incapacité de revitaliser le centre-ville ! Quel centre-ville ?
Selon Le Larousse, c’est « le quartier le plus central d’une ville, le plus ancien, le plus animé ». Où est le centre de Gatineau, géographiquement ? Quelque part dans le secteur Gatineau sans conteste! Sur le site officiel de la ville, c’est l’île de Hull, parce qu’elle est le « berceau de l’urbanisation en Outaouais […] constitué d’une pluralité de milieux distincts […] principal pôle d’emploi […] en plus d’être un milieu de vie dynamique ». On énumère ensuite les points d’intérêts, notamment culturels, et les grands évènements… OK, mais l’on croisait avec le critère de l’âge ? Le Vieux-Hull se qualifie encore… Bien qu’au fond, chaque « centre-village » des différents secteurs ait un vécu plus que centenaire. Prenons notre rue Principale, qui mène au lac Deschênes, point de rencontre des populations autochtones depuis des temps immémoriaux, et à l’auberge Symmes, lieu historique fondateur de la drave dans la région. Le plus animé ? Cela dépend des soirs et des spectacles : à la sortie de la salle Odyssée, qui reste dans le coin pour boire un coup ? Parallèlement, à partir du jeudi, les soirs, c’est pas mal occupé dans quelques rues autour de la rue Laval !
En géographie, le centre-ville désigne le « cœur historique et décisionnel » de la « ville-centre », elle-même commune-centre (mais on pourrait appeler cela district) de l’agglomération. De ce point de vue, compte tenu de la présence de la Maison des citoyens, ce serait le Vieux-Hull. L’affaire parait donc bouclée… sauf que pour l’Encyclopédie Universalis, il s’agit d’« un quartier au centre-ville, où se situent la plupart des monuments et commerces de la ville ». Dans ce cas, nul doute que le quartier autour du Centre sportif et de la Maison de la culture, du Centre Slush Poppie, avoisinant les Promenades de l’Outaouais, gagne le pompon.
Le Vieux-Hull fait un peu pitié, d’où la grosse discussion actuelle sur sa dévitalisation. L’aspect commercial est indissociable d’un centre-ville, mieux, il ne peut exister sans lui. La population doit le fréquenter sur une base régulière pour le faire vivre économiquement. Deux solutions : soit les gens viennent de l’extérieur très souvent, il faut donc qu’ils y trouvent une bonne raison ; soit, ils y habitent. Malheureusement, malgré la fusion, plusieurs Gatinois, ont gardé des habitudes de consommation plus locales. Aylmer, par exemple, possède une rue Principale plutôt attractive et des commerces assez variés pour combler la plupart de nos besoins. Pourquoi aller ailleurs ? Et comme depuis des décennies, le Vieux-Hull est un quartier de travail, mais jamais de résidence. La désaffection des fonctionnaires fédéraux ces dernières années (travaux au Portage et CoVid-19) nous a laissé orphelins. Inadmissible pour une ville comme Gatineau!
Pas de remède miracle à l’inflation!
Didier Périès
Et les partis politiques ou les analystes qui vous disent le contraire vous mentent… Pire, si vous croyez que le taux directeur de la banque centrale du Canada est la porte de sortie de l’impasse dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui, détrompez-vous.
En freinant l’inflation, les hausses de taux successives des deux dernières années ont certes réussi, mais 1. Les conséquences n’ont pas fini de se faire sentir (pensez à tous les gens — entreprises ou particuliers — qui doivent renégocier le taux d’intérêt de leurs prêts hypothécaires ou simplement emprunter de l’argent) 2. Comme l’a annoncé Tiff Macklem, le directeur de la Banque du Canada, le retour à la baisse n’est pas pour tout de suite… tout en laissant une lueur d’espoir (pour qui ?) : c’est une question de temps avant que ce taux, qui conditionne les taux bancaires, redescende. Mais pas de beaucoup de toute façon et jamais à 0,25 %. Il ajoute du même souffle que puisqu’il n’y a pas de « crise » (que lui faut-il ?) et que l’inflation n’est pas retombée à 2 %, on peut continuer sur la lancée…
Or, la vraie question est de savoir à quoi est due ladite inflation. Parce que le Canada n’est pas le seul pays touché, le phénomène est mondial ! L’inflation résulte d’abord d’une reprise économique post-CoVid-19 brutale et massive, qui a libéré une demande impossible à satisfaire, dans un contexte où les chaines d’approvisionnement avaient été brisées. Le rapport de force étant à l’avantage des entreprises, ces dernières en ont profité pour augmenter leur marge bénéficiaire. Par ailleurs, la guerre en Ukraine, en raréfiant le gaz, a entrainé la hausse des prix des autres combustibles avec un impact jusqu’ici, bien que moindre parce que le Canada et les États-Unis sont des producteurs. Il y a cependant une pression sur les prix globalement. Malheureusement, ce n’est pas tout : le nouvel ordre mondial multipolaire comporte désormais des risques à délocaliser la production ; on assiste donc à un retour au bercail grandissant des usines et à la mise en place de politiques protectionnistes pour sécuriser l’approvisionnement en matières premières. Plus personne ne peut imposer sa loi à grande échelle, les conflits régionaux ressurgissent et les obstacles à libre circulation des marchandises se multiplient. Autant d’éléments qui ajoutent durablement à la cherté des produits.
Pire, s’ajoute ici à la hausse des prix à la consommation, une pénurie de logements abordables, elle-même causée, entre autres, par une hausse des frais généraux et des coûts des matériaux dans la construction. Et là encore, une banque centrale n’y peut quasiment rien. L’offre de logements est chroniquement insuffisante ; il en résulte mécaniquement une hausse des prix. La solution des marchés ? Aider les consommateurs ? Voyons, non, plutôt « stimuler » l’offre, c’est-à-dire donner de meilleures conditions aux entrepreneurs, soit en réduisant les taxes, les normes, etc., soit en les subventionnant. En gros, il faut faire confiance à des gens dont le but est le profit immédiat pour nous offrir des solutions de logement à moyen long terme. Ils pourront ainsi s’engraisser encore davantage sur notre dos. Sympa ! Le coût de nos vies va augmenter, et à cela,
pour moi, il n’y a qu’une solution : renforcer les solidarités, mener des politiques publiques solides et aller chercher l’argent là où il se trouve.
La peste brune
Didier Périès
J’écoutais la semaine dernière le Balado de l’émission « Les Décrypteurs » et l’un des intervenants a fait une remarque extrêmement juste : les médias traditionnels ne portent pas assez attention à ce qui se passe dans les médias sociaux. Ces derniers sont souvent ignorés, pourtant ils influencent une partie grandissante de la société. En effet, beaucoup de gens se sont détournés de la presse écrite ou de la radio-télévision habituelle pour s’informer à travers Méta, X, Telegram, TikTok ou pire.
Or se joue ici un combat pour la vérité et l’opinion juste qui va déterminer l’avenir de nos démocraties. Des courants de pensée radicaux le traversent, y font leur nid, gagnant de plus en plus d’adeptes. On nomme cette nébuleuse « la complosphère », parce que les nouvelles qui y circulent tournent souvent autour des mêmes prémices : les gouvernements, les pouvoirs publics, la télévision, la radio et la presse écrite établis nous mentent et, de façon concertée, nous manipulent. Et tout ce qui émane d’eux n’est que tromperie, dissimulation et malfaisance.
L’exemple le plus frappant au Canada en est certainement la tournée qu’a effectué Tucker Carlson. Vous n’en avez pas entendu parler ? En effet, moi non plus. Pourtant, l’ancien journaliste-présentateur vedette de Fox news remplit des salles entières à l’ouest du Canada (4000 personnes à Calgary, 8000 à Edmonton, à 200 $ l’entrée). Il a même rencontré fin janvier la première ministre de l’Alberta. Vous avez bien lu : il a l’oreille de Danielle Smith ! Pour mémoire le monsieur a été remercié afin d’éviter un procès en diffamation, suite à sa couverture de la dernière élection présidentielle américaine. Donc parce qu’il a menti. Il a aussi déclaré vouloir libérer le Canada de Justin Trudeau qu’il qualifie régulièrement de dictateur et de tyran communiste. Ah ! Ces amis ? Orban en Hongrie, Milei en Argentine ou Poutine en Russie. Ce serait risible, s’il n’avait aucune influence.
La campagne de désinformation qui a déferlé aux États-Unis (et ailleurs) à propos de Taylor Swift avant, pendant et après le Superbowl est une autre illustration de la désinformation qui circule sur les médias sociaux. Le problème est qu’aujourd’hui, ce sont les défenseurs d’une idéologie d’extrême droite qui les accaparent ; que la mondialisation de ce phénomène met en contact des individus et des groupes aux idées régressives. Qu’on les appelle la droite alternative, la droite nationale, des nationaux-socialistes, des libertariens ou des fascistes, ne change rien au fait qu’ils mangent tous du même pain : xénophobie, homo et transphobie, antisémitisme, ultranationalisme, défense des valeurs de la religion (surtout chrétienne), conservatisme social et populisme. Même le forum économique mondial, pourtant souvent qualifié de club des pays riches, s’est inquiété du poids grandissant de la désinformation qui se répand dans le sillage de cette idéologie. Et là où ces gens-là accèdent au pouvoir, alors, ironiquement, le pluralisme d’opinion se dégrade, alors qu’ils clament souvent défendre les « libertés » tout en jetant l’opprobre sur les journalistes, garde-fou d’une saine démocratie.
Dès lors, on ne s’étonne plus de la polarisation du débat public et de la position de tête occupée par les conservateurs dans les intentions de vote au Canada. Ils se nourrissent du manque d’éducation de la population, du cynisme général face à la démocratie participative et de la tiédeur des réformes libérales face aux grands enjeux de notre temps.
Allez-vous participer à cette manifestation ?
Didier Périès
Dans le droit fil du sujet que j’ai abordé la semaine dernière… Au milieu de la cacophonie ambiante des groupes, des mouvements et des coalitions de tous poils, il est difficile parfois d’entendre les voix justes. Les médias sociaux, que plusieurs d’entre nous considèrent comme des sources d’information, ne font qu’aggraver la situation. On peut même se laisser attirer par des voix séduisantes, qui utilisent des mots qui nous interpellent : liberté, pensée indépendante… Justement, la semaine dernière, mon œil a remarqué la lettre d’opinion de la « coalition of independant thinkers » (en anglais dans sa traduction française aussi) et son tour du Québec intitulé « Parlons du Québec ». Je me targue souvent de tenir de la « libre pensée », à la manière des humanistes du XVI-XVIIe ou des lumières du XVIIIe. Mais il semble que cette expression est désormais galvaudée. Quand j’ai lu qu’il s’agissait encore d’un convoi de voitures, « avec des pancartes, des drapeaux » (cela ne vous rappelle-t-il rien ?) et que ce dernier partirait des Cantons-de-l’Est, haut lieu de l’anglophonie québécoise, ma curiosité s’est transformée en suspicion. Cette initiative m’apparaissait soudainement plus que louche, comme d’autres qui se présentent masquées, déguisées sous les oripeaux des droits et libertés. J’avais l’impression que cela cachait quelque chose, je me suis donc informé sur son organisateur, Marc Perez.
Et bien, rendez-vous compte que M.Perez est chef de parti politique provincial ! Lui-même n’est autre que le membre fondateur du Parti canadien du Québec, dont les compétences viennent de sa formation collégiale en communication et de son expérience professionnelle dans la technologie et le marketing. Son credo ? Remettre en cause les politiques du gouvernement actuel ! Pas très original, remarquerez-vous ; en effet, on n’en attend pas moins d’un parti politique dans l’opposition, eût-il reçu moins de 3 % des voix lors du dernier scrutin…
Maintenant, à partir de son site web, on comprend vite que 1. La démarche est populiste, dans le sens où il entend rassembler les gens insatisfaits du gouvernement caquiste et que l’on n’écouterait pas, d’où la tournée à travers la province. Un parti pour les gens, par les gens ! 2. le fonds de commerce est un fourre-tout sans vision. Ce parti « apolitique » n’aurait selon ses dires pas d’autre vision que celle de ses membres, autant dire tout et n’importe quoi. Entre les lignes, quand on lit le descriptif, on y trouve un mélange contradictoire de défiance envers l’état — au détriment des libertés individuelles, notamment celle de faire de l’argent comme on veut — et d’ingérence des pouvoirs publics. Où est la vision là-dedans ? Choisissez-vous votre parti politique comme vous magasine votre épicerie ? Cependant, en entrevue, M.Perez avance principalement que tous les problèmes, quel que soit leur domaine (son site n’en présente officiellement que trois : santé, économie, logement — cherchez l’erreur !), ont pour origine une seule et même cause : la loi 96. Cette loi qui consacre la prééminence du français comme langue officielle du Québec.
Sous prétexte de défendre les minorités, y compris les autochtones, ce parti est en fait surtout anglophile, communautariste et fédéraliste. Il appartient donc à cette nébuleuse de la droite conservatrice qui fleurit dans nos sociétés postpandémiques du Nord global, et qui ne trouve rien d’autre de mieux à faire que de s’enfermer sur elle-même à l’heure de l’urgence climatique.
Éditoriaux de janvier
L’écran de fumée climatique

Je suis estomaqué par l’offensive médiatique du gouvernement libéral ces dernières semaines. Si vous regardez la télévision en particulier, vous n’avez pu manquer ces publicités : qu’elles insistent sur les efforts intenses et systématiques du gouvernement dans son ensemble pour contrer les changements climatiques, ou qu’elles en présentent les actions sectorielles, comme cette annonce sur la défense des canards ou cette infopublicité sur la flore et la faune canadienne, il semble bien que les libéraux de Trudeau aient coordonné une campagne qui dirige les projecteurs — et notre attention — sur le peu qu’ils ont fait, en lieu et place de ce que leur « meilleur plan climatique » aurait dû réalisé. Dans la doctrine libérale, les mots valent autant que les actes… au point que, parfois même, ils les remplacent et dire c’est faire.
On peut qualifier cela de pensée magique, au mieux, ou de propagande à demi-mensongère au pire, parce que malheureusement, en matière de crise climatique, seul un plan d’action complet et réalisé — pas juste annoncé — nous aidera à l’affronter. Sinon, cela restera de l’enfumage, et nous le paierons très cher, l’un de ces jours pas si lointains, alors que Justin Trudeau vivra de conférences et de livres « autobiographiques », dans lesquels il prodiguera sans remords ses conseils d’ancien premier ministre et de leader mondial en échange de quelques milliers de dollars. En attendant, il ne sera plus aux affaires et nous, nous serons dans les ennuis jusqu’au cou !
En tout cas, la publicité payée avec mes/nos impôts qui a fait déborder le vase de ma patience est parue dans le quotidien Le Devoir. La moitié supérieure de la page est constituée de trois bandes, chacune contenant une seule photo sur toute la largeur. La première montre en plan rapproché les bras d’une personne en train de placer des serviettes sur un étendoir pliable ; on voit sur la deuxième un technicien qui travaille sur un climatiseur avec le logo et l’inscription d’Énergy Star bien évidence ; enfin, dans la dernière, une femme accroupie devant une boite à compost (dans un — son ? — jardin) sélectionne des déchets alimentaires. Un peu plus bas, en énormes caractères, le message principal : « L’action climatique commence à la maison », et au cas, où nous n’aurions pas bien compris, il nous est expliqué en sous-titre que « nous avons tous la capacité d’agir […] Ensemble, nous pouvons créer un effet domino au sein de nos communautés », etc. Donc, si je résume, sous couvert de nous responsabiliser, on joue sur le ressort de la culpabilité individuelle, avec une approche soi-disant encourageante et « bienveillante » ; comprendre : paternaliste. J’oserais répliquer : et toi, gouvernement du Canada, que fais-tu vraiment qui par un effet domino change durablement la donne ?
Que fais-tu pour réduire les GES ? Que fais-tu pour empêcher l’écoblanchiment des compagnies pétrolières et gazières ? Que fais-tu pour faire payer les pollueurs majeurs dans les secteurs du transport et de l’énergie ? Que fais-tu pour protéger réellement l’environnement naturel ? Pour décarboner l’économie ? Pour financer les initiatives locales, communautaires, équitables et solidaires ? Et finalement, que fais-tu pour dédommager les pays du sud et financer leur transition énergétique ? Parce que seuls, nous ne pouvons pas grand-chose et seule une coopération internationale totale, massive et de de bonne foi nous sauvera du pire. Or cela ne tient qu’à nous, qu’à un gouvernement courageux et visionnaire.
Un nouveau défi pour 2024?

Alors que nous en sommes encore à nous souhaiter les vœux pour la nouvelle année, je me suis surpris à vouloir partager l’une de mes résolutions pour l’année à venir. Peut-être me trouverez-vous superficiel, mais j’aimerais aborder la question des vêtements. Oui, oui, ce que nous portons tous les jours autant que les tenues pour des évènements exceptionnels. J’avoue que la lecture d’un livre est à l’origine de cet élan hivernal, même si je suis déjà sensibilisé à la cause en tant qu’écologiste, mais également parce que l’une de mes filles n’achète tout simplement plus de vêtements depuis qu’elle habite à Berlin, en Allemagne. Là-bas, les gens placent devant leur porte les habits en état et propres dont ils ne veulent plus et on peut se servir ; ainsi s’est créé une espèce de marché informel, qui confine au troc. Une économie parallèle sans contrepartie monétaire !
Quoi qu’il en soit, avez-vous remarqué que s’habiller coûte de moins en moins cher ces dernières années, que l’offre est beaucoup plus variée que jamais et que la publicité ciblée fait rage, notamment sur les médias sociaux ? Nous sommes très très encouragés à acheter, à consommer. Et les faits sont indiscutables : le rythme de la mode s’est accru ; le nombre de vêtements produits chaque année a doublé depuis le début du XXIe siècle, pour atteindre une moyenne de 14 articles par être humain à l’échelle de la planète. Nous vivons une surproduction (et une surconsommation) jamais vue, et dans le pays du nord global, nous menons un train (de vie) qui semble inarrêtable. Pensez aux soldes à tout moment de l’année, ou encore à la facilité de commander des vêtements en ligne… Toutefois, combien d’entre nous se posent des questions au moment d’acheter de quoi se vêtir ?
D’ailleurs, savez-vous combien vous possédez de « pièces » ? Allez, faites comme moi et prenez cinq minutes pour faire le tour de vos placards, armoires, commodes et autre walk-in. Un costume ou un tailleur « deux pièces » compte pour deux, comme son nom l’indique… Et n’oubliez pas les chaussettes, les sous-vêtements, écharpes, gants, bonnets, etc. ! Alors ? Et oui, vous faites probablement la même tête que moi quand j’ai eu fini de faire le compte ! Total personnel : environ 250 !
C’est énorme ! Et quand tout ce tissu ne reste pas inutilisé dans nos maisons, parfois jusqu’à notre mort, il est tout simplement jeté et vient s’ajouter aux invendus que les magasins, les fabricants, les friperies et autres centres de dons envoient dans les pays du sud. Comme pour nos autres déchets, ils atterrissent dans certains pays prêts à tout pour augmenter leur revenu national et où les normes environnementales ne sont pas rigoureuses… avec les conséquences néfastes pour l’environnement que vous imaginez. Et ils viennent évidemment s’ajouter à la pollution produite lors de leur production !
Cependant, la véritable question est : qu’est-ce qui peut sérieusement justifier que nous achetions de nouveaux vêtements si souvent ? Il y a peu de réponses valables, convenez-en. Pour cette raison, j’ai décidé de faire un petit peu plus ma part pour la planète. Sans aller jusqu’à ne plus acheter de vêtements du tout, à l’instar de Valérie Simard (Une Année de détox vestimentaire, Éditions La Presse, 2024), je m’engage à ne plus en acheter un seul qui soit neuf en 2024 !
Les belles affaire!

La semaine dernière, j’ai eu une prise conscience brutale à propos du gouvernement caquiste. Il est souvent qualifié de défenseur du Québec inc., parce que François Legault et beaucoup de ses ministres viennent du milieu de l’entreprise, parce que son credo est l’économie, et surtout parce qu’il se vante de ses succès en la matière et qu’il clame défendre d’abord les entreprises québécoises. Déjà, pas n’importe lesquelles, plutôt les grosses compagnies incorporées, avec de gros capitaux, qui font de gros investissements (ou en demandent à l’état) pour engranger de gros bénéfices. L’installation de Northvolt dans notre belle province aux frais du contribuable québécois, au mépris des règles environnementales et de l’opinion des principaux intéressés, les habitants de la Montérégie, pour des bénéfices lointains, en est un exemple frappant. Bref, soudain, le surnom de la CAQ ne me semblait plus usurpé.
Mais le déclic de mon épiphanie ? L’annonce par le même gouvernement qu’il permettrait à des compagnies exploitant les énergies hydroélectrique et éolienne de les vendre à d’autres (grandes) entreprises en ayant besoin. À première vue, rien de plus normal : après tout, on peut concevoir qu’Hydro-Québec ait de la difficulté à répondre à la demande ; on pourrait également arguer que son mandat est surtout le service à la population, une sorte de mission de service public… Et puis si les entreprises préfèrent s’arranger entre elles, pourquoi pas ? D’accord, mais si l’un de ses « producteur » d’énergie devient propriétaire d’une grosse partie du territoire québécois ou d’une rivière majeure, que fait-on ? Et si un jour l’une de ses entreprises devient un concurrent si puissant qu’il concurrence Hydro-Québec, qu’il peut influer sérieusement sur les tarifs énergétiques ou de vendre de cette ressource dont M. Legault semble si fier ? Ne faisons-nous pas rentrer le loup dans la bergerie ?
Comme dans le domaine de la santé, en déléguant aux cliniques privées de plus en plus de services, au risque que le personnel de la santé migre massivement vers le privé, ce qui affaiblirait encore plus un système public déjà à l’agonie, ce qui ironiquement contribuerait à justifier le transfert de la santé à des intérêts privés dont le principal objectif est de faire de l’argent, pas de soigner l’humanité souffrante !
Ajoutons-y le peu d’empressement (véritable) des caquistes à mettre en place les solutions en éducation (le règlement du conflit récent est au mieux un pansement qui sautera au moindre soubresaut) ou encore la braderie des claims miniers à l’échelle de la province, je m’excuse de le dire : François Legault déconstruit peu à peu le modèle social mis en place dans les années 1970 et 1980. La CAQ démolit un système progressiste fondé sur la solidarité et des politiques publiques novatrices en éducation et en santé qui a permis au Québec de prendre part au concert des nations modernes. Un héritage duquel le premier ministre affirme être le continuateur. Son inféodation à la grande industrie lui fait oublier que 80 % des entreprises sont des PME : ce sont elles qui sont au cœur de l’économie québécoise. À pas de loup, la CAQ brise les solidarités et confie l’avenir de nos enfants à des intérêts privés dont le seul but est de « faire des affaires » sur notre dos, pour mieux se dorer la pilule dans un paradis fiscal.
Les journaux sont morts, hein ? Qui l'a dit ? Le téléphone n'arrête pas de sonner ici au Bulletin !

Les lecteurs remarqueront dans cette édition une publicité expliquant comment s'abonner au journal. Jusqu'à présent, la plupart des gens recevaient leur journal local gratuitement par la poste ou au PubliSac (selon l'endroit où ils habitent). Le PubliSac va bientôt fermer complètement, et les journaux se démènent donc pour trouver un moyen abordable de mettre le journal entre les mains des lecteurs.
Oui, des changements se produisent. Il est vrai que les fausses nouvelles sur les médias sociaux sont frustrantes, voire pénibles. Cela signifie que l'appétit pour les informations locales est presque vorace en ce moment. Nous augmentons sans cesse notre capacité d'impression et pourtant, nous n'arrivons pas à garder suffisamment de journaux sur les étagères.
Sachant que les lecteurs demandent toujours plus d'informations imprimées, il est très difficile de comprendre pourquoi quelqu'un dirait que les journaux sont morts. À moins que ce ne soit parce qu'ils répètent les stupidités verbales entendues à la télévision ou à la radio ? Les journaux locaux ne sont pas des méga-entreprises qui doivent verser des dividendes à leurs actionnaires. Les marges bénéficiaires peuvent être très faibles et pourtant, l'équipe publie un journal. C'est parce que nous croyons en la communauté. Les membres du Bulletin se sentent encouragés par les organisateurs communautaires qui nous remercient d'avoir couvert leur événement. Lorsqu'un chef d'entreprise appelle pour dire que la publicité a trop bien fonctionné et qu'il doit faire une pause, le service de publicité a le sentiment d'avoir bien fait son travail.
L'inverse est également vrai. Les gens demandent régulièrement pourquoi la ville ne fait pas de publicité pour les expositions d'art, les festivals d'hiver, les cours et toutes les autres activités locales que les lecteurs veulent connaître.
Au Bulletin, nous haussons les épaules et répondons : demandez à votre conseiller municipal. Il en va de même pour les autres niveaux de gouvernement, mais c'est plus difficile à expliquer au niveau local.
Cependant, le fait même que les lecteurs posent des questions suffit à motiver l'équipe à continuer.
Oui, le PubliSac ferme ses portes et un nouveau système de distribution est en train d'être mis en place pour le Bulletin de Gatineau.
Appelez-nous ! Nous vous expliquerons tout : comment vous abonner, où aller chercher le bulletin et comment ajouter votre magasin de quartier à notre liste de distribution.
Notre objectif est de servir les lecteurs, de couvrir les sujets qui les intéressent, et ce, à long terme. Longue vie à l'information locale imprimée !
Nos solidarités, un simple coup de vent?

Ah ! L’immigration! Ou plutôt, les immigrants ! J’en suis un, et combien d’entre vous en êtes également, ou bien les descendants ? Qui jetterait la pierre à un frère ou à une sœur humain-e qui désireraient venir vivre ici ? Le droit de se déplacer, de rêver d’un ailleurs plus accueillant est fondamental. Certains me rétorqueront peut-être que là n’est pas le problème.
Et bien, parlons-en du problème. Apparemment, il réside dans notre capacité matérielle d’accueil. Pas dans notre ignorance ou notre peur de ces inconnus, voyons… Il y aurait de toute façon beaucoup de mauvaise foi dans cette attitude. Habituellement, on dit des immigrants qu’ils prennent le travail des locaux. Aujourd’hui, dans un contexte de pénurie de travailleurs (plus de 250 000 postes vacants au Québec), l’argument ne tient évidemment plus. Même l’extrême droite européenne utilise peu cet argument d’ailleurs.
Non, le problème est que nous en recevons trop, des immigrants, n’est-ce pas ? Nous n’avons plus assez de logements pour eux, la demande tire les prix vers le haut et rend ainsi et leur nombre et leur prix incompatibles avec le porte-monnaie des citoyens moyens. Déjà quelques chiffres pour commencer à replacer les choses. Le plan canadien prévoit toujours, malgré tout ce que peut dire le gouvernement Trudeau, un nombre croissant de résidents permanents ; objectif : 485 000 en 2024, 500 000 en 2025 et 2026. Il s’agira d’immigrants économiques, ou de familles regroupées ou de réfugiés surtout. Et dans certains domaines jugés prioritaires : santé, STEM, métiers spécialisés. Le résident permanent, comme son nom l’indique, vient pour s’installer durablement, voire rester toute sa vie. Il n’arrive pas pour des études, pour un emploi saisonnier ou avec un permis de travailleur qualifié impossible à trouver au Canada. Pourquoi devrait-on en limiter le nombre ?
En revanche, on peut penser qu’il y a vraiment de l’abus quand on apprend que seulement au Québec se trouvent près de 500 000 travailleurs temporaires ou qu’en Ontario, la moitié des collèges vont se retrouver dans le rouge après que le Fédéral aura réduit de 35 % le nombre de permis d’études en 2024 en le plafonnant pendant deux ans. D’autant plus que pour plusieurs « étudiants », cette inscription autorise simplement l'entrée au Canada, ils n’y suivront pas d'éducation supérieure. Permettons aux premiers de rester et sélectionnons mieux les seconds !
Cela étant dit, le fond du problème n’est-il pas plutôt notre système économique global et son processus d’exploitation à tout-va, au détriment des pays du Sud bien souvent, pousse un paquet d’êtres humains à partir vers les Eldorados du Nord global… À l’heure d’un marché mondial officiellement gouverné par la loi de l’offre et de la demande et par la compétition sans pitié entre nations, n’est-ce pas normal ? Une fois ici, on s’attend à ce qu’ils remplissent les trous, que par magie ils résolvent l’équation mathématique de nos postes manquants… Un enjeu de santé (économique) national. Mais on confie dans le même temps aux entreprises privées la construction de logements qui devraient être massivement abordables ! Cherchez l’erreur : nos entrepreneurs ne sont pas des philanthropes, ou alors seulement lorsqu’ils sont établis et millionnaires ; ils construisent pour faire du profit. Alors, ils bâtissent plutôt des condos de luxe. À quand des politiques publiques ambitieuses et à la hauteur des enjeux humains, sociaux, culturels et économiques de l’immigration ?
Éditoriaux de décembre
COP 28: Un théâtre d’ombres

Depuis le 30 novembre, la « Conférence des parties » se réunit à Dubaï, aux Émirats arabes unis, pour sa 28e édition. 70 000 personnes ont convergé, surtout en avion, vers cette région emblématique de notre époque si consommatrice d’hydrocarbures. Le spectacle va durer jusqu’au 12 décembre. Vous me direz : C’est loin, en quoi cela nous concerne-t-il ?
Question pertinente au vu des résultats des COP précédentes : seule la COP 21 a débouché sur une déclaration forte, et encore, grâce à un rebondissement de dernière minute) : l’Accord de Paris, qui stipulait que les 196 pays signataires s’engageaient à limiter le réchauffement moyen de la planète à 2 degrés… Texte contraignant, mais sans aucune sanction pour les contrevenants. Résultat : les prévisions scientifiques se rapprochent aujourd’hui de 3 degrés avant la fin du siècle. La quantité de GES continue d’augmenter autour du globe, et le Canada des libéraux, qui a promis de les réduire de 40 % d’ici à 2030, en est rendu à 8 %. Moins 32 % en 7 ans, la pente va être raide ! On dirait bien pourtant que les scénaristes ne se sont pas trop creusé le cerveau… Ils nous resservent à chaque COP un peu la même histoire.
D’ailleurs, vous avez peut-être entendu les tirades de notre premier ministre depuis Dubaï. Ne vous laissez pas abuser : elles nous sont destinées, à nous, les Canadiens. En effet, aucune personne, aucun gouvernement moindrement informé à l’extérieur du Canada ne les prend au sérieux ni ne considère le Canada comme « leader » environnemental ; au contraire, nous sommes parmi les cinq pires acteurs de la troupe, c’est notoire. Donc Guilbault et sa clique, constituée de plusieurs lobbyistes des pétrolières, y vont davantage pour parader, jouer aux écologistes et gesticuler. Et cela à nos frais, bien sûr.
Un enjeu de la pièce qui joue et qui semble incontournable (pour qui d’ailleurs ? Il s’y trouve plus de représentants proénergies fossiles que d’environnementalistes) consiste dans ce que l’on appelle les « pertes et dommages », c’est-à-dire une indemnisation aux Pays du sud pour la pollution et les dégâts causés par le développement industriel des pays du Nord global depuis le XIXe siècle. Là, il se peut qu’un consensus se dégage, qu’il y ait une avancée, avec des engagements chiffrés qui seront être un jour vaguement respectés ; un fonds pour les dommages climatiques est officiellement créé. Si c’est le cas, cela risque d’être l’arbre qui cache la forêt, ou plutôt un os à ronger pour les écologistes de ce monde. En effet, quid de la promesse de se « sortir » des hydrocarbures, seul véritable levier pour réduire les GES à moyen terme, puisque leur production/transformation/consommation en constituent 80 % ?
Incroyable, mais vrai, l’un des personnages principaux de cette farce, le président de la COP, le climato-hypocrite sultan Ahmed Al-Jaber, a profité de l’occasion pour passer des contrats avec des pays d’Afrique en vue de leur fournir de l’équipement et des moyens de transport à bas prix qui fonctionnent à l’essence ! Il nomme cela le « pétrole durable ».
Rien à dire, si on y ajoute les subventions aux gros pollueurs pour la « transition énergétique » et la croyance naïve que la technologie peut aider à éviter le mur climatique, visiblement, il y a de l’argent à faire avec l’environnement! C’est la morale désolante de l’histoire.
La fin de l’état-providence

Vous direz peut-être que je mélange tout, que je fais des liens entre des choses sans rapport entre elles, et pourtant… Comment ne pas réagir aux conflits sociaux dans le système éducatif, de la santé ou dans les transports publics, au niveau québécois, ou avec la dévastation que connaissent les médias d’information au niveau pancanadien ?
Dans tous ces cas, la situation est catastrophique. Tous ces exemples sont des services à la population, ce que l’on pourrait également nommer le filet social. En effet, leur rôle est de rétablir l’équilibre, de maintenir une équité entre nous, les citoyens, afin que chacun-e ait accès à l’éducation, à la santé, à l’information ou à un moyen de transport.
En éducation, on manque d’enseignants, les jeunes ne veulent plus entrer dans cette profession que tous déclarent si importante — sauf pour le ministre Drainville, pour qui la priorité est la chasse aux profs « délinquants ». Mais si les piquets de grève du personnel scolaire sont soutenus par maints coups de klaxon, combien de parents poussent leur ado à débuter un travail rémunéré dés 14 ans ? Le salaire brut d’un enseignant en début de carrière est de 53 000 $ ; n’importe quel ti-cul ayant lâché l’école en secondaire peut s’improviser « spécialiste » en paysagement et gagner plus. La rémunération n’est pas tout, évidemment, on pourrait également aborder les conditions de travail, la charge mentale et physique, qui forcent les enseignants à des contorsions inimaginables. Et Legault ose parler d’augmenter leur « flexibilité » ?
En santé — encore un métier du don de soi au service des citoyens — la pénurie de personnel est chronique, conséquence 1) de coupures répétées dans les 30 dernières années par manque de vision stratégique, on savait qu’avec le papy-boom, les besoins seraient immenses 2) d’une doctrine néo-libérale aveugle aux besoins de la société au nom de l’équilibre budgétaire 3) d’un égoïsme patent des ordres médicaux incapables de lâcher le moindre sous au nom de la solidarité sociale. Les technocrates qui décident pourront toujours réorganiser, restructurer, moderniser, jouer aux chaises musicales, cela ne remplacera jamais un véritable service : nos hôpitaux sont vides de soignants, le premier ministre nous exhorte à ne plus nous rendre aux urgences et les gens qui le peuvent — comme moi — passent au privé en désespoir de cause.
Dans les transports publics, les caquistes ont daigné éponger le déficit des sociétés de transport municipales exceptionnellement. Bravo ! Dans une époque où posséder un véhicule coûte si cher, où l’aménagement urbain nous force souvent à prendre la voiture, seul un accès à un moyen de déplacement rapide, fréquent et quasi gratuit pourra ramener la population dans les transports en commun. Quelle honte y aurait-il à ce que cela soit intégralement subventionné ?
La rentabilité à tout prix dans les services essentiels est une hérésie. les coupes dans les médias traditionnels en sont un autre exemple. Pour commencer, pourquoi la radiotélévision publique qu’est Radio-Canada a-t-elle été forcée de se financer par la la publicité ? Maintenant que les entreprises se tournent vers les médias sociaux, les revenus de ce média public (et non d’état) sont en chute libre ! Mais quel genre de politique peut penser assurer l’avenir d’une démocratie en laissant l’information de ses citoyens au bon soin des Méta et des TikTok de ce monde ? Les forces obscures de l’ultralibéralisme sont à l’œuvre.
Lettre au Père Noël

Cher papa Noël,
C’est la première fois que je ne te demande pas de jouets. Papa et maman disent que j’ai gagné en maturité. Je n’ai peut-être simplement plus d’autre choix…
Quand je pense à un beau cadeau, je pense d’abord à une maison pour ma famille. On est en location, comme disent mes parents — je comprends juste qu’on n’est pas chez nous vraiment — et justement le proprio nous a dit de quitter l’an prochain. En fait, je crois qu’il a beaucoup augmenté l’argent qu’on lui donne chaque mois, alors mes parents ne peuvent plus vraiment le payer. Sauf en coupant dans nos dépenses. C’est pour ça que j’ai arrêté le hockey et le base-ball et que j’accompagne papa à la banque alimentaire. Ma grande sœur pleure, elle dit qu’elle n’aura plus sa chambre, et peut-être même plus de toit bientôt ! C’est rendu trop cher.
Ensuite, j’ai peur pour notre planète. Peux-tu faire que les gens qui nous gouvernent écoutent enfin la science, montrent leur courage, quitte à être un peu impopulaires, pour appliquer un vrai plan de lutte à la crise climatique ? Avec que des ministres qui prennent des décisions écologiques, en économie, en éducation, en santé, dans les transports, etc. J’aimerais qu’on arrête d’envoyer des équipes de sports loin sur les autres continents pour un match et qu’on prenne l’argent dans les poches des riches pour les mettre dans celles des pauvres !
Puis, j’en ai marre de voir de la publicité chaque cinq minutes à la télé, même sur Radio-Canada : est-ce que tu pourrais donner de l’argent à tous ces gens pour pas qu’ils n’aient plus besoin de ça ? Mes professeurs disent que c’est le système et qu’il n’y a pas d’argent pour les médias d’information, pourtant, quand j’ouvre mon Insta ou mon TikTok, j’en lis des nouvelles… Et tu pourrais m’aider à savoir à qui faire confiance pour apprendre les choses réelles qui se passent autour de moi? Et puis, j’aimerais faire de l’art plus tard, style guitariste ou DJ comme métier, mais est-ce qu’Elon Musk ou David Zuckerberg ont fait des études en art ? Ce sont les plus riches du monde, je voudrais aussi être comme eux !
Ah ! Oui, j’aimerais un train, enfin un tramway… en tout cas, arrêter de prendre la voiture le matin, le soir et tout le temps. J’ai le mal des transports et c’est long, avec tous les gens qui font comme nous en même temps. Pourquoi les hommes et les femmes politiques à la mairie, à l’Assemblée nationale et au Parlement du Canada, ne peuvent pas se mettre d’accord ? Est-ce qu’ils aiment le bruit, la pollution et perdre leur temps dans leur voiture ? En plus, je suis obligé d’aller loin pour jouer au soccer et au rugby — qui sont mes deux nouveaux sports favoris — est-ce que j’ai le droit de commander un terrain à l’intérieur pour ces jeux aussi, qu’on mettrait à côté des patinoires, dans le nouveau centre sportif ?
Surtout, n’oublie pas de passer à mon appartement s’il te plait! Il est petit, un peu caché, mais y a de la place en masse pour stationner ton traineau. En plus, il y a un biscuit maison et un grand verre de lait d’avoine qui t’attendent.
Didier, un admirateur qui veut vraiment croire en toi.
Manger, un enjeu d’éducation populaire (2)

Je reprends où j’en suis resté il y a quelques semaines, à l’automne, lorsque les banques alimentaires ont lancé un cri unanime : leur fréquentation avait grimpé en flèche dans l’année sans que leurs moyens aient augmenté proportionnellement, d’où une situation de crise sans précédent. Et l’hiver 2023-2024 promettait d’être pire. La situation ne s’est pas franchement améliorée. En effet, depuis, la grève dans les services publics a même forcé certains enseignant-e-s à faire appel à une banque alimentaire, la hausse des taux d’intérêt nous étrangle chaque mois un peu plus et le coût de la vie en général, sur les produits courants en particulier, dépasse l’augmentation des salaires. Certaines « popotes » dans notre région ont fini par revoir leurs services à la baisse par manque de financement.
Les solutions ? Forcer par la loi un plafonnement des prix dans l’alimentation ou le logement ? Quant à lui, le prix de l’essence reste relativement — et temporairement — bas, mais il ne redescendra jamais beaucoup plus que ce qu’il est à l’heure actuelle ; en fait, il ne peut que remonter… bref, faut-il plutôt allouer à tous les foyers au revenu faible ou moyen une enveloppe d’urgence, qui leur permette de joindre les deux bouts ? Subventionner les banques alimentaires ? Et si une partie de la solution se trouvait ailleurs ? Dans l’autonomie alimentaire, dans un système durable et solidaire.
La pratique existe déjà et à plus d’endroits qu’on ne croit, y compris en Outaouais. D’abord sur le plan de la production d’aliments santé, dans des fermes agricoles bovines ou maraichères, dans des fermes biologiques, sous serre ou pas. Plus de 400 producteurs promeuvent l’agrotourisme, l’autocueillette, tiennent un kiosque de vente à la ferme ou dans un marché local, ou contribuent à des « paniers bio ». Rendre tout cela plus accessible pourrait devenir une priorité gouvernementale, même si j’admets qu’en hiver, l’offre est nécessairement moins variée… Ensuite, sur le plan de la transformation des aliments : plus de 100 initiatives, communautaires ou dans le secteur commercial ou encore des cuisines collectives permettent à des centaines de personnes d’avoir accès à des plats préparés frais et de qualité. Pour finir, sur le plan de la distribution, ce sont là encore plus de 350 initiatives, principalement commerciales, qui offrent des aliments santé… pas toujours à prix abordables, malheureusement.
Cependant, dans ce domaine, se démarquent les marchés publics saisonniers, accessibles à tous, et surtout des services d’aide alimentaire tels que les frigos-partage ou les frigos antigaspi. Ainsi, l’Université du Québec en Outaouais en dispose grâce aux efforts répétés de Josée Poirier-Defoy, afin de permettre aux étudiants de se nourrir « santé » à peu de frais ! Des centaines de kilos de fruits et légumes sont ainsi utilisés pour fournir quotidiennement, sur les deux campus d’UQO, quantité de collations préparées par des étudiants bénévoles, parmi lesquelles plusieurs qui vont également dans les écoles primaires ! Le regroupement des cuisines collectives de Gatineau (RCCG), dont elle est la présidente, propose également des ateliers de formation afin que les gens apprennent à se cuisiner des plats et des collations à partir de produits locaux et moins transformés, promouvant par là même des habitudes alimentaires plus économiques, plus écologiques et plus saines pour la santé. Et dans le contexte actuel, c’est tout ce que je vous souhaite, chers lecteurs, pour l’année 2024 !
Éditoriaux de novembre
Manger, un enjeu d’éducation populaire (1)

Québécois-e sur 10. Quand vous vous déplacez dans la rue, au supermarché, dans une infrastructure sportive, une personne sur dix que vous croisez (en moyenne) a fait appel à une banque alimentaire pour manger ce jour-là. Moi qui me targue d’être plutôt au courant des choses, j’avoue que ce chiffre m’a estomaqué.
Ceci dit, constater que « la faim progresse », personnifier le phénomène par un habile procédé poétique, évite souvent de faire référence concrètement aux individus, aux êtres humains qui souffrent de la faim. C’est une sorte de déni. Notre société du XXIe siècle, moderne, développée, fonctionne de telle manière qu’au lieu de régler les inégalités, elle les accentue ; au moindre obus qui tombe en Europe de l’est, au moindre conflit qui met à risque « l’ordre mondial », à la moindre pandémie, la demande auprès de nos banques alimentaires explose. En un an, ce sont 30 % de personnes supplémentaires qui y ont eu recours ! +73 % depuis 2019 !
Aujourd’hui, on parle d’insécurité alimentaire, comme si c’était comparable à une simple insécurité physique ; il s’agit surtout d’un des besoins fondamentaux de tout être vivant, comme dormir. Et il s’agit en fait d’autre chose également : les pauvres paysans du XVIIIe siècle mangeaient peut-être mieux que beaucoup d’entre nous aujourd’hui. Pourquoi ? Parce qu’ils avaient l’au-to-no-mie alimentaire ; ils disposaient souvent de leur propre jardin, certes avec des fruits et légumes de saison, donc entrainant un régime plus ou moins équilibré selon les mois de l’année — mais enfin…
Alors, on parle de chaines d’approvisionnement rompues, de panier d’épicerie trop cher, de profits indus de la part des propriétaires des chaines de supermarché… Mais pourquoi faire venir un fruit ou un légume de l’autre bout du monde, alors qu’il pourrait être produit près de chez nous ? Pourquoi acheter à un fournisseur privé, qui cherche avant tout le profit, plutôt que de partager ce qui est fait localement dans une coopérative ? Pourquoi des heures et des heures à rester devant un écran pour une série plutôt que de prendre 1 h au potager communautaire du quartier ou à cuisiner nos propres plats ?
Cependant, nous pourrions aussi mettre cela sur le compte des caractéristiques de la région, de l’économie locale, provinciale, que sais-je. Or je suis certain que plusieurs de vos voisins, comme vous, ont un emploi ou sont à la retraite. C’est ça le pire : avoir un emploi ne suffit plus ! Dans l’ensemble du pays, et même sur d’autres continents, nous en sommes rendus là. Et comme dans beaucoup d’autres situations, tout à coup, on repense aux gouvernements comme des interlocuteurs valables. Est-ce si étrange ? La vie au naturel est injuste par définition et l’humain égoïste, c’est ce que les libertariens et les tenants du libre marché de tous poils oublie de dire. Les gouvernements sont justement là pour rééquilibrer la balance, pour que les petits ne soient pas mangés par les gros ou simplement mis à l’écart de la société des hommes.
Pour moi, une politique alimentaire digne de ce nom ne devrait pas laisser les gens dépendre des banques alimentaires ou des brigades antigaspi (et elles font un super boulot), mais devrait faciliter la création de coopératives alimentaires, financer les jardins potagers communautaires, en d’autres termes donner une plus grande autonomie à chacun-e d’entre nous.
« Waterloo, morne plaine… »

Parfois on se demande si une maison ou, disons un logement, ce n’est pas simplement ça pour certains : des murs et un toit fait de matériaux divers remplaçables à l’envi. Peut-être pire : juste un investissement à rentabiliser. Et ainsi va la vie d’un village, d’une ville ou d’une mégalopole. Pour ce qui est de notre coin de pays, j’ai depuis quelque temps une drôle d’impression… qui s’est vue confirmée récemment par l’annonce en rafale de trois abandons majeurs. Soyons plus clair.
Tous les matins, cinq fois par semaine, trente-cinq semaines par an, je prends la rue principale puis le chemin d’Aylmer pour me rendre au travail. Ce faisant, au fil des années, comme vous autres, j’ai assisté aux changements qui ont lieu à Aylmer. Loin de moi l’idée de tomber dans la nostalgie, mais quand on voit ce qui est remplacé et par quoi s’est remplacé, on est en droit de se poser des questions.
Et en fait, deux éléments me préoccupent. ils ont des causes différentes, mais ont les mêmes conséquences : ils laissent une impression de vide, de vacuité qui fait mal au cœur. D’une part, de belles et anciennes maisons unifamiliales, mais pas forcément décaties, attendent aujourd’hui que leurs nouveaux propriétaires les habitent… Ce qui n’arrivera jamais, parce que ce sont des promoteurs immobiliers qui préfèrent les laisser inhabitées et s’abîmer jusqu’à ce qu’elles ne soient plus habitables : ils pourront alors les détruire et leur substituer de beaux appartements de luxe avec une chambre loués 2800 $ le mois ! Le 485, puis le 674, et maintenant le 651 sur le chemin d’Aylmer font les frais de cette politique-là. En attendant d’être démolies, ces habitations ressemblent souvent à aux maisons hantées des films d’épouvante. Il est déplorable de voir le peu de cas fait au patrimoine bâti dans notre ville. Et en sus, il est vraiment pitoyable de ne pas voir davantage de logements abordables les remplacer quitte à les voir disparaitre.
D’autre part, dans le genre « ma ville se vide de sa substance », je suis franchement désolé d’assister à la disparition de commerces de restauration qui avaient pignon sur rue il n’y a pas si longtemps. Après l’Ambrosia, c’est au tour du 5e Baron d’arrêter sa brasserie, au British restaurant de fermer. Il est clair que la restauration a dû essuyer les plâtres de la fermeture plus ou moins complète pendant la CoVid-19 et aujourd’hui, elle fait face à l’augmentation des coûts de plusieurs produits qui lui sont nécessaires, en plus de difficulté dans l’approvisionnement ; les consommateurs coupent dans leurs dépenses et les sorties au resto ou dans les bars en font les frais. Il est également vrai que le British hôtel et café restent ouverts, ainsi que le 5e baron comme pub, ou que se trouve maintenant une énième boite à pizza dans les locaux de l’Ambrosia, mais enfin, il me semble que cela confirme une tendance. Ajoutez-y des stationnement aux trois-quarts vides qui, eux, pourrait être bâtis…
Ainsi que je l’annonçais en début d’éditorial, s’il s’agit de problématiques différentes, il n’en reste pas moins que leur effet sur notre moral est sensiblement le même : un sentiment doux-amer de fatalisme, de déception et de décrépitude nous envahit à la vision de notre paysage familier ainsi transformé.
Guerre et paix

Cette année est spéciale. Deux conflits armés semblent toucher plus particulièrement la population canadienne, bien qu’aucun soldat canadien n’y soit impliqué. Cela explique peut-être l’engouement des cérémonies du 11 novembre, samedi dernier, pour commémorer l’armistice de la Première Guerre mondiale, celle qui devait être « la guerre qui mettrait fin à toutes les guerres ». C’est toujours malheureusement comme ça : on part la fleur au canon et on revient dans un cercueil, sans que cela empêche d’autres conflits d’être déclenchés pour autant.
Depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui découla de la première, les soldats canadiens ont été impliqués dans maints conflits armés, de la Corée à l’Afghanistan, en passant par l’ex-Yougoslavie ou le Rwanda. Toutefois, dans ces derniers, ils étaient Casques bleus, au sein de forces de maintien de la paix de l’ONU, ce qui est bien différent.
Et évidemment, des affrontements, il y en a eu d’autres, dont certains en cours, comme celui entre Ukrainiens et Russes ou encore celui entre les Israéliens et le Hamas, sans parler de l’Afrique… Et vu ce qui continue de se passer tout autour de notre planète, des conséquences chez nous en termes de relations sociales (antisémitisme, islamophobie, haines et clivage), les guerres ne sont pas près de s’arrêter ! Au contraire, ainsi que le prouvent les études universitaires : notre époque se caractérise par moins de guerres à grande échelle, qui font plus de morts chez les militaires, et plus de guerres civiles, interethniques ou religieuses, qui font davantage de morts civiles.
Coïncidence imprévue dans ma classe de secondaire 4, nous finissons une unité de travail sur le thème du « regard horrifié » en tentant de répondre à la question : l’être humain peut-il coexister en paix avec son voisin ? Pour ce faire, nous avons étudié le roman autobiographique de Joseph Joffo, Un Sac de billes, qui raconte la fuite d’une famille juive et en particulier de ses deux plus jeunes garçons pour éviter la déportation et une mort quasi certaine, pendant la Deuxième Guerre mondiale. La question parait plus pertinente que jamais.
Justement, chez nos jeunes, les opinions sur la guerre en général, et surtout sur « nos » guerres à nous du Nord global, peuvent varier ; entre les cadets pétris de militarisme et de patriotisme, qui envisagent de s’engager ou de faire la réserve et respectent l’uniforme, et les universitaires formés aux sciences sociales, qui constatent que les guerres ont souvent été un moyen de conforter un certain colonialisme, voire que ces mêmes ingérences constituent les causes des conflits actuels, entre ces deux positions, il y a un monde.
Ce qui est certain, c’est que toute guerre est une défaite de la pensée, que si un conflit armé a lieu, chacun d’entre nous doit essayer de « raison garder », d'en comprendre les nuances. Par exemple, qu’Israël se bat contre une organisation terroriste dont l’objectif est de le détruire et l’a prouvé de la pire des manières ; que s’ériger contre le Hamas n’est pas anti-palestinien, encore moins faire preuve d’islamophobie ; ou que l’on peut souhaiter des corridors humanitaires et la remise en cause de la politique d’occupation illégale par les « colons » israéliens en Cisjordanie sans être antisémite. Malheureusement, l’être humain du XXIe siècle est toujours incapable d’éviter de se battre avec son voisin pour un bout de terre au nom de la paix.
Erratum-Je me suis trompé dans mon dernier éditorial: Le 5e baron continuera de brasser sa bière et tant mieux pour nous! Toutes mes excuses. Par contre, on peut ajouter un autre sinistre à notre Principale, L'Aubergiste, qui fermera ses portes fin décembre.
Didier Périès.
Les Cowboys fringants : un monument national
Hommage à Karl Tremblay

On ne prend conscience de la place que prennent certaines personnes que lorsqu’elles disparaissent. En juin 2022, j’avais écrit un éditorial après avoir vu en concert Les Cowboys fringants, lors de l’Outaouais en fête. Une fois de plus, j’avais été ébloui, transporté par l’énergie du groupe et la ferveur des spectateurs. La semaine dernière, le chanteur du groupe, Karl Tremblay, est mort ; il est fort possible que cela marque la fin du groupe. Ce qui n’enlève rien à ce qu’il représente dans le cœur des Québécois de plusieurs générations, c’est à dire leur groupe de musique le plus emblématique. Peut-être même le plus grand groupe de l’histoire du Québec… Et pour les nouveaux arrivants, que nous fûmes avec mon épouse et mes deux filles, en 2005 – sans conteste, un formidable accélérateur d’intégration linguistique, culturelle et sociale. En guise d’hommage posthume à Karl Tremblay, je vous livre à nouveau de larges extraits de ce texte, parce qu’ils illustrent plus que jamais mon opinion à propos des Cowboys fringants.
« […] Peu avant [le concert], l’un de mes amis, qui devait m’accompagner au parc des Cèdres, m’avait décrit comment le groupe québécois allait le chercher profondément avec ses mélodies entrainantes et ses textes puissants. […] Leurs mélodies, où les guitares le disputent aux percussions, aux cuivres ou aux vents et aux cordes (surtout au violon), nous restent longtemps en tête… Toutefois, dimanche soir, et bien que certains puissent me rétorquer qu’après tout il n’y avait que les supporters inconditionnels qui avaient fait le déplacement — ce dont je doute — ce que j’ai vécu allait au-delà de ça. Certes, ce sont de grands professionnels qui tournent au Québec, au Canada et partout dans la francophonie internationale depuis plus de vingt-cinq ans ; ils jouent très bien, en parfaite harmonie musicale à l’intérieur du groupe, ont un jeu de scène de fou, savent mettre le feu au parterre et enchainer les titres. Mais il y a plus.
Les paroles de leurs chansons sont vraies, elles touchent. Les jeunes, les moins jeunes, les plus vieux ; leur auditoire est intergénérationnel. Donc, pour reprendre la formule de mon ami, leurs paroles vont « chercher » le ou la Québécoise en faisant référence à des tranches de vie, à des éléments culturels (personnes, événements) typiques, dans un langage à la fois familier et poétique, avec un sens de la formule hors pair. […]
Ceci dit, est-ce que toutes leurs chansons sont compréhensibles par tous, même sans avoir vécu au Québec ? Peut-être pas toutes […] toutefois la plupart d’entre elles véhiculent un message universel, parce qu’elles abordent des expériences humaines fondamentales. C’est ça qui est également fort : comment aller chercher l’universel à travers l’anecdotique. Avec leurs dix-sept albums, les Cowboys fringants illustrent plus que jamais l’âme du Québec : un esprit festif, ouvert, bonhomme, un brin nostalgique, mais très lucide sur l’état de la société et farouchement indépendant. Une voix singulière dans une Amérique à la culture très états-unienne et anglo-saxonne, envahissante et uniforme. Comment ne pas se sentir un peu plus québécois après les avoir écoutés ? […] Merci Karl, Jean-François, Marie-Annick, Jérôme, Dominique et les autres, vous faites partie d’un patrimoine québécois bien vivant ! Et où que tu sois, Karl, tu rejoins la constellation des plus grands.
L’esprit des fêtes

Cet éditorial est un billet d’humeur sur l’air du temps. J’écris ces lignes le lendemain du « Vendredi fou » (notre folie de la surconsommation ?), alors que le marché de Noël commence à Aylmer. Il me semble que notre vie est plus que jamais déchirée entre des désirs contradictoires sur lesquels nous réfléchissons peu. Une manière de refuser de voir la situation en face ? Une fuite en avant ?
Parce que les faits sont là : un nombre grandissant de foyers au Canada s’appauvrissent ; notre niveau de vie connait un déclin sans précédent. Malgré des chiffres apparemment encourageants : notre pouvoir d’achat serait en hausse à l’échelle du pays, la belle affaire ! Ce n’est qu’une moyenne. Le fait est que de plus en plus de familles, y compris celles au-dessus du seuil de pauvreté (une majorité), font appel à des banques alimentaires ; les programmes d’assistance sociale ne peuvent plus compenser la hausse des prix dans les domaines cruciaux du budget d’un foyer que sont l’alimentation, le logement et le transport (un billet d’autobus à quasiment 5 $, n’importe quoi !).
Parallèlement, comment ne pas céder aux sirènes des soldes affolants proposés la semaine dernière ou qui le seront au lendemain de Noël ? Pour les commerçants, le calcul est simple et logique : une marge réduite sur chaque article, mais un plus grand nombre d’achats que d’habitude, cela augmente mécaniquement le chiffre d’affaires. Et les marchands qui nous gouvernent parlent de productivité et de de produit intérieur brut, comme si ces indices économiques pouvaient illustrer les conditions de vie réelles des gens, notre bonheur.
Dès lors, les solutions sont forcément plus de concurrence (dans un monde constitué de sociétés privées), de l’esprit entrepreneurial (dans un monde où chacun est idéalement sa propre entreprise), moins de secteur public (dans un monde du « chacun pour soi et dieu pour tous »), davantage de technologies (qui nous remplacent et épuisent nos ressources naturelles), moins de « barrières » entre les régions, les provinces, les pays, etc. Oups ! Mais il y a une crise du logement, et à qui demande-t-on de payer ? Aux mêmes gouvernements qui seraient trop gros, trop dépensiers. Idem en santé et en éducation ou quand les banques font faillite… ou quand une grande firme désire s’installer à peu de frais chez nous. Faudrait savoir à la fin ! Nos « world companies » nous demandent à la fois d’accepter que les salaires n’augmentent pas au même rythme que et voudraient bien que nous continuions de consommer plus pour « soutenir une croissance » chaque année plus importante.
Toujours au chapitre « il n’y a plus d’argent, mais il y en a pour certains », on nous culpabilise sur notre empreinte carbone, mais nos équipes de sport voyagent pour des destinations hors de toute logique : des matchs de la NHL en Scandinavie ? D’autres matchs de la NFL en Allemagne et en Angleterre ? Ce n’est pas un peu n’importe quoi ? Pas plus qu’un match à domicile des Kings de Los Angeles à Québec, me direz-vous ; nous ne sommes pas à quelques tonnes de CO2 supplémentaires ou à sept millions de dollars près. D’ailleurs, Justin Trudeau ne part-il pas dans quelques jours pour une COP 28 présidée par le représentant d’un des plus grands pollueurs de la planète. Vu le résultat prévisible, il pourrait tout aussi bien faire ça sur Zoom !
Éditoriaux d'octobre
Améliorez le PubliSac, ne l'interdisez pas

Les "sacs publicitaires" sont l'enfant de l'affiche pour un marketing irresponsable. Les municipalités subissent des pressions pour interdire les sacs afin de réduire les déchets. À Aylmer, les sacs publicitaires sont trop utiles pour qu'on s'en débarrasse. Pourquoi démanteler un système qui fonctionne, alors que de simples améliorations peuvent faire une grande différence.
Le problème du sac, c'est que certains dépliants sont impossibles à recycler ou à réutiliser s'ils sont brillants. Le sac lui-même est en plastique, et donc difficile à recycler. Un autre problème est le désordre qui se produit dans les entrées des immeubles d'habitation lorsque les sacs publicitaires s'empilent de manière désordonnée.
Le Bulletin a demandé à ses lecteurs de réutiliser - et non de recycler - tout le papier journal qu'ils reçoivent à la maison. Réutiliser le papier journal pour emballer le compost, pour le paillis de jardin ou pour allumer des feux est bien plus respectueux de l'environnement que le jeter dans le bac bleu. Le contenu du bac bleu est trié et envoyé dans différents pays pour un traitement final. Certains déchets recyclables sont vendus sur un marché (comme le papier journal), mais certains sont traités comme des déchets sans seconde vie. Tout cela constitue une dépense pour nos villes (lire : les contribuables), à laquelle s'ajoute le Québec (qui rembourse aux villes une partie du déficit de recyclage). La ville de Québec exige alors des producteurs de papier, comme ce journal, ou des entreprises qui exploitent des circulaires, qu'ils versent au gouvernement du Québec un taux fixe sur tout le papier journal qui sort d'une imprimerie. Ainsi, la démarche écologique des villes et des provinces consisterait simplement à exiger que toutes les circulaires soient facilement compostables, tout comme le papier journal.
Il y a longtemps qu'un arbre n'a pas été abattu pour fabriquer du papier journal, si c'est un problème pour les lecteurs concernés. Le papier journal est fabriqué à partir de sous-produits de l'industrie du bois, ce qui réduit en fait les déchets au Québec ! Et l'encre des journaux est à base végétale, là encore moins nocive pour l'environnement que les produits chimiques utilisés dans les décennies passées. Les sacs eux-mêmes pourraient être à base de végétaux, plutôt qu'en plastique, et pour ce qui est des entrées en désordre, eh bien une solution commence à la maison.
En Outaouais, à Aylmer, les gens cherchent plus à lire, pas moins. Autour du bureau du Bulletin, on peut voir des gens qui lisent des dépliants de l'avant à l'arrière ! Ils ne cherchent pas seulement des coupons ou des offres spéciales. Ils passent du temps à lire quelque chose de nouveau. Avec les journaux à l'intérieur, le PubliSac est davantage utilisé pour la diffusion de l'information.
Sachant que de nombreuses personnes souhaitent lire davantage, mais n'ont pas l'habitude - ou les moyens - d'acheter plus de magazines, de livres et de journaux, promouvoir l'interdiction des sacs publicitaires frise l'élitisme.
Que diriez-vous de consacrer vos efforts à l'interdiction des sacs publicitaires à leur amélioration - et à la croissance du Bulletin ! -- en ajoutant du contenu aux sacs publicitaires ?
(Traduction)
Lily Ryan
Faites-nous confiance, qu’ils disaient…

On ne pense pas toujours au contenu de nos assiettes, ou en tout cas pas en termes de qualité, surtout lorsque notre budget ne nous le permet pas. C’est malheureusement encore trop le privilège des riches de manger « bio » (je sais, l’assertion est discutable, nous aurons l’occasion d’en reparler).
Par exemple, les organismes génétiquement modifiés (OGM). Ils sont utilisés dans la recherche fondamentale pour mieux comprendre certains mécanismes biologiques, dans l’industrie pour produire certaines molécules d’intérêt ou en santé pour produire des vaccins ou des médicaments comme l’insuline, ou comme vecteur pour des thérapies géniques. Mais surtout, c’est dans le domaine agricole qu’on en retrouve. Notre panier alimentaire en est rempli, sans que l’on s’en soucie, en particulier parce que nous n’avons pas été éduqués sur la question pendant notre scolarité. Cependant la question mérite d’être approfondie.
Pour faire bref, ce sont des animaux, végétaux ou bactéries) auxquels on ajoute ou enlève des gènes par des techniques de génie génétique, dans des laboratoires, afin de leur conférer de nouvelles caractéristiques. Particularité : la transgénèse peut être réalisée à partir d’espèces différentes. Et oui, vous avez bien lu, ce qui est impossible dans la Nature, nous, les humains, n’hésitons pas à le faire ! Mieux, il existe de nouvelles techniques de sélection (NBT) qui ne nécessitent même pas l’ajout d’un nouveau gène et qui n’impliquent pas de transgénèse dans l’organisme final, mais à certaines étapes de la modification… Bref, vache sans corne, pomme qui ne brunit pas, poule immunisée à la grippe aviaire, tout est possible. La science admet qu’ils impliquent des risques environnementaux significatifs.
Depuis longtemps en Europe, la production (mais pas l’importation) des OGM, y compris avec les NBT, est interdite sauf pour le maïs MON819 qui a permis de faire pousser ce maïs doté d’un nouveau gène provenant d’une bactérie qui crée une molécule insecticide. Pour permettre d’améliorer le rendement, me direz-vous, c’est donc pour le mieux. À première vue, oui. Cependant, qu’il s’agisse des plantes transgéniques que nous ingérons directement ou des animaux modifiés, comme le saumon au Canada, rien ne prouve que ces OGM ne provoquent rien sur notre corps, à court, moyen ou long terme… Et le principe de précaution ? En effet, comment ne pas imaginer qu’introduire un OGM ne présente un risque pour nous ? Ils sont inconnus à notre physiologie et contiennent des traits dont on ne connait pas les effets sur leur environnement, comme les transformer en plantes invasives et déséquilibrer tout un écosystème !
Alors, les gouvernements préconisent une « surveillance à long terme », de « poursuivre les évaluations sanitaires », etc. Ou pire. Ainsi, non seulement le Canada est l’un des cinq plus gros producteurs mondiaux d’OGM, mais il travaille main dans la main avec le lobby de l’agrochimie Croplife, qui représente des compagnies comme Bayer. Une enquête de Radio-Canada vient de mettre à jour qu’une certaine « Tiger team » a été constituée par le gouvernement libéral afin de préparer une réforme sur les OGM qui n’oblige plus à déclarer la présence d’OGM, tout simplement. Bon consulter les différentes parties en présence — chercheurs, consommateurs, producteurs — d’accord, mais demander du conseil à ces derniers et élaborer des stratégies de communication avec eux sans que personne n’en sache rien ? C’est au mieux une collusion toxique au mépris des citoyens et au pire une corruption inacceptable !
7 milliards de dollars de deniers publics, un investissement?

Vous ne voyez pas de changement dans votre vie quotidienne, alors que vous payez vos impôts comme tout le monde ? Attendez de voir les retombées de la dernière frasque de nos deux paliers de gouvernement — provincial et fédéral — pour une fois, main dans la main… Déjà une formulation laudative claironnée partout : « Un investissement record ! ». Là, on devrait être admiratif. Ensuite l’argument économique massue, toujours le même : oui c’est de l’argent public, mais la construction puis le fonctionnement de l’usine de Northvolt à McMasterville, en Montérégie, va rapporter gros… plus tard ! Et puis, on devient des leaders écologiques en produisant des batteries électriques lithium-ion, ici, chez nous. Cependant, plusieurs questions me viennent à l’esprit.
Qui est Northvolt ? Une très (trop) jeune entreprise suédoise fondée par deux anciens de Tesla en 2016. Avec le même état d’esprit certes novateur et visionnaire, mais aussi libertarien et irresponsable socialement que Elon Musk, dont l’entreprise ne paye aucun impôt? Leur credo : concurrencer les Chinois et les Coréens en produisant des batteries, grâce à une énergie peu chère et « verte » (l’hydroélectricité), tout en automatisant le processus et en faisant des économies d’échelle. Pour leur première usine en Suède ouverte en 2021, ils ont pour partenaires financiers Volkswagen, Ikea, BMW, Goldman Sachs… et l’état suédois, entre autres ! Leurs commandes se chiffrent d’ores et déjà en dizaines de milliards… mais les bénéfices ? En 2030 ? 2031 ?
Comment vous, moi, la société québécoise, allons-nous y gagner ? Ah, mais oui, nous allons pouvoir acheter des véhicules électriques disposant de batteries construites avec notre argent ! Si j’étais un entrepreneur, je serais à 100 % pour ce genre de montage financier : investissement public, bénéfice privé, c’est parfait. Parce qu’effectivement, ni l’état québécois ni nous serons jamais propriétaires de Northvolt. Et puis, cela créerait 3000 emplois. OK, c’est positif, mais vous remarquerez le conditionnel : nous sommes en période de pénurie de travailleurs, non ? En plus, le gouvernement mettra près d’une décennie à récupérer ses billes. Et, en vérité, il aurait investi cet argent dans l’éducation, les transports publics (un tramway ?) ou la santé, les retombées eussent été aussi importantes…
Tout cela est-il véritablement écologique ? À première vue, oui, si l’on croit que plus de voitures sur les routes et en conduite solo, c’est une solution à la crise climatique. Toutefois, 1) la construction de l’usine va se faire au détriment des 70 hectares de terre agricole et de milieu humide, 2) son fonctionnement va produire des GES et utiliser l’eau douce de la rivière Richelieu… Et comme par hasard, le gouvernement caquiste a changé la législation en février dernier et évite ainsi à la multinationale de subir l’examen du BAPE. Donc, on consulte les citoyens une fois le projet avalisé, mais pas d’évaluation environnementale! D’un point de vue écologique, la solution est de rapprocher le travail et les services du domicile des travailleurs, pas d’augmenter le trafic et créer de nouvelles banlieues-dortoirs. D’autant plus, que les voitures sont de plus en plus en grosses, et les produire pollue toujours !
Ces 3000 dollars de subventions publiques que vaudra chaque batterie de Northvolt, et qui ont été lâchés sous la menace de s’installer ailleurs, je les appelle plutôt une dépense largement discutable. On s’en est fait passer une petite vite !
Combattre l’anxiété par l’action

Je ne sais pas. Parfois, je doute. Nous nous voyons offrir des opportunités de changer (un peu) les choses, d’améliorer la vie de nos enfants, et non, on reste à la maison. Beaucoup préfèrent ne pas bouger du nid douillet auquel ils consacrent tant de temps (construction, extension, rénovation, etc.). Rester chez soi, rester sur son « quant à soi » est toujours plus confortable, physiquement tout au moins : pas de fatigue, pas de risque de blessure (quoique…), pas de rencontres potentiellement désagréables. Mieux vaut rester au chaud qu’avoir froid, n’est-ce pas ? Pourquoi pas ?
Justement, pourquoi pas ? Eh bien pour commencer, parce qu’un être humain ne peut pas vivre uniquement dans sa bulle, ce n’est pas dans notre nature : nous sommes des animaux sociaux par essence. D’abord, c’est par la rencontre que nous développons notre capacité à interagir avec notre environnement végétal, animal, humain. Nous apprenons également davantage en nous exposant à l’inconnu qu’au connu. Ce n’est ni surprenant ni nouveau d’ailleurs, autant le bon sens que la science se rejoignent à ce sujet. Sinon, la pensée tourne en rond, l’humain stagne, rumine et le beau cocon que l’on s’est bâti devient une prison, voire un cercueil.
Alors, l’angoisse et la déprime peuvent déployer leur étendard sur nos têtes courbées. Aujourd’hui, on parle plutôt d’anxiété devant cet avenir qui semble sombre ; sombre notamment parce qu’en plus du regain des nationalismes et des extrémismes, d’une croissance des inégalités sociales, de la multiplication des conflits armés et des perspectives économiques peu reluisantes, l’Humanité fait face à l’une des pires crises de son histoire, qui menace jusqu’à son existence même. La crise climatique.
Et franchement, il y a de quoi être anxieux, nier la nécessité de changer de comportement, de valeurs ou de paradigme, s’enfermer chez soi pour regarder des séries ou de la télé-réalité. C’est « cultiver son jardin », ainsi que le préconise Candide dans le roman éponyme de Voltaire. Mais attention, si cette formule est une métaphore, on parle plutôt ici de s’occuper de ce qui nous est propre, de ce qui nous fait plus grands que nature en tant qu’espèce, de notre humanité. Et cette dernière repose principalement sur notre capacité à nous regrouper pour de grandes causes, à faire preuve d’ouverture, de compassion et d’ingéniosité, avant d’agir. Agir pour de bon sur notre environnement, dans un sens positif. Seule l’action sauvera notre jeunesse et nous sauvera de cette fameuse écoanxiété nous fuyons tous à un degré ou à un autre encore trop souvent.
L’action comme remède à la grande maladie de notre siècle. Pourquoi ? Parce que s’impliquer, s’engager, en ignorant la tonne d’information déprimante qui nous assaille quotidienne, permet de reprendre un certain pouvoir sur la situation, même à petite échelle. Cela réduit le stress. Beaucoup de scientifiques, de chercheurs dans les universités, de militants écologistes sont en paix avec eux-mêmes, parce qu’ils font quelque chose! De la réduction des GES à l’autonomie alimentaire, de la protection des espèces et des territoires à l’invention de nouveaux matériaux, du recyclage au covoiturage jusqu’à la décarbonation, chacun d’entre nous peut encore faire plus que sa part… Mais pour cela, il faut sortir de chez soi, sortir de sa zone de confort maintenant pour de meilleurs lendemains. Il est urgent de passer à l’action. C’est mon pari sur l’avenir.
Kill who ?

Dans la foulée de la loi 96, encore fortement discutée par nos compatriotes anglophones, et ses conséquences, apparait aujourd’hui une nouvelle pomme de discorde. Avant d’en parler, je tiens à rappeler qu’en principe, enlever aux uns et penser que mécaniquement les autres en bénéficieront parait séduisant, mais s’avère généralement naïf ou simpliste.
La nouvelle ? Le gouvernement caquiste a annoncé la semaine dernière une nouvelle mesure concernant les frais d’inscription dans les universités anglophones pour les résidents hors Québec. Ce que décrient rageusement ROC et les Anglo-Québécois est le fait que Les droits de scolarité, progressivement dérèglementés ces dernières années (notamment ceux des étudiants internationaux), vont désormais être intégralement payés par les étudiants eux-mêmes. Pour être plus précis, les candidats qui viennent d’autres provinces ou de l’étranger, paieront ce que coûte effectivement leur formation, soit le double du montant actuel, par exemple et respectivement, près de 17 000 $ et 20 000 $ par année à l’Université Concordia. Par ailleurs, le gouvernement compte augmenter la part qu’il prélève sur ce revenu, afin, clame-t-il, de la reverser au réseau universitaire francophone.
Quelques précisions cependant. D’abord, un prix plancher sera effectivement imposé aux étudiants étrangers (sauf les Français, les Belges ou d’autres ayant des ententes bilatérales), les universités pourront facturer davantage à leur discrétion. Ensuite, cela seuls les nouveaux inscrits à la rentrée de septembre 2024 sont touchés, y compris les nouveaux inscrits en deuxième cycle, quand il n’y a pas de mémoire à écrire. Enfin et surtout, les frais n’augmenteront pas pour ceux qui s’inscrivent dans une institution francophone.
On a entendu des défenseurs de l’argument économique (Valérie Plante, mairesse de Montréal et plusieurs groupes de pression anglophones), ils ne tiennent pas : un peu moins de 5 % des étudiants au Québec viennent du reste du Canada et 16 % de l’étranger, et ces revenus issus des droits de scolarité constituent plus de 40 % du revenu total seulement pour les universités anglophones ! La mesure les poussera vers Toronto ou Vancouver ? Eh bien, ils verront par eux-mêmes combien coûte le logement là-bas ! Même avec des droits de scolarité clairement plus élevés, le Québec et Montréal restent encore très concurrentiels, tous frais inclus.
De plus, il est bien établi que ces institutions constituent une porte d’entrée pour de futurs Canadiens unilingues qui repartent dans d'autres provinces, ou restent, mais sans apprendre le français ; il en va de même des étudiants ontariens, qui forment le gros des troupes : aussitôt leur diplôme en poche, ils reviennent en Ontario tout en contribuant à l’anglicisation de Montréal pendant leurs études. En période de pénurie de personnel, particulièrement dans la santé, je suis vraiment content que mes impôts forment des médecins qui partent exercer ailleurs !
Quant à Legault, il espère faire coup double, probablement par calcul politique : il dame le pion sur la défense du français à un Parti québécois montant et va chercher quelques millions de dollars supplémentaires. Même si c’est le cas, mais là n’est pas le problème… L’enjeu est plutôt le désengagement de l’état dans la formation postsecondaire ; c’est en sens inverse qu’il faudrait aller, afin de rendre l’éducation supérieure plus accessible ! En revanche, couper dans le budget des cours de français à McGill est franchement une mesure de rétorsion mesquine : comme si McGill se préoccupait de toute façon du français !
Éditoriaux de septembre
L’école du futur

Je m’en allais gaiement vers un éditorial plus environnemental, parce qu’après l’été que nous venons de passer au Canada, il y a des raisons d’en parler… et d’agir. Mais nous y reviendrons. En effet, j’ai été coupé dans mon élan par une actualité toute chaude, pas seulement la rentrée scolaire en général, mais ma rentrée scolaire dans mon école.
Dans mon école, on se targue d’être à la fine pointe de l’éducation, d’en suivre — voire d’anticiper — les dernières tendances. Vendus au tout technologique, nos élèves ont en classe non seulement leur téléphone, mais également un ordinateur et une tablette, cette dernière étant fournie les premiers jours d'école. Nous jonglons avec les applications, slalomons entre TikTok et Instagram, surfons sur les différentes plateformes existantes… Nos élèves sont-ils plus intelligents, plus savants qu’ailleurs ? En tout cas, ils savent exploiter les facilités qu’offrent les outils numériques et l’internet à leur avantage.
Dans mon école, on promeut l’initiation aux affaires, à l’économie, à la comptabilité dès le secondaire 3 et aux technologies autant que faire se peut, comme clefs de la réussite scolaire, professionnelle et existentielle. La route est toute tracée vers un gros salaire, des postes exécutifs et la promotion sociale. Les langues, les arts et les sciences sociales, à quoi ça sert ? Nos anciens élèves sont-ils plus heureux qu’ailleurs ? En tout cas, ils savent trouver les voies rapides pour gagner beaucoup sans être trop intelligents ni forcément des citoyens responsables.
Dans mon école, on applaudit à l’arrimage entre éducation supérieure et monde de l’industrie, car tout est industrie, des arts au droit, en passant par la santé ou l’éducation… Les étudiants doivent pouvoir répondre à la demande des entreprises par des formations adéquates et remplir les postes de spécialistes de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage, d’experts, de la soutenabilité, d’analystes en intelligence des affaires ou en sécurité de l’information, d’ingénieurs en technologie financière. Ces mots vous sont étrangers ? Normal, ce sont des professions émergentes. Nos élèves ont-ils plus d’esprit critique ou sont-ils de plus grands penseurs qu’ailleurs ? En tout cas, ils savent se faire ouvrir les portes des meilleures formations universitaires canadiennes en s’arrogeant les meilleures bourses au passage.
Parce que voyez-vous, dans mon monde (éducatif), les individus sont en concurrence les uns avec les autres, ils doivent se bâtir un CV qui leur donne un avantage compétitif, ils développent leurs compétences d’analyse, d’adaptation, de communication, de créativité, de contrôle qualité et de leadership plutôt que leurs connaissances et leur capacité de raisonnement ou leur altruisme. Car rien n’est gratuit en ce bas monde, le bonheur est forcément proportionnel à la taille de notre compte en banque et seuls les meilleurs arrivent en haut de l’échelle sociale.
Pour ces gens-là, au diable l’éducation à la citoyenneté, la responsabilité sociale ou l’invention d’un monde plus juste et solidaire ; la panacée est de pouvoir mettre ses compétences transversales au service de l’entreprise, de sa propre entreprise ! À l’image du monde de demain, l’école de demain ne peut être que globale, entrepreneuriale, toujours dans l’ « innovation » pédagogique pour n’être finalement que des usines à reproduire une structure sociale inégalitaire. Une école pleine de jeunes « compétents », mais ignorants, ouverts à la diversité, mais égoïstes, censés penser « en dehors de la boîte », mais sans véritable désir de changer le monde.
Le coup de la vie

Le mois de septembre est certainement plus dur cette année pour les familles qu’il ne l’a été depuis longtemps, y compris pendant la CoVid-19, où le gouvernement du Canada a mis en place un filet social à coup d’allocations, ce que personne — y compris nos hypocrites conservateurs — ne peut aujourd’hui lui reprocher. Cette fin d’année 2023 réunit trois conditions économiques et financières qui rendent la vie vraiment difficile, en particulier pour les petits et moyens revenus. En effet, la hausse du prix du logement, l’inflation des produits de base et le retour à des taux d’intérêt élevés constituent trois facteurs qui font mal au portefeuille des contribuables les plus démunis.
D’abord, il faut comprendre que la crise du logement est celle du logement abordable ; les riches disposent toujours des ressources pour louer ou acheter. Et si certains peuvent arguer que le prix des propriétés a diminué en 2023 (il s’établit quand même encore à 470 000 dollars après plusieurs années de hausse), le loyer moyen d’un appartement d’une chambre a, quant à lui, augmenté de 13 % pour atteindre 1687 dollars ! Et c’est pire dans les villes. À l’heure actuelle, le seul organisme régulateur du marché de l’immobilier est le Tribunal administratif du logement (TAL), qui ne peut que suggérer une augmentation pour l’année 2023 (2,3 % pour un logement non chauffé et 2,8 % pour un logement chauffé à l’électricité, on est donc très loin du compte). Pourquoi le gouvernement ne limite-t-il pas cette hausse par une loi ?
Par ailleurs, les prix de l’épicerie ont augmenté drastiquement depuis le début du conflit avec l’Ukraine, pour des raisons de pression sur les chaines d’approvisionnement (énergie, céréales), ajoutée au ralentissement des échanges commerciaux découlant de la crise sanitaire des années précédentes. Problème : cela touche spécifiquement des produits alimentaires de base, alors que le pouvoir d’achat des classes les plus aisées les rend encore capables d’acheter des produits variés et de qualité. Légumes, produits laitiers, viande, fruits, tout y passe, le panier d’épicerie a déjà cru de plus de plus de 1000 dollars entre 2022 et 2023, qu’est-ce qui nous attend en 2024 ? Or, les trois gros détaillants qui se partagent 70 % du marché (Loblaws/Provigo, Sobeys/IGA et Métro) ont engrangé des profits record (en augmentation de 10% à 30%) dans la même période ! Les coûts des « intrants » ont bon dos !
Enfin, l’hypothèque de nos maisons ou appartements a grimpé de manière exponentielle, parce que le taux directeur de la Banque du Canada est passé de 0,25 % à 5 % en l’espace d’un an et demi, OK ! Il ne viendrait certainement pas l’idée aux banques de de réduire un peu leur marge de profit au lieu de nous refiler la facture ? Qui les a aidées à se redresser après la crise financière de 2008 sinon le gouvernement ? Le privé ne jure que par la loi du marché et la « libre » concurrence quand il s’agit de faire de l’argent, mais l’intervention de l’état avec nos impôts, ça ne le dérange pas en cas de problème. La morale de l’histoire ? Ce sont toujours les mêmes qui doivent encaisser les coups, que ces derniers soient politiques, économiques ou sociaux. Comment se donner une chance de changer la situation ? Certainement pas avec un chèque de 500 dollars une fois l’année.
Pensée carrée, pensée binaire

Vendredi dernier a eu lieu la traditionnelle Marche pour le climat de fin septembre, la même qui avait vu Greta Thunberg y participer en 2019, à Montréal et qui avait connu une mobilisation record à Ottawa. Dans le même temps, le premier ministre Trudeau a connu une réunion mouvementée de son caucus, en cette rentrée parlementaire. Il est critiqué, probablement victime de l’usure du pouvoir, mais pas seulement : à force de promettre à chacun ce qu’il veut entendre et de n’entreprendre aucune réforme majeure, tout en préservant les relations avec le NPD, il parait juste ne pas avoir de colonne vertébrale. Et même si la question du logement est sur toutes les lèvres en ce moment et que le gouvernement libéral, sous la pression des provinces, dont le Québec, tente de reprendre la main en annonçant une exemption de TPS sur les matériaux et la main-d’œuvre pour la construction de logements locatifs, on passe à côté du grand enjeu de notre époque: la crise climatique en cours et ses conséquences dans tous les aspects de notre existence.
Les conservateurs, quant à eux, mènent par 14-15 points dans les sondages. Ils sortent de leur congrès annuel plus motivés que jamais… À part qu’ils n’ont pas de programme autre que de critiquer la gouvernance libérale et mener des attaques ad hominem. Le discours de Poilièvre est d’une affligeante pauvreté. Sérieusement, avoir pour principe politique le « bon sens », peut-on imaginer plus populiste et justement dénué de sens ? Par contre, soutenir le blocage à Ottawa ; enlever à la banque du Canada tout pouvoir ; développer, encore plus que le parti libéral, la production pétrolière ; abolir Radio-Canada et CBC ; remettre en cause l’avortement, les avancées sur la question du genre, voilà à quoi mène le « bon sens » du chef conservateur !
Or je constate avec stupeur que les électeurs canadiens sont incapables de penser autrement que de manière binaire : on est tanné des libéraux, alors votons conservateur ; quand on sera tanné des conservateurs, on votera libéral. Enfin ! pas plus que la réalité est seulement noire ou blanche, le spectre politique ne se résume à ces deux partis qui ont gouverné le Canada depuis 150 ans. Quid du NPD et du Parti vert du Canada ? Pourquoi ne pas envisager les autres alternatives existantes ? Pourquoi ne pas leur donner leur chance dans la mesure où PCC et PLC ont montré leur incurie à opérer les changements nécessaires pour affronter la crise climatique et les injustices socio-économiques grandissantes ? Pour peu que l’on comprenne que donner la balance du pouvoir, c’est donner le pouvoir! Chaque vote compte ! Et cela ne prend que quelques députés de plus au parti vert ou au NPD pour l’avoir, ce pouvoir qui permet d’influer sur les politiques du parti qui gagnera les élections.
Alors, qu’est-ce qui cloche ? La fameuse « tradition britannique », que tant de Canadiens — et au fond monarchistes — défendent pour sa stabilité (que d’autres pourraient plutôt appeler de la rigidité), ce cadre de pensée nous empêche d’avancer sur la voie d’une pleine démocratie qui favorise vraiment le multipartisme et donc réponde mieux aux sensibilités des électeurs.
Qu’attendons-nous nous donc pour nous affranchir de ce cadre simpliste et binaire, penser la politique d’une manière plus ronde, plus nuancée et exprimer un véritable vote stratégique ?
Vous avez dit « écoblanchiment »?

La version française du néologisme récent « greenwashing » m’apparait plus qu’approprié quand je regarde en arrière les évènements de la semaine dernière, à l’occasion du Sommet sur l’ambition climatique, organisé et tenu par l’ONU à New York. Antidote le définit comme suit : « procédé de marketing (mise en marché) visant à donner d’une organisation une image de marque écoresponsable éloignée de la réalité ».
D’abord on voit mal dans les gesticulations internationales de nos premiers ministres la cohérence et le leadership dont ils se réclament, ils sont finalement comme nous : ils admettent l’existence du réchauffement climatique, mais en le minimisant pour mieux se défausser et en gonflant leurs actions, histoire de donner l’image qu’ils font vraiment quelque chose. D’ailleurs son commis, Steven Guilbeault, en est le parfait exemple, lui, l’ancien militant environnemental de Greenpeace, agit comme un enfant qui voudrait éviter d’admettre sa responsabilité dans une faute qu’il a commise en faisant diversion, en accusant son ami. Procédé certes naturel, mais pitoyable, déjà pour un enfant.
« C’est pas moi, c’est les conservateurs d’Harper ! ». Mais bien sûr que c’est à cause d’eux — et depuis eux — que tout va mal ! Piètre excuse des libéraux, qui ont perdu toute intégrité morale et sont déjà en campagne électorale ! C’est une insulte au sujet grave dont il est question et aussi aux citoyens, qui méritent mieux que ça. Encore faut-il avoir un bilan à défendre ; d’où leur empressement à « faire » des choses subitement, alors qu’ils sont au pouvoir depuis 2015 et, en fait, ont gouverné pendant les trois quarts du dernier siècle.
Vous voulez des exemples ? La plantation du 2 milliards d’arbres en dix ans, promise par Trudeau ; un programme lancé en 2020, et bien maintenant, on y inclut tous les arbres de tous les autres programmes fédéraux! Petit stratagème pour gonfler un bilan peu reluisant. Autre sujet : la fin des subventions « inefficaces » à l’industrie pétrolière et gazière ; sachez que selon elles, qui savent depuis le début des années 1970 que nous allons droit dans le mur climatique, la majorité de ces sommes sont « efficaces » ! Parfaitement, elles pourront extraire du pétrole plus proprement et développer une technologie pour enfouir les gaz empoisonnés que produisent sa transformation et sa combustion. Super solution durable... Le temps d’un ou deux mandats électoraux, qu’ils soient libéraux ou conservateurs! Allez, un petit dernier pour la route? Une nouvelle promesse libérale : le projet de règlement final sur le plafonnement des gaz à effet de serre (un peu comme l’ébauche du brouillon de projet, etc.) arrivera pour Noël, afin d’être mis en application… Oh, juste avant les élections de l’automne 2024, mais rien d’électoraliste là-dedans! D’ailleurs, nos chantres de la transition écologique, messieurs Wilkinson et Guilbeault, murmurent dans un souffle que l’environnement reste quand même de compétence provinciale, une belle manière de se dédouaner à nouveau, au cas où...
À l’instar du gouvernement caquiste qui profite de l’héritage hydroélectrique laissé par d’autres que lui et des ressources naturelles, qu’il contribue plus souvent qu’à son tour à gruger, les libéraux s’agitent pitoyablement pour faire croire à leur leadership climatique. Sont-ce nous qu’ils croient tromper (pour mieux se vendre), la communauté internationale (pour mieux paraitre) ou bien tentent-ils de se convaincre eux-mêmes, une manière de ne pas assumer leur responsabilité historique ?
Éditoriaux d'août
Qui sont les Québécois ? Qui sont les Canadiens ?

Ah ! Enfin une bonne nouvelle… si l’on y réfléchit bien ! Vous avez entendu parler de la loi C-18 du gouvernement Trudeau ? Elle a été votée en juin et dans cinq mois, elle entre théoriquement en application. En gros, les « géants du web » tels Méta –, Facebook, Instagram, WhatsApp — et Google notamment, auront trois mois pour s’entendre avec les médias canadiens sur une somme qui leur sera versée en guise d’indemnité ; sinon, il y aura médiation, puis arbitrage par le CRTC dans les cinq mois qui suivent. Les libéraux encadrent donc plus qu’ils ne forcent le changement, mais au moins ils agissent.
En tout cas, ladite redevance est une contrepartie pour le partage d’articles et de reportages par les médias traditionnels. En effet, ce sont bien ces derniers (les journaux, les radios, les organes de presse) qui emploient les journalistes sur le terrain, afin de faire la cueillette d’information, puis de rédiger les textes ou monter des reportages audio et vidéo. Vous conviendrez également que les médias sociaux, qui offrent des fils d’actualité, ne font que réutiliser ce contenu sans jamais rien payer, alors qu’ils engrangent des profits grâce à la publicité qu’ils attirent sur leur plateforme et aux abonnements que leurs clients contractent ? Il parait donc logique et raisonnable qu’ils payent leur juste part dans ce monde où tout a un prix, même l’air et l’eau que nous respirons et où les revenus des médias d’information ont plongé drastiquement, menaçant aujourd’hui jusqu’à leur existence même. Pourquoi l’information en serait-elle exclue ?
Certain-e-s pourraient se demander si l’on n’en fait pas trop, ou au contraire, pas assez. C—18 est-elle comparable à ce qui se fait ailleurs ? Examinons les faits. En Australie, depuis 2021, les GAFAM rémunèrent à coup de centaines de millions de dollars par an les médias pour la reprise de leur contenu d’information. En France, un accord a été conclu en 2022 entre Google et les agences de presse. Et en Californie, plusieurs projets de loi ont été adoptés ou vont l’être, afin de mieux réguler les médias sociaux et en particulier pour rémunérer les rédactions, qui fournissent l’information originale, à hauteur de 70 % des revenus perçus par les entreprises du numérique qui les publient. Le titre en est éloquent : « Loi de préservation du journalisme ». Finalement, le dicton dit vrai : quand on se compare, on se console.
En vérité, c’est encore mieux… Méta croit punir les citoyens en coupant l’accès aux pages d’informations des grands quotidiens sur Facebook. Au contraire, merci Mark Zuckerberg ! Et oui, cette situation va nous pousser à consulter directement les organes de presse et non à nous informer indirectement, via des entités à but lucratif qui n’ont ni d’éthique professionnelle ni de compétences particulières pour juger de l’importance des nouvelles à offrir à leurs clients. Nous avons été et sommes encore, dans une certaine mesure, les otages des GAFAM. Vous remarquerez que les nouvelles partagées sont trop courtes, incomplètes pour vraiment comprendre l’actualité en plus d’être non exhaustive (tous les sujets ne sont pas couverts). À la limite, on pourrait presque qualifier cela de désinformation… Alors, rendons-nous plutôt directement à la source, qu’il s’agisse du site web, de la version papier ou du balado confectionnés par les professionnels de l’information que sont les journalistes.
Va-t-on les laisser faire?

La question n’est pas de moi, plusieurs se la posent depuis le début de l’été en France, et en particulier en Occitanie, d’où je tente justement de capter l’air du temps…
Plusieurs évènements se sont télescopés ces dernières semaines dans la patrie de Marguerite de Navarre, Olympe de Gouges, Marie Curie et Simone de Beauvoir, qui exacerbent une frustration récurrente face à certaines tendances sociétales que l’on retrouve dans tous les pays du nord global. D’ailleurs, il n’est pas anodin que les opinions se crispent pendant la saison estivale, où, même au Canada, les « corps exultent » et se dévêtissent plus qu’à la normale. Imaginez en Europe…
Voilà les faits. Mi-juillet, des archéologues (femmes) ont subi à répétition des insultes lors de fouilles en banlieue de Paris, dans la bonne ville de Saint-Denis. Contexte : nous sommes en extérieur, sur un chantier, il fait 35 degrés. Donc les archéologues sont en pantalon léger ou short et t-shirt ou « débardeur » (avec des bretelles spaghetti). Pour rester poli, elles ont été victimes de gestes et d’insultes à caractère sexiste et sexuel au point que la mairie a dû installer une palissade, engager des vigiles et placer des avertissements écrits.
Quelques jours plus tard, une jeune femme et son ami sont agressés sur la plus grande place de Toulouse, à trois heures du matin par quatre autres jeunes. Ces derniers l’ont insultée, puis mise à terre et rouée de coups, en la tailladant avec un tesson de bouteille au cou, au visage, dans le dos, aux épaules et sur les bras. 50 points de suture ! Motif ? Elle a croisé leur regard et était habillée avec une jupe trop courte et pour son décolleté ! Peu de temps avant, en juin, avait eu lieu le procès des agresseurs et du bourreau de Shaïna Hansye, 15 ans, poignardée à quinze reprises et brûlée vive en 2019, après qu’elle ait porté plainte pour « violence en réunion, menaces de mort et vol ».
Enfin, ressurgit chaque été le problème du burkini, la tenue de bain intégrale. Le phénomène, bien qu’en croissance, est très minoritaire, tant du côté des femmes qui s’en prévalent que des municipalités qui votent des règlements pour l’interdire, mais bon... Le Conseil d’État, plus haut tribunal au pays, a statué que « cette interdiction porte atteinte […] à la liberté d’aller et venir, à la liberté de conscience et à la liberté personnelle » et qu’il n’y a pas de trouble à l’ordre public, pas plus que si un curé en soutane décidait d’aller à la plage.
Dans tous ces cas, au-delà des droits et libertés, l’enjeu est surtout d’ordre politique et social, et la décision d’un tribunal ne règle pas forcément le problème : partout où prolifère le port des voiles (du plus simple hidjab à la burqa) ou du burkini, la démocratie et le statut des femmes reculent. La femme, par sa seule présence, est le symbole, la frontière qui autorise ou interdit l’accession à un monde plus libre et pluriel. Une chose aussi simple que son visage ou ses cheveux peuvent aisément devenir les otages d’un diktat politique (puisqu’il s’inscrit dans la sphère publique). Complaire à cette affirmation rétrograde qu’est le port du voile, c’est insulter le combat des femmes afghanes ou iraniennes. On peut vivre avec ça, encore faut-il l’admettre.
Dernière

Toujours dans la série de chroniques inspirées de ce qui se passe en France cet été, puisque j’y suis encore en vacances, je vous offre ce texte. Il devrait vous remonter un peu le moral, en ces temps mornes où l’horizon parait bouché, parce que loin des grandes idées — voire des idéaux — loin des discours creux sur les misères de notre époque avec leurs solutions à court terme et à trois sous – desquels je reparlerai sous peu — il y a les relations humaines qui nous remplissent de bonheur et nous réchauffent le cœur.
J’écris ces quelques mots au lendemain du mariage de ma sœur. Vous vous étonnez et doutez que votre éditorialiste préféré (et quinquagénaire) ait une sœur si jeune ? Vous avez raison, elle n'est pas dans la vingtaine, mais elle a bel et bien pris la décision de se marier (civilement) avec son conjoint, après plus de vingt ans de vie commune. Cela change-t-il quelque chose au fond ?
Un peu quand même, puisque l’expérience de vie qui conduit à ce genre de choix n’est pas la même à 45 ans qu’à 25 ans ; le statut des amis invités, les liens qui les unissent aux mariés sont différents. Imaginez que pour faire simple, ils n’avaient invité que les parents, les frères et les parrains/marraines… les deux tiers de l’assistance étaient donc constitués uniquement des amis, et quels amis ! J’ai failli dire les vrais amis, car rendu à 45-50 ans, le temps a opéré une certaine sélection naturelle parmi nos connaissances. En général, ceux et celles qui restent appartiennent à notre paysage affectif, ils nous connaissent très bien, ils font en quelque sorte partie de la famille.
Et moi là-dedans ? Eh bien je les ai rencontrés, j’ai eu le temps de faire la connaissance de chacun-e d’entre eux tout au long des 24 heures où je les ai côtoyés. Ah ! Oui j’avais oublié de dire qu’en France, souvent encore, si le mariage commence dès la rencontre des invités avant la cérémonie, comme ailleurs, disons vers 11 h 30, il se prolonge par un apéritif, puis un long repas, avec des animations et des jeux, avant un souper et une soirée qui se termine à 3 h, 4 h ou 5 h du matin (voire pas du tout) ; et le lendemain matin, on se retrouve pour un déjeuner et un dîner ensemble…
Convivialité, partage, longues conversations à bâton rompu, le plus souvent sous les effets de l’alcool (le « petit jaune », le fameux Ricard, auquel s’ajoute la bière, les vins — un différent pour chaque plat — et les bulles !) ! Les langues alors se délient, on apprend des choses sur les uns et les autres, en particulier sur les mariés. De confidence en confidence, à l’évocation des bons et des mauvais souvenirs, on apprécie davantage le temps passé, l’histoire commune, l’amitié qui nous unit…
Et c’est précieux. En langage moderne, c’est du « temps de qualité ». En termes plus prosaïques, c’est du pur bonheur. Nul besoin de drogues de synthèse, de dépenses à coup de milliers de dollars ou de grands tralalas, la formule magique est plus beaucoup plus simple : partagez du temps avec les gens que vous aimez et qui vous aiment. Parce que comme Big Flo et Oli le chantent, il faut se dire que « ça peut pas être la dernière ».
Rentrée scolaire à haut potentiel intellectuel

Elle approche ; pour certains, elle a déjà eu lieu. Et je suis chaque année davantage étonné par le nombre croissant de petits génies autour de moi. Je parle en effet de ces enfants qui se présentent dans nos écoles, dans mes classes. Évidemment, nous avons souvent raison d’être fiers d’eux et l’on a même le droit (le devoir ?) de les encourager, afin de renforcer leur confiance en eux-mêmes et qu’ils deviennent des adultes épanouis. Toutefois, combien entends-je de parents les qualifier de surdoué-e-s ou de précoces ? Au chapitre du rendement, de la productivité et de la compétition individuelle, principaux jalons de la réussite de nos jours, on rêve tous que notre progéniture soit meilleure que la concurrence, n’est-ce pas ?
D’abord, il faut savoir que seuls 2,5 % de la population disposent de plus de 130 de Quotient intellectuel ; tout comme 2,5 % seulement ont moins de 70. Ces chiffres sont constants dans le temps, quels que soient les systèmes d’éducation, les méthodes, etc., dans nos sociétés du Nord global. Ne rêvons donc pas trop haut en couleur tout de suite !
Par ailleurs, la quantité de jeunes avec des troubles de comportement ou d’apprentissage est en hausse constante, au point que ceux qui ne n’ont rien — et donc ne reçoivent pas d’aide — sont quasiment minoritaires ! Signe des temps, selon la fédération des comités de parents du Québec, les problèmes de nos enfants si brillants ne viennent pas du manque de travail (même s’il ou s’elle s’interrompt pour consulter ses messages ou regarder une publication sur Insta ou TikTok), ce n’est pas non plus la faute du prof (même si c’est le troisième remplaçant de l’année et il vient juste de terminer son Cégep), non, non, c’est à cause de son trouble ! C’est vrai qu’il ou elle n’a jamais terminé un livre autrement qu’avec des images ou parce qu’il était « pour son âge » (comprendre : simple à l’excès) et qu’il a joué avec son premier écran avant de savoir marcher…
Dyspraxie, dysphasie, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, etc., auxquels s’ajoutent les troubles du comportement (de la simple hyperactivité souvent associée à un déficit d’attention), les syndromes divers, qui sont des maladies, tels que Tourette, Asperger et tous les cas du spectre de l’autisme. Ah ! oui, j’oubliais : tout cela peut se combiner.
On a donc tous un trouble, un peu comme dans la pièce de Jules Romain, Knock, où chaque personne est un « malade qui s’ignore ». Et en plus, cela dès la naissance ! Donc, parents, éducateurs, vous êtes dédouanés : ce n’est pas vous ou votre cadre éducatif ; c’est un problème immanent, contre lequel on ne peut rien faire, sinon aménager les conditions d’apprentissage dudit jeune : temps supplémentaire, voire extension des délais de remise, ordinateur, applications en tout genre, correcteur, tuteur… Ça devrait marcher !
Le problème est qu’il semblerait que pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, les générations montantes, nées après 1975, sont moins intelligentes que les précédentes, selon une étude norvégienne du Frisch Centre d’Oslo. Ma conclusion ? Je vois là beaucoup trop de contradictions pour que mes élèves actuels soient vraiment les petits génies que l’on me présente à chaque rentrée… De toute façon, qu’est-ce que l’intelligence ? Comment est-elle mesurée ? Est-elle le corollaire d’une vie réussie ? Qu’en faisons-nous? Sommes-nous plus heureux pour autant ?
Éditoriaux de juillet
Qui sont les Québécois ? Qui sont les Canadiens ?

Quelque part entre la « fête nationale de la Saint-Jean-Baptiste » et la « fête nationale du Canada », j’écris ces lignes. Vous aurez noté la redondance de ces expressions, qui illustre déjà un aspect du problème... Et puis, parlons plutôt de « nous »!
Une première réponse consisterait à analyser les composantes de ces populations d’une manière statistique. Au Canada, aujourd’hui, environ les trois quarts sont « blancs » (caucasiens), 16 % asiatiques, 5 % autochtones et 4 % noirs ; dont 75 % qui ont l’anglais comme langue d’usage et 21 % le français. Si l’on incluait l’origine par pays ou par continents et la langue maternelle, une plus grande diversité encore apparaitrait ; près de 13 % de la population parle une autre langue que l’anglais ou le français à la maison… Ajoutons que ces chiffres ne rendent compte ni de la répartition géographique (est-ouest ; par province) ni de l’histoire de ces communautés. Pour ce qui est du Québec, le français y est sans surprise majoritaire à 80 %, l’anglais à 6 %, talonné par l’arabe (4 %), avec des origines surtout « canadienne » ou européenne ; Asiatiques et Africains constituant moins de 10 % de la population. Sont également absentes les grandes tendances migratoires et historiques, surtout récentes, et la référence à l’origine « canadienne » parait incongrue : sont-ce seulement les citoyens nés au Canada ? Or c’est bel et bien l’Histoire qui a forgé la situation sociodémographique et le statut des langues actuels : nous sommes tous des voyageurs ou leurs descendants, qui nous sommes arrêtés ici à un moment donné ; certains, comme les autochtones, il y a bien plus longtemps. À cet égard, nous ne pouvons prétendre à être davantage que les « gardiens » de cette terre et non les propriétaires.
Cependant, connaitre tout cela ne nous empêche pas de nous questionner sur notre identité. C’est même nécessaire pour avancer, individuellement autant que collectivement. Le problème au Canada est que notre histoire en tant que pays « indépendant » date à peine d’un siècle et que l’immigration (notre ADN en tant que société) a superposé les couches de population aux origines, cultures, religions, usages et valeurs différentes. Le Québec a suivi la même trajectoire, mais à retardement et parce que retardé par l’omnipotence de la culture catholique francophone, elle-même longtemps dominée par une élite socio-économique protestante anglophone. Et il faut l’admettre, le racisme, bien que systémique, n’est pas non plus absent entre les communautés minoritaires, y compris dans ce ROC, souvent donneurs de leçons d’ouverture d’esprit au Québec, mais qui ne pratique pas nécessairement l’intégration par les mariages mixtes ou l’interculturalisme.
Comment faire dès lors ? C’est là que la politique, incarnée théoriquement par nos représentants élus, intervient, en bâtissant un cadre, en donnant une direction, un sens à cette identité qui évolue constamment. Cela peut passer par la création d’un « destin national », à travers les exploits militaires lors des guerres qui ont émaillé les cent dernières années, à travers les grands mouvements sociaux, telle la révolution tranquille, ou encore à travers une idéologie (le multiculturalisme et le bilinguisme canadiens). Dans tous les cas, pour moi il est clair que l’on ne peut résumer notre identité collective à la somme de nos identités individuelles, mais si « fête nationale » il doit y avoir, elle se doit d’inclure le plus grand nombre.
Qui sont les Québécois ? Qui sont les Canadiens ?

Comme elle portait bien son nom ! Avant même de savoir que Bombardier était le patronyme de l’inventeur de la motoneige et un constructeur d’avions, j’avais eu vent de ce nom peu commun en France. D’abord, parce que j’avais assisté en direct au coup d’éclat de Denise Bombardier dans les années 1980, face à l’écrivain pédophile Gabriel Matzneff, et puis au fil des années, lors des différentes et nombreuses visites de Madame B. effectuait dans l’hexagone.
Si elle fut l’exemple même de toute une génération de femmes québécoises nouveau genre, qui bénéficièrent de la Révolution tranquille, en accédant à une éducation supérieure non religieuse (1964 : baccalauréat en arts ; 1971 : maitrise en science politique à l’Université de Montréal), c’est en France qu’elle vécut et étudia par la suite avant d’obtenir son doctorat en sociologie. De là probablement, sa vaste culture générale et son intérêt pour la chose sociopolitique, avec une bonne dose d’indépendantisme et d’engagement dans la défense du français.
Cependant, à mes yeux, Denise Bombardier était avant tout une écrivaine. J’ignorais alors qu’elle avait déjà à l’époque une carrière dans les médias, et en particulier à Radio-Canada, comme recherchiste, ensuite comme animatrice ; parcours qui ne s’arrêtera qu’en 2003. Interviewant les plus brillants esprits (francophones) de son époque, elle fut quand même la première femme à la tête d’une émission d’affaires publiques ! Elle fit même du cinéma !
Entretemps, sa carrière d’autrice avait pris son envol : articles, chroniques, blogue, paroles de chanson, essais et romans… plus de vingt ouvrages, étalés sur 35 ans, avec quelques titres marquants, surtout autobiographiques, et qui constituent également des repères dans sa bibliographie : Une enfance à l’eau bénite, L’Anglais et ses mémoires, dernier opus paru en 2018, Une vie sans peur et sans regret.
Au-delà, et cela tous les témoignages des personnes dont le chemin a croisé celui de madame B. ou de celles qui l’ont vue ou lue le confirment, outre sa culture, c’était sa personnalité qui marquait les esprits. Franche, voire grande gueule, passionnée, courageuse, généreuse, ambitieuse, elle pouvait paraître revêche et trop directe en public à plusieurs. Toutefois, en ce qui me concerne, elle incarnait la femme québécoise intellectuelle, libérée par son éducation sur bien des sujets, la Québécoise moderne de l’après-Révolution tranquille. Teintée encore d’un certain conservatisme, il est vrai, mais un exemple à suivre à certains égards. Et dans la sphère privé, elle semblait plus ouverte et débridée !
Son enfance sous la coupe d’un père au verbe assassin et dominateur explique certainement la propension de madame B. aux réparties cinglantes lors de diverses disputes et polémiques, littéraires ou pas, auxquelles elle aura participé tout au long de sa vie. Toutefois, on ne saurait la réduire à quelques bonnes phrases. Elle avait des opinions tranchées sur bon nombre de thèmes clivants, identitaires, qui agitent encore aujourd’hui la société québécoises (le statut du français, la place des femmes, la laïcité pour n’en nommer que quelques-uns). De fait, elle provoquait donc des réactions entières : on l’aimait ou on al détestait.
Rien à dire, Denise Bombardier portait bien son nom, et personne ne pourra jamais le lui reprocher. J’ai personnellement beaucoup apprécié son Dictionnaire amoureux de la langue française. Déformation professionnelle, j’imagine. En tout cas, une grande Québécoise nous a été brutalement arrachée.
14-15 mai 1948

Je voulais en parler en mai, mais actualités québécoise et canadienne obligent, je renonçai... Jusqu’à maintenant, où, je profite de la pause politique estivale. Il y a deux mois a été célébré un anniversaire peu commun. Encore aujourd’hui, il est une pomme de discorde, qui divise souvent dans les discussions entre amis, collègues ou en famille. C’est le fameux débat autour de la « question israélo-palestinienne ». Un euphémisme pour l’incroyable complexité de ce conflit séculaire.
Le vendredi 14 mai 1948, David ben Gourion, président du Conseil national juif, proclamait unilatéralement la naissance d’Israël, officiellement créé le lendemain. À l’époque, l’évènement est légal — l’ONU a en effet prévu de partager l’ancienne province ottomane de Palestine entre un nouvel état pour les juifs et un état palestinien qui regrouperait les populations arabes locales — mais sans consultation préalable des dites populations. Cela étant dit, la Grande-Bretagne avait déjà divisé avant la guerre ce territoire en une Palestine côtière, qui comprenait déjà 100 000 juifs en 1914, 335 000 en 1936 - territoire non reconnu mais toléré disposant de structures médicales, scolaires, militaires - une Palestine « continentale » et la Transjordanie qui deviendra la Jordanie. De plus, en 1947, un autre état avait été fondé artificiellement, cette fois-ci pour les musulmans : le Pakistan.
Par ailleurs, Il est bon de se souvenir d’une ou deux choses. D’abord du contexte : le substrat antisémite de la société occidentale de l’époque. Le plus parfait exemple en est la Conférence d’Évian (France) qui se tint du 8 au 14 juillet 1938. Instiguée par le président Roosevelt (qui ne voulait pas avoir à choisir lui-même) afin de venir en aide aux nombreux juifs dont les nazis ne voulaient plus, elle déboucha sur… rien! Malgré la crise économique, malgré les lois antisémites de Nuremberg et les persécutions de plus en plus brutales dont les juifs étaient les victimes, malgré la création d’un Haut-Commissariat aux réfugiés d’Allemagne, les 32 pays présents réaffirmèrent au contraire leur refus d’accueillir quelques 650 000 « réfugiés » allemands et autrichiens. Quant aux autres nations, chacune trouva de bonnes raisons de garder la porte fermée : pas un pays d’immigration (Royaume-Uni), pas de nouveaux conflits « raciaux » (Australie), a déjà fait sa part (Suisse)… La nuit de cristal de novembre 1938 n’y changera rien : le paquebot Saint-Louis et ses 900 passagers juifs partis de Hambourg le 15 mai 1939 seront refoulés par tous les pays (États-Unis, Canada, Argentine, Uruguay, etc.) et retourneront finalement en Allemagne !
Et puis l’événement déterminant : l’extermination méthodique organisée par les nazis qui aboutit à la disparition de 6 millions de juifs. La Shoah était documentée et reconnue depuis 1941 par le gouvernement, la presse et l’opinion publique britanniques, grâce à la machine Enigma qui avait permis de briser les codes secrets de la Wehrmacht. Ce qui n’était « que » crime de guerre deviendra après 1945 génocide et crime contre l’humanité.
Dès lors, on comprend la mauvaise conscience des gouvernements et des populations vainqueurs de la guerre, qui les poussa à autoriser la création d’un état-sanctuaire au Proche-Orient pour les juifs, même si cet acte assez unique dans l’histoire des relations internationales allait engendrer des conséquences géostratégiques majeures au proche et au Moyen-Orient, mais surtout l’un des conflits armés les plus longs de l’histoire, qui dure encore. Un beau cadeau empoisonné.
L’art de flâner

Dans le sens de paresser : téter, niaiser, taponner, chienner ou bisouner ; mais aussi rêvasser, traîner, fainéanter, perdre son temps, baguenauder ; plus familier : flemmarder, coincer la bulle, gober des mouches, peigner la girafe, se pogner le beigne. Dans le sens de trainer : gosser, placoter, bretter, musarder, s’attarder, tarder, prendre tout son temps, lanterner, lambiner.
Est-il étonnant que nous ayons tant de mots pour exprimer le fait de ne rien faire (ou pas grand-chose et sans se presser) ? Cela souligne plutôt son caractère essentiel à l’humain, ô combien ironique dans une société, où chacun de nous est sommé d’être actif, dynamique, productif. L’été ne serait-il pas la meilleure saison pour prendre le temps d’en discourir, entre une longue fin de semaine et les vacances de la construction ?
Flâner, vous le savez, suppose un état d’esprit un peu particulier. 1) par rapport à un but supposé — nous faisons toujours quelque chose « en vue de », et bien là, non, au risque de la procrastination, ou pire… 2) par rapport au temps, à la durée que l’on donne à notre action — dans le cas qui nous occupe, c’est comme si laissions le temps aller, que cela soit volontaire, comme on va le voir plus loin, ou involontaire, lorsque notre attention décroche et laisse nos pensées s’égarer. Dans les deux cas, le résultat est le même : une escapade mentale.
Et bien, la science l’a analysée. Les neuropsychologues s’y intéressent d’autant plus que les technologies qui nous entourent réduisent ces instants de flânerie à leur plus simple expression. À la moindre pause, dans les transports, dans une salle d’attente, dans une file à l’épicerie ou à la maison, que faites-vous ? Vous prenez votre téléphone, vous vérifiez vos messages, jetez un œil aux dernières nouvelles ou regardez quelques vidéos. Notre cerveau est alors sollicité, sous tension, voire en surchauffe. Nous sommes pré-occupés. Pourquoi ne pas laisser notre esprit digérer les évènements de la journée pour mieux entrevoir l’avenir ou encore ruminer quelques vieilles idées, élaborer quelque plan d’action pour la fin de semaine ?
Or, il y a des liens neuronaux entre la focalisation, l’attention, la mémoire et les interactions sociales. En effet, un esprit errant travaille en fait : il a été prouvé que certaines zones du cerveau sont au repos, quand l’individu effectue spécifiquement et avec concentration une tâche précise, mais sont très actives en cas de vagabondage. On nomme ces zones cérébrales le « Mode par défaut ».
Pour certains d’ailleurs, la flânerie se rapprocherait de la rêverie. Pas faux, mais attention ! Si l’on se réfère au célèbre Jean-Jacques Rousseau et à ses Rêveries du promeneur solitaire, c’est d’abord pour « gagner la bonne santé » qu’il fait ses promenades, puis également pour trouver « du plaisir à vivre », et enfin parce que son « cœur errant d’objet en objet s’unit », donc l’être se sent infiniment présent dans un espace illimité. Cela ressemble étrangement au bouddhisme, dans lequel il faut d’abord « lâcher prise » avant d’atteindre un état supérieur de conscience.
En tout cas, ne cherchez à quantifier, à donner une valeur marchande à la flânerie, c’est pour cela qu’elle est inestimable ! Pensez plutôt à tout ce qui peut en sortir : éclairs de lucidité, prise de conscience ou solution géniale à un problème ! Vous ne nommerez plus jamais ces instants-là de temps morts.
Éditoriaux de juin
Des boucles de rétroaction Ou « Ça sent l’sapin! »

Littéralement. La semaine dernière, nous avons eu un avant-goût concret de ce que l’expression « événement climatique extrême » signifie, suite à la sécheresse sévère des derniers mois. On se dit maintenant : « Ça va, j’ai compris, ça pique un peu les yeux et la gorge, on n’y voit pas très bien avec le smog, mais au moins personne n’est mort et les habitations ne sont pas touchées. Si c’est que ça… ». Autrement dit « Business as usual ». Ainsi très peu de gens ont porté un masque au plus fort des épisodes de smog, alors que la pollution était huit fois supérieure à celle de Pékin !
On pense à ces premiers effets des feux de forêt, mais les experts, eux, y appliquent une notion scientifique plus large, celle de « boucle de rétroaction ». En gros, cela signifie que la réponse d’un système (notre environnement naturel) à un stimulus externe (un incendie) impacte le stimulus lui-même. Elle est dite positive quand elle renforce la cause ; dans des cas extrêmes existent des points de basculement, à partir desquels les conséquences sont irréversibles.
Or le système Terre inclut plusieurs phénomènes physico-biologico-chimiques sensibles à la température, mais qui ont également un impact sur cette dernière : la concentration en vapeur d’eau de l’atmosphère ; le réchauffement des océans et leur absorption du CO2 ; la diminution de l’effet albédo de la surface de la Terre ; le dégel du pergélisol… et tiens donc, les feux de forêt!
À propos de ces derniers, l’augmentation de la température accroit l’assèchement des forêts, ce qui les rend plus vulnérables aux incendies… Et donc elles brûlent plus fréquemment et plus rapidement. Autres effets collatéraux possible : les nuages de haute altitude pourraient migrer plus haut afin de garder leur température initiale, ce qui réduirait leur capacité à refroidir la planète ; et ceux de basse altitude se disperseront si les gaz à effet de serre triplent ces prochaines années ; enfin, de nouveaux nuages sont créés, les fameux Pyrocumulonimbus, sorte de nuages verticaux causés par des feux énormes, qui montent jusque dans la stratosphère, qui s’accompagnent de phénomènes tels des vents et des orages ultrapuissants, avec des éclairs… qui à leur tour vont allumer de nouveaux feux au sol.
Cependant, il y a plus. Par exemple, le cycle de l’eau est perturbé : au-dessus des zones en feux, les particules chargées d’humidité n’entrent plus en collision parce que trop fines, donc réduisent les précipitations à venir ; en plus, elles absorbent la lumière du soleil, ce qui réchauffe l’air, assèche les sols un peu plus, y compris les zones humides. Ensuite, si et quand il pleut, il n’y a plus de végétation au sol pour retenir l’eau, on assiste alors à des inondations et à des glissements de terrain…
Enfin, pensez : une fois ces feux éteints, que restera-t-il ? Comment rebâtir une quelconque économie, une existence sur une terre brûlée ? Combien de ces territoires seront encore vraiment habitables ? Et pour clouer notre cercueil, ce mois-ci va s’y ajouter le phénomène cyclique El Niño, qui arrivera à pleine maturité en décembre prochain. On va donc atteindre de nouveaux pics de chaleur dans l’année à venir… mais année après année, même si de nouveaux records sont battus, qu’est-ce qui change dans les mesures politiques des partis au pouvoir ?
Tu quoque pater meus

Coïncidence, je suis tombé par hasard samedi soir dernier sur le film québécois adapté du roman graphique Paul à Québec et la veille, je venais de terminer la série Star Trek Picard. Le point commun entre ces deux productions? Elles tournent autour de la figure du père et du legs. Et dimanche, c’était la fête des Pères. Un relent de la société patriarcale, diraient certains. Certes, mais bon, cela existe encore. Et au-delà de la figure du père, à laquelle je m’identifie évidemment, entre autres choses — je pourrais également discourir sur l’enseignant, l’éducateur ou le coach — mais c’est la question de l’héritage qui me taraude. Qui nous taraude tous en vérité. À un moment ou à un autre de notre vie, c’est la question que l’on se pose, non? Que vais-je laisser après ma mort ?
À nos enfants, à nos amis, dans notre travail, plus largement, à notre communauté et à la société. La mort nous rend égaux. Riches, célèbres, puissants ou pauvres, anonymes et petits, nous disparaissons tous physiquement, notre corps va nourrir les vers de la même façon et se fond par-là même avec le reste de l’univers. En en prenant conscience, une peur existentielle nous saisit : notre vie n’aura-t-elle donc servi à rien ? Nous ne pouvons croire qu’il ne restera rien de nous… Excès de vanité tout humaine ? Orgueil mal placé ? Certainement. Souci légitime de donner un sens à notre présence éphémère sur terre ? Aussi.
Ceci explique que beaucoup économisent, achètent une maison ou un chalet ; ils laisseront à leurs proches du concret. En fait, à bien y réfléchir, faire des enfants — cet instinct de survie de l’espèce — est également une manière de survivre à notre mort. Je n’ai rien inventé : Platon la cite déjà dans l’un de ses dialogues, Le Banquet. Fait intéressant, il en répertorie d’autres. À commencer par la poésie, au sens grec de création. Créer, c’est en effet laisser une trace perceptible, sensible, qu’il s’agisse de musique, d’arts visuels, de littérature ou d’arts de la scène. C’est ainsi que l’on se rappelle encore Marguerite de Navarre, Mozart, Camille Claudel ou Corbusier. Nous souviendrons-nous encore d’eux longtemps ? Difficile à dire ; nous, humains, aimerions bien croire que oui.
Cependant, il y a mieux encore, en tout cas pour Platon : « accoucher des âmes », autrement dit accoucher des esprits, à la manière des philosophes. Aider un humain à développer son esprit critique, son plein potentiel intellectuel et le guider à devenir clairvoyant, lucide, altruiste et en quête de vérité, bref, pleinement humain. Je dirais que l’une des formes de cette maïeutique consiste dans le travail des enseignants, des éducateurs, des coachs. Ils n’apportent rien de concret à leurs élèves, étudiants ou joueurs, mais ils les aident à s’élever, à développer leurs qualités humaines, pas seulement physiquement, mais moralement, intellectuellement, psychologiquement. La trace qu’on laisse sur l’esprit d’un être humain est parfois ténue, mais qui sait ? Sous quelle forme s’épanouira-t-elle ? Une chose est certaine : ne restera au fond de nous que des souvenirs, le plus souvent émotionnels, dans le cœur et la mémoire des gens qui nous survivent, jusqu’à ce que la mémoire qu’ils ont de nous et eux-mêmes disparaissent. Père, mère, parent ou tuteur, peu importe notre nom, c’est la réalité irréfragable et éternelle de notre condition humaine.
Un toit, c’est un droit!

Je n’ai aucun mérite, cette expression est le slogan de l’ONG Droit au logement. Or, elle exprime une situation absente des préoccupations de nos décideurs, en particulier ceux de la CAQ, pour qui le marché et la libre entreprise sont l’alpha et l’oméga de toute politique publique. L’accès aux soins de santé, à l’éducation, sont bien des droits protégés et encadrés par le gouvernement, non ? Pourquoi disposer d'un toit au-dessus de la tête n'en serait pas? Nul besoin de réexpliquer l’analyse de Maslow…
D'abord ce qui m’étonne, c’est que le gouvernement fédéral n’ait pas eu de politique publique plus volontariste de constructions, d’attribution et de gestion de logements abordables depuis tant de décennies. Il faut savoir que, hormis entre 1945 et 1975, le gouvernement s’est désengagé progressivement du financement du logement social et communautaire, au point qu’il y est quasiment absent à l’heure actuelle. Un financement qui a alimenté pendant ces 30 premières années un « partenariat », secteur public, société civile, tiers secteur et le secteur privé. Il a ainsi permis l’apparition de la Société canadienne d’Hypothèque et de Logement (SCHL) et au Québec ; celle des habitations à Loyer modique (HLM) et des Offices Municipaux d’Habitation qui les gèrent (OMH) ; celle des coopératives d’habitation et de la Société d’Habitation du Québec. De belles avancées sociales.
Malheureusement, depuis les années 1990, le transfert des responsabilités s’est effectué sur les provinces sans les transferts de fonds nécessaires ; plusieurs conventions arrivant à échéance, la crise est d’autant plus aiguë. Dans le jargon néo-libéral, on appelle cela la dérèglementation ». L’effet est relativement simple. Par exemple, le loyer ne pouvait excéder 25 % du revenu familial depuis les années 1970 ; désormais, les propriétaires ont retrouvé la liberté d’augmenter (peu ou prou) les loyers du montant qu’ils désirent, d’où les 585 000 logements qui ont vu leur loyer augmenter de de 200 à 300 $ par mois entre 2015 et 2020 !
Et s’il faut admettre que le gouvernement québécois a fait de gros efforts, qui se montent à des milliards de dollars au fil des années, en mettant en place plusieurs programmes de financement depuis, les intervenants du milieu doivent faire preuve de beaucoup d’imagination pour trouver des solutions alternatives, avec le succès très mitigé que l’on connait. Et pour une bonne raison : on a laissé le champ libre aux constructeurs privés, qui ne sont ni des philanthropes ni des citoyens très responsables malgré tous leurs beaux slogans publicitaires. Après tout, leur but est de faire le plus de bénéfice possible, en rentabilisant le moindre mètre carré. Alors le logement abordable… Qui peut les blâmer ?
C’est aux pouvoirs publics de mettre l’épaule à la roue, rapidement et massivement ! Pensez, il manque plus de 110 000 logements abordables au Québec ; 40 000 ménagea attendent un HLM. La crise sanitaire, la crise énergétique et l’inflation généralisée sur tous les produits et matériaux ces dernières années ont accru les problèmes : il y a de l’argent, mais pas au bon endroit et surtout sans régulation aucune. Les marchés de la construction et locatif dans notre région en sont de bons exemples : si vous pouvez payer 2000 $ par mois, alors vous trouverez sans difficulté un 2 et ½… Mais qui peut se permettre de débourser une telle somme, à part des fonctionnaires (fédéraux) célibataires ?
Éditoriaux de mai
Nouvelle offensive contre le français…

… sous prétexte de défendre le bilinguisme. Alors que les attaques contre la loi 93 continuent, on assiste à une nouvelle levée de boucliers du Canada anglophone contre la loi C13, dite « sur les langues officielles », qui permettra peut-être aux libéraux de récupérer le Québec aux prochaines élections fédérales. Non pas qu’ils croient dans un bilinguisme officiel somme toute assez récent, mais ils le pratiquent parfois tièdement. Cependant, la reconnaissance que la situation des deux langues est asymétrique constitue une étape historique. Le gouvernement Trudeau aurait même atteint ses cibles d’immigration francophone pour la première fois ! Cibles modestes, mais bon…
Maintenant, au tour des juges à la retraite de voir leur argumentaire fallacieux répercuté dans les journaux du ROC. Et les propos avancés sont assez incroyables. Par exemple, la rénovation de la loi sur les langues officielles conduirait à une fracture entre les deux groupes linguistiques, rendant les positions inconciliables. Ah ! Oui ? Mais 1) ce clivage existe déjà 2) de quelle attitude parle-t-on ? En effet, si l’on observe simplement le milieu de travail qui représente la quintessence de cette loi (le gouvernement fédéral et ses ministères), alors les faits sont là : les réunions se font en anglais ; les francophones se heurtent souvent à un plafond de verre pour accéder aux postes de direction les plus élevés ; le niveau C ou l’exemption restent plus faciles à atteindre en français qu’en anglais.
De plus, contrairement à ce que prétend le vénérable juriste, nous sommes loin de la situation de la Belgique et de sa « dualité linguistique » ; même si certains points communs existent, l’anglais reste la langue très largement majoritaire en Amérique du Nord, la langue d’une grosse partie des affaires et celle d’Hollywood. Comment peut-on encore arguer que la loi actuelle, qui date de 1988, rompt l’« équilibre » entre la situation de l’anglais et celle du français ?
Ultime argument : cela défavoriserait les Canadiens unilingues anglophones. Pardon, je croyais que tout le monde apprenait le français à l’école, au Canada. J’ai dû me tromper… En tout cas, combien de fois dit-on aux francophones (ou allophones) que l’on ne peut travailler sans l’anglais ? D’ailleurs au Québec, les élèves des écoles francophones continuent l’anglais jusqu’en secondaire 5. S’il existe bel et bien deux langues officielles, alors on est en droit d’attendre de la part de tous les Canadiens un certain bilinguisme : francophones autant qu’anglophones doivent faire des efforts… Et pas seulement au fédéral et dans les entreprises de « compétence fédérale », question de principe, non ?
Enfin, depuis 1988, reconnaissons que la situation du français s’est dégradée d’un océan à l’autre, donc cette loi nécessitait évidemment d’être revisitée afin de renforcer le français, aussi peu que ce soit, partout où c’est possible. Le statu quo n’est pas une option, parce qu’il fait immanquablement pencher la balance du côté de l’insécurité linguistique, qui conduit à l’assimilation.
Le véritable bilinguisme n’est pas de se soumettre à la loi du plus grand nombre, mais bel et bien d’être compris dans la langue de son choix et de pouvoir comprendre l’autre langue officielle : parlez-moi en anglais si vous voulez, je vous répondrai en français ; si nous nous comprenons, personnellement, je n’y verrai aucun inconvénient. Au Canada, je m’attends à pouvoir la pratiquer en tout temps, en tout lieu.
Les pieds dans l’eau

Je vous l’avoue, j’ai hésité. Parler de notre nouveau roi était tellement tentant ! Un moment historique comme celui-là, pouvais-je ne pas en parler ? C’est vrai, on ne peut que tomber en pâmoison devant le charme désuet de ces individus intouchables, qui se reproduisent peu ou prou entre eux, héritent d’un titre sans avoir besoin d’étudier ou de travailler, qui se vêtissent comme il y a deux cents ans. Après tout, la famille royale anglaise, qui peut encore défaire nos gouvernements à 7000 km de distance, et la monarchie en général n’incarnent-elles pas tout ce qu’il y a de plus rétrograde et colonialiste ?
Plus sérieusement, si l’on évite de se faire tirer du lit à deux heures du matin pour évacuer notre maison à cause de grands incendies, pourra-t-on garder la tête — ou la maison — hors de l’eau, quand on observe la récurrence et l’amplitude des inondations que l’on vit ? Nous devrons de plus en plus nous poser collectivement cette question dans les années à venir. Et y trouver une réponse.
On me rétorquera qu’il y a en fait plusieurs réponses. Par exemple, par la prévention, en cartographiant les zones inondables, en s’assurant que les municipalités et le gouvernement provincial préparent des plans d’intervention, en règlementant plus strictement le zonage résidentiel, en ajustant la fiscalité pour pouvoir reloger les résidents des zones inondables, en redessinant les trottoirs en y ajoutant des saillies ou en protégeant mieux les milieux humides pour détourner les eaux des égouts qui débordent… Quelques-unes de ces actions sont aujourd’hui en cours après les inondations de 2017 et de 2019. Toutefois, trop souvent, les différents paliers de gouvernement sont en mode « gestion de crise » !
D’autres pourraient avancer que la problématique est plus fondamentale, ontologique : pourquoi vouloir à tout prix contrôler Mère Nature, au lieu d’accepter ses humeurs et ses excès? Après tout, quel orgueil de penser que l’on puisse lui être supérieurs ! Aujourd’hui, les chercheurs et les scientifiques ont introduit le concept d’« espace de liberté » des cours d’eau, qui s’accompagne d’un principe de travail avec elle. En clair, plutôt que de construire des digues et de surélever les maisons, on réaménage les rives et on relocalise les habitations. Certaines MRC (Coaticook, Saint-André d’Argenteuil) mettent cela en pratique ; leur nombre est grandissant, mais on en est encore à des projets de recherche à l’échelle provinciale.
Enfin, parler des cours d’eau au Québec, c’est immanquablement aborder la question culturelle. Le peuplement s’y fait par les rivières, le long des rivières, bravant depuis toujours les éléments. Est-il dans ces conditions raisonnable de penser que l’on pourra déménager tant de Québécois riverains ? Comment les convaincre, nous convaincre d’abandonner tout ce patrimoine bâti ? Quid des maisons centenaires, des maisons de notre enfance ? C’est plus fort que nous, c’est consubstantiel de notre identité ! Malheureusement, tout comme les inondations le sont des rivières, résultat naturel des crus et de la fonte printanière chaque année.
Conséquence : pas plus tard que la semaine passée, les municipalités ont réclamé plus de 2 milliards pour faire face à la crise climatique. Ce n’est que le début… Le gouvernement caquiste leur a répondu qu’il n’avait pas la marge de manœuvre, après avoir consenti une baisse d’impôt équivalente. Il se dit peut-être que les gens pourront toujours s’acheter une pompe ou un bateau gonflable avec !
On est rendu là?

D’après les « spécialistes », avec la fameuse génération Z (née après 2000), il faut comprendre une chose : les individus qui la composent s’assument comme ils sont, ils se connaissent bien mieux que nous, la génération X (si vous êtes né-e entre 1966 et 1979). Ils sont fiers de ce qu’ils sont. Ils sont audacieux et sages. Il paraitrait qu’il n’y a plus de tabous pour eux, et que leur normalité serait différente de la nôtre. Ils sont tellement inclusifs et pluriels ! Nous aurions donc beaucoup à apprendre de nos enfants. Théorie séduisante. Examinons-là un peu.
Pour commencer, je suis un peu étonné : ils se connaissent eux-mêmes ? Selon moi, pas mal de gens, eux aussi très intelligents, ont pensé et repensé cela, depuis Socrate, sans arriver facilement à une réponse. « Qui suis-je ? Qu’est-ce qu’être humain ? » sont encore deux questions auxquelles la majorité des adultes sont incapables de répondre…
Deuxième prémisse discutable : penser que la normalité change et que les enjeux changent avec elle. Les standards de normalité changent avec l’époque et les lieux certes, mais supposer que les problématiques fondamentales évoluent au même rythme me semble d’une naïveté ou d’une ignorance incroyable…
Troisième présupposé, qui tourne au principe fondateur : les enfants ont davantage raison que nous. Raison ? Comme la capacité à établir des liens intellectuellement féconds et développer un jugement critique fondée sur autre chose que sur une réaction à chaud ? C’est drôle, je pensais que si l’âge de raison est établi à 7 ans, seule une bonne expérience de vie doublée d’une réflexion bien outillée pouvait nous y amener, plus tard que tôt…
En réalité, les promoteurs de cette idéologie agiste et jeuniste cherchent une raison d’espérer, un motif pour rester optimistes ; peut-être une manière de se voiler la face… On connait la ritournelle : « mon enfant est si doué » (même quand il énonce les pires bêtises), « tellement bon » (même quand il échoue), « tellement mûr-e » (ses désirs sont des ordres) ! D’ailleurs, la preuve, quand ils manifestent « pour la planète », avec leur petite pancarte individuelle aux slogans si bien trouvés, aux jeux de mots si pertinents ? Une pensée réduite à 3 ou 4 mots le plus souvent. Évidemment, nous les caricaturons parfois — peut-être même en ce moment, avec mes généralisations faciles — sur leur dépendance aux médias sociaux, leur relation fusionnelle avec leur téléphone, leur nombrilisme, leur déficit d’attention chronique.
Mon message à travers tout cela ? Il est simple : vivons non pas à côté (chacun dans nos résidences et nos quartiers exclusifs), mais ensemble ; sortons de chez nous pour aller à la rencontre des autres lors d’événements politiques, sociaux, culturels et artistiques multigénérationnels ; que cette génération Z si sensible à l’injustice s’engage dans l’économie sociale, dans les associations et la connaissance au lieu de courir après la célébrité, un confort matériel outrageux et l’argent facile. La volonté d’être ensemble, les bla-bla d’un jour accompagnés d’une jolie photo sur Insta ne suffiront pas : c’est dans l’action, par exemple à propos de la crise climatique, que nous verrons si la génération Z est meilleure que les autres. Que nous soyons X, Y ou Z, accepterons-nous de sacrifier un tant soit peu notre qualité de vie pour accueillir tous les migrants qui frapperont à notre porte dans les années à venir ?
Le salaire du « plus beau métier du monde »

La réplique de Bernard Drainville, mercredi dernier, à propos des enseignants, quand le journaliste Michel David l’a interpellé sur la reconnaissance de ces derniers, laisse pantois. Le ton autant que le contenu de ses paroles montrent le mépris et l’incompréhension de l’ancien journaliste pour nos professeurs.
Oui, monsieur, on peut absolument les comparer aux députés. D’abord, parce que ces deux professions sont plus que de simples carrières, elles constituent des vocations, un sens du devoir à accomplir pour faire vivre notre démocratie. La mission des uns est de former l’esprit de nos jeunes, afin qu’ils deviennent des citoyens éclairés, critiques et responsables ; la mission des autres est de représenter le peuple, avec toutes les qualités que cela réclame : éthique, sens critique, ouverture d’esprit, sens des responsabilités, notamment. Ajoutez-y les journalistes et vous avez les trois corps majeurs de ce qu’une démocratie peut avoir de meilleur !
Or, comme le faisait remarquer Michel David dans l’entrevue, n’y a-t-il pas quelque chose de bizarre à ce que les députés sont payés plus que leurs homologues du ROC, en raflant au passage une augmentation de 30 % (auquel s’ajoute le remboursement de leurs dépenses) en une seule année, au nom d’un « rattrapage » discutable, alors que les enseignants, sont 20 000 $ en deçà de leurs collègues ontariens ? Pas de rattrapage pour eux ?
Franchement, la pénurie est chronique et massive dans cette profession, elle n’a vraiment pas besoin d’être davantage dépréciée. Les jeunes la boudent, j’en sais quelque chose… je sors d’un semestre à l’Université du Québec en Outaouais, où j’ai enseigné à la cohorte de 2e et 3e année de bac en éducation au secondaire. J’avais face à moi 14 étudiants. Est-ce suffisant pour assurer la relève ? Il n’est pas étonnant des étudiants de Cégep soit acceptés pour assurer la suppléance dans les écoles.
Et le lapin qu’a sorti le ministre de l’Éducation de son chapeau ces derniers jours, une somme forfaitaire et ponctuelle de 12 000 $ comme incitatif, pour empêcher les départs à la retraite cette année, arrive trop tard : les demandes de retraite ou l’attribution des postes ont déjà été faites par les centres de service scolaire.
De toute façon, ce ne peut être une solution, parce que la motivation à enseigner ne repose évidemment pas sur le salaire. Outre la passion de transmettre un savoir ou un savoir-faire et l’affection que l’on peut avoir pour ces humains en devenir, comptent également les conditions d’enseignement (la lourdeur de la tâche en termes d’heures, de nombre et de profil des élèves par classe) ou la formation continue librement choisie, autant de facteurs clefs. D’ailleurs ces éléments faisaient partie des exigences des syndicats enseignants. Elles sont minimales.
Bernard Drainville les a balayées du revers de la main dans sa « Réforme de la gouvernance scolaire » (ou Loi 23) en s’accaparant le pouvoir de décider lui-même de la formation nécessaire aux profs, en plus de reprendre le contrôle des centres de service et de s’assurer d’avoir toutes les données utiles pour mener ses politiques. Pas forcément un mal, ce dernier point, mais on voit mal en quoi cela va changer la donne dans les classes, ou mettre des enseignants formés et compétents dans les écoles, dans un système qui est jugé comme le plus inégalitaire au Canada…
Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois

Je sais que l’actualité de ces derniers jours a tourné — fort opportunément d’ailleurs pour les partis au pouvoir, tant au niveau provincial que fédéral — autour de l’immigration et de la langue, deux sujets qui touchent aisément la population, parce qu’ils ont quelque chose de concret, à défaut d’être vraiment palpables. Ils nous interpellent, pas vrai.
Et bien justement, ils ont occulté un autre enjeu, pourtant majeur, sur lequel le gouvernement caquiste doit rendre des comptes : la réponse à la crise climatique. Et plus spécifiquement son « plan pour une économie verte 2030 ». Pour commencer, le fait que l’environnement soit envisagé sous la seule perspective de l’économie en dit long sur la cécité idéologique (et scientifique) de notre société. Les enjeux sociaux (éducation, santé), économiques (industrialisation, investissements, revenus…), politiques et environnementaux sont interconnectés, mais pas pour François Legault.
D’ailleurs, parler de « plan », pour ce qui est au mieux une liste d’épicerie, est bien pompeux ; le premier ministre du Québec présente son rejeton comme « le plus ambitieux des soixante états et provinces d’Amérique du Nord », rien de moins ! Il est vrai que l’on ne peut taxer Legault d’inaction : certaines mesures sont bonifiées, variées et intéressantes, par exemple en matière de transition vers des emballages écoresponsables dans l’alimentation, de décarbonation des bâtiments ou de transport actif. Ses formules sont hyperboliques : le « réchauffement climatique [et non la crise] est le défi du XXIe siècle ». Mais franchement, ses actions ne sont pas à la hauteur.
Il table d’abord sur l’électrification grandissante du transport (individuel, scolaire, marchand), parce que nous avons évidemment l’hydroélectricité ! On sait bien que cette ressource est pour ainsi dire illimitée et peu chère. Or 1) elle a un coût financier et environnemental certain (2,1 cents/kWh à la production certes, mais surtout la destruction d’écosystèmes entiers) 2) si nous devions tous avoir un véhicule électrique, nos barrages électriques n’y suffiraient pas 3) le Québec achète au Labrador une énergie à un prix honteux — 0,25 cent/kWh — qui ne peut qu’augmenter dans les années à venir. Dans la pensée un peu simpliste de la CAQ, cette source d’énergie renouvelable et peu polluante serait la solution magique à tout… ou presque.
Pour le reste, on peut compter sur les progrès technologiques. C’est certain, on va régler avec la technologie les problèmes de l’érosion des berges, des vagues de chaleur, de la gestion des déchets, du gaspillage éhonté de l’eau douce, de la pollution de l’air, de l’eau et des sols, de la multiplication des inondations monstres et des grands incendies, ou de la multiplication des problèmes de santé respiratoires. Dans mon univers un peu rationnel et critique, on appelle cela la pensée magique. Comment un gouvernement qui se dit pragmatique, près de la réalité des gens, peut-il afficher une telle ignorance, une telle déconnexion ?
Il n’y a dans son action aucune vision cohérente et globale, véritablement informée et stratégique sur la crise climatique. Les mots de François Legault sont contredits par les actes de ses ministres, à commencer par le peu d’argent qu’il prévoit de donner aux municipalités, pourtant en première ligne, quand il s’agit des conséquences concrètes et quotidiennes du dérèglement climatique. 850 millions de dollars sur cinq années, au lieu des 2 milliards réclamés. C’est ce que notre avenir vaut pour la CAQ.
Éditoriaux d'avril
Libres de circuler… et d’en mourir

Comment ne pas être touché-e par le drame mortel survenu sur le territoire Mohawk d’Akwesasne ? Bien sûr, plusieurs questions s’ensuivent : que faisaient là ces deux familles à vouloir traverser le Saint-Laurent ? Qui les accompagnait ? Et pourquoi ? Y avait-il quelque chose à faire pour éviter leur mort ? Les lois en vigueur suffisent-elles ? Est-ce un problème de moyens donnés aux autorités, en particulier à la police autochtone ?
Intéressons-nous aux humains. À ce qui fait qu’un individu est prêt à risquer sa vie, et celle de ses proches — pour aller ailleurs. Je réponds souvent aux gens qui s’étonnent que j’aie quitté le sud-ouest de la France pour le Canada : « L’herbe est plus verte chez le voisin ». Même si cela est fondamentalement vrai, c’est insuffisant pour répondre complètement à la question. Quelle que soit la motivation des émigrants/immigrants — que l’on ne peut juger tant c’est intime — il faut comprendre que, parfois, n’importe quel ailleurs est mieux que ce que l’on connait. Et se déplacer, ce que l’on appelle la « liberté de circulation » est un droit humain fondamental : « Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays » (Déclaration universelle des droits de l’homme, article 13).
Cependant, pour la majorité des états dans le monde, cela ne signifie pas pour autant entrer et sortir — et même séjourner — sans contrôle. Bref, nous avons le droit d’émigrer en général, mais pas celui d’immigrer ! Ce qui paraît un peu contradictoire, mais explique tant de situations problématiques que nous vivons aujourd’hui.
Au bout de cette logique, un constat implacable : nous ne sommes absolument pas égaux au regard du droit à la liberté de circulation ; cela dépend de trop nombreux facteurs, comme le pays de naissance, la nationalité, les législations et autres privilèges. En effet, les ressortissants titulaires d’un diplôme supérieur des pays du sud émigrent davantage. En Afrique subsaharienne, ils ont 37 fois plus de chances de s’expatrier, en raison de politiques d’immigration sélectives des pays du nord global. Pour venir au Québec, plus tu as de diplômes et d’années universitaires, plus tu as de points, ce qui peut te permettre d’obtenir le certificat de sélection du Québec plus facilement…
Toutefois, bien souvent, on ne reconnait pas tes formations. Donc tu as deux options : prendre un boulot alimentaire pour payer ton loyer et faire vivre ta famille ou avoir assez de fonds pour reprendre des études à zéro, quels que soient ton expérience et ton niveau de qualification ! Imaginez le gâchis. Parallèlement, si tu viens d’un pays tel que l’Afghanistan, alors tu peux voyager dans 4 pays dans le monde (sur 195) sans visa, contre 128 si tu es français. C’est à peine mieux pour les Africains, encore une fois.
Et pour finir, quand on ne construit pas de murs — pas seulement aux États-Unis — pour empêcher les demandes d’asile, que l’on n’installe pas de barbelés ou que l’on ne ferme pas les chemins, on utilise les barrières naturelles (montagnes, fleuves…) ; forçant des hommes, des femmes et des enfants, qui ne font que fuir la pauvreté, la faim, les conflits armés et autres maux, à effectuer des voyages plus dangereux, par des voies détournées. 5000 à 8000 personnes en meurent chaque année. Auxquelles, on peut en ajouter maintenant 8.
Libres de circuler… et d’en mourir

Les boîtes de dialogue comme ChatGPT, un programme de traitement du langage naturel développé par OpenAI, ont suscité un intérêt croissant ces dernières années. En effet, ces outils permettent de générer des réponses automatisées à partir de questions posées en langage naturel, offrant ainsi une expérience de conversation virtuelle avec des machines.
Cependant, malgré leur popularité, les boîtes de dialogue automatisées comme ChatGPT ne sont pas exemptes de critiques. Tout d'abord, certains experts en intelligence artificielle soulignent que ces outils peuvent perpétuer des préjugés et des stéréotypes sexistes, racistes ou discriminatoires. En effet, les algorithmes utilisés pour entraîner ces modèles de langage peuvent être biaisés en raison des données d'entraînement utilisées, qui peuvent refléter les préjugés et les normes de la société dans laquelle ils ont été créés.
En outre, les boîtes de dialogue automatisées peuvent avoir des réponses incohérentes ou inappropriées, ce qui peut entraîner une frustration pour l'utilisateur. Par exemple, si un utilisateur demande à ChatGPT une information erronée, la réponse peut être inexacte ou même fausse, ce qui peut entraîner une confusion ou une perte de confiance dans le système.
De plus, certaines personnes estiment que l'utilisation de boîtes de dialogue automatisées peut conduire à une déshumanisation de la communication. En effet, l'utilisation de machines pour interagir avec les gens peut réduire la qualité de la communication et de l'interaction sociale. Les machines peuvent manquer de la subtilité et de la nuance des interactions humaines, qui sont importantes pour comprendre les émotions et les sentiments des autres.
Malgré ces critiques, les boîtes de dialogue automatisées comme ChatGPT continuent de gagner en popularité en raison de leur commodité et de leur accessibilité. Les entreprises utilisent de plus en plus ces outils pour interagir avec leurs clients, ce qui peut améliorer l'efficacité et la satisfaction des clients.
Cependant, il est important de reconnaître les limites de ces outils et de les utiliser de manière responsable. Les entreprises doivent s'assurer que les données d'entraînement utilisées pour les modèles de langage sont exemptes de biais et de stéréotypes, et elles doivent surveiller attentivement les réponses générées par les boîtes de dialogue pour éviter les incohérences ou les réponses inappropriées.
En outre, les boîtes de dialogue automatisées ne doivent pas être utilisées comme un substitut complet aux interactions humaines. Les interactions humaines sont importantes pour établir des relations, pour comprendre les émotions et les sentiments des autres, et pour construire une confiance mutuelle. Les machines peuvent aider à compléter les interactions humaines, mais elles ne peuvent pas les remplacer complètement.
En somme, les boîtes de dialogue automatisées comme ChatGPT ont le potentiel d'améliorer l'efficacité et la satisfaction des clients, mais elles ne sont pas sans critiques. Il est important de reconnaître les limites de ces outils et de les utiliser de manière responsable, en complément des interactions humaines plutôt qu'en remplacement complet.
Nombre de mots : 470
Temps de rédaction : environ 30 secondes
Signé : Chatbox
Libres de circuler… et d’en mourir

Je sais, le mot n’existe pas… mais convenez qu’il faudrait l’inventer. Après tout, le terme « progressisme » existe bel et bien, lui ! Je plaide souvent pour éviter de nous comparer aux États-Unis. En effet, même si nous sommes nord-américains, avec un mode de vie comparable, nos valeurs sont, je crois, différentes — résultat d’une histoire et d’un substrat culturel distincts — à fortiori en tant que francophones.
C’est vrai en général, mais là, j’ai un doute. Le virage à droite qui me préoccupe est insidieux, mais bien réel, et on le retrouve à l’échelle internationale. Il a déjà une influence chez nous, quand on voit l’émergence d’Éric Duhaime et la montée en puissance au fédéral de Pierre Poilièvre. Tous deux ont fait leur la célèbre maxime du journaliste français Léon Zitrone, qui a formulé une tactique aussi vieille que l’humanité : « Qu’on parle de moi en bien ou en mal, peu importe ! L’essentiel, c’est qu’on parle de moi. ». J’ose espérer que leurs sorties respectives ne sont pas plus que cela, parce s’ils croient vraiment aux âneries qu’ils profèrent…
Juste pour n’en citer qu’une du chef du Parti conservateur du Canada (PCC) : il voudrait que CBC soit désignée par twitter comme un « média financé par le gouvernement » (au même titre que Russia Today en Russie ou China Xinhua News en Chine), parce qu’il faudrait « protéger les Canadiens contre la désinformation et la manipulation des médias d’état ». La radiotélévision publique au Canada, est financée en — petite - partie par le gouvernement certes, mais ce dernier ne peut intervenir dans le contenu éditorial et la liberté d’expression est respectée ici globalement, faut pas rigoler !
Ce genre de remarques, qui nous ferait retourner au siècle dernier, n’est que la partie émergée d’un iceberg idéologique qui s’étend de plus en plus sur le continent. Pensez aux dernières remarques d’Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec. Sa pétition pour interdire les dotations aux activités de lecture dans les bibliothèques du Québec par des drag-queens au prétexte que… Que quoi ? Qu’elles « vont commencer à essayer de transformer les enfants en « wokes » ? Une drag-queen n’est rien d’autre qu’un homme qui se déguise en caricature de « femme » ; rien de plus « straight » en fait. Comme l’homosexualité, ce n’est pas une maladie virale ! La semaine précédente, il se disait opposé à ce que l’état règlemente le travail des enfants. Ben oui ! Faisons confiance aux parents pour les mettre au turbin à n’importe quel âge ! Comme dans les mines de charbon du XIXe siècle, avant que les luttes syndicales ramènent peu à peu l’âge de l’éducation obligatoire à un niveau acceptable, du moins en Europe, parce qu’ici, faire travailler les enfants au lieu de les éduquer ne semble choquer personne. Pour ne pas « faire mon Français », un exemple venu du Royaume-Uni : le travail des enfants de moins en 11 ans y a été interdit en 1891 ! Avec Duhaime, on serait à peine mieux, c’est dire !
Et chez nos voisins, après la Floride, c’est maintenant au tour du Mississippi, du Texas, de la Pennsylvanie et du Tennessee : après la remise en cause du droit à l’avortement, on s’attaque au contenu des bibliothèques publiques, en censurant par la loi les publications qui parlent d’homosexualité, de diversité de genres, de racisme ou de dictature. Un avis là-dessus messieurs Duhaime et Poilièvre ?
La rivière à moitié pleine… Ou à moitié vide

Il y a bien des manières de considérer les choses, certaines plus optimistes… et valables, si la perception qui les commande est de bonne foi, sans cynisme ou duperie. Le problème est de savoir 1) si ces considérations améliorent la situation 2) si elles n’empêchent pas en réalité toute prise de conscience et donc toute action positive qui devrait être menée. Comment le savoir quand on entend les déclarations de nos gouvernements, et qu’on les compare aux chiffres et aux mesures écologiques concrètes qu’ils ont prises. Certains diraient justement : tout dépend de la perspective.
Par exemple, à l’échelle provinciale, le Québec a mis en place une « bourse » du carbone ; il a donc mis un prix sur la tonne de CO2 produite, obligeant ainsi les entreprises qui en produisent à payer un montant compensatoire. Et bien, les trains et les autobus interrégionaux, pourtant moins polluants, doivent s’y plier, mais pas les avions voyageant à l’intérieur de la province ! Et puis où vont les revenus de cette opération ? Je ne parle même pas des moyens de transport à l’échelle du Canada.
Tiens, tant que nous y sommes, les dernières sorties de notre vert de plus en plus pâle ministre de l’Environnement, Steven Guilbault, sont savoureuses. La plus grosse ? Suite à la promesse de son maitre de planter 2 milliards d’arbres d’ici 2031, le résultat : 16,6 millions d’arbres ont été plantés en deux ans ! C’est pas mal, pourrait-on dire… En fait, le gouvernement libéral planifiait en planter 60 millions l’année dernière, mais de toute façon, cela ne constitue que 2,3 % de l’ensemble !
Comme nos rivières, dans le genre de La Romaine, un autre verre à moitié plein : les libéraux de Trudeau ont mis fin au projet de GNL Québec pour des raisons environnementales, mais continue de soutenir le projet controversé LNG Canada, un autre projet d’exportation de gaz naturel liquéfié en cours de construction en Colombie-Britannique. Ajoutez-y un projet Bay du Nord au large de terre-neuve, qui doit prévoit 300 millions de barils de pétrole. Et pour épicer le tout, le rapport du commissaire fédéral à l’environnement et au développement durable. Jerry V. DeMarco a déclaré que les politiques fédérales, « c’est une série d’échecs depuis 30 ans », en mettant en doute le réalisme de plusieurs promesses libérales. Chrétien, Martin, Harper, Trudeau, même méthode : beaucoup de belles paroles, d’engagements, de mots, de plans, peu d’actions concrètes. Mais pour Steven Guilbeault, « le plan fonctionne », les GES ont baissé entre 2019 et 2021… Oui, vous savez, pendant la pandémie qui vous a forcé à rester chez vous ! En fait, elles ont même augmenté entre 2020 et 2021.
À plus large échelle – rions jaune - nous pourrions même nous féliciter que la guerre en Ukraine pousse de nombreux pays vers la transition écologique et les sources d’énergies renouvelables. Cependant, combien de pays ont argué de l’urgence de combler leurs besoins énergétiques en relançant qui le nucléaire (le Japon, la France, la Belgique ou l’Allemagne) qui les centrales au charbon (la Chine, les États0unis, la Pologne, l’Australie, le Mexique, la Turquie et le Japon) ! Se pose-t-on les mêmes questions lorsque le niveau de nos rivières monte au point d’inonder nos maisons? Stoppons le règne des demi-mesures et faisons face à la crise climatique !
Éditoriaux de mars
La colère est mauvaise conseillère

Je vous l’avoue, si j’avais pu insulter l’un-e de nos éminent-e-s politicien-ne-s, tous partis confondu (ou presque), mais surtout ceux du Parti libéral du Canada, je l’aurais fait et assez méchamment. Je me suis calmé. Mais à peine, parce que chaque fois que je retombe sur le chiffre, j’enrage à nouveau.
40 milliards d’investissements dans l’exploitation des énergies fossiles au Canada en 2023. Comment peut-on laisser faire ça ? Au moment où l’on peine à recruter des infirmières et des enseignants, ou du personnel dans quantité de secteurs. Au moment où il y aurait tant de domaines dans lesquels s'engager et qui créent aussi de l’emploi. Au moment où de plus en plus de gens en arrachent et sont réduits à faire appel aux banques alimentaires ou ne trouvent pas de logement abordable.
D’ailleurs, qui injecte cet argent ? Nos institutions financières, en plaçant notre épargne ? Nos gouvernements, en utilisant nos impôts ? Des compagnies privées ou des particuliers pleins aux as ? Je croyais qu’il n’y avait pas d’argent, que la croissance était en panne ! En tout cas pour les bonnes raisons, visiblement. En ce qui concerne les banques, parlez-en entre quatre yeux à votre conseiller financier : qu’il supprime de votre panier d’actions les investissements juteux sous peine de perdre un-e client-e fidèle. Pour ce qui est du gouvernement, la riposte est claire : arrêtons de voter pour ces pantins de la grosse industrie et des grands intérêts financiers. Tout simplement. Notez bien que Guilbault et Trudeau ont promis d’arrêter toute subvention en 2023, mais pour l’instant, rien ne se passe… Ah, j’oubliais les pleins aux as : mettons un plafond aux salaires comme il existe un plancher ; imposons leurs investissements et patrimoines : s’ils peuvent avoir deux voitures, deux maisons et partir en congé quatre fois l’année, c’est bien assez, non ?
Mon discours parait populiste, anti-élite. Certains rétorqueraient que je fais même partie de cette élite. Et bien non, parce que 1) je ne cherche pas à flatter qui que ce soit dans le sens du poil, je n’y ai aucun intérêt de toute façon 2) mon mode de vie est celui de la classe moyenne, rien de plus, même si mon revenu me permettait des dépenses plus extravagantes. Bref, je n’ai aucun désir ou ambition de richesse, mon compas moral est au bon endroit, rassurez-vous.
Et sur le fond, vous savez que j’ai raison. L’un des nombreux exemples d’hypocrisie et de manque de leadership criant des libéraux, c’est le projet Bay du Nord, porté par le géant Equinor, au large de Terre-neuve. Mise en exploitation déjà prévue en 2028… « Sous réserve de certaines conditions environnementales », nous serine le vert pâle Guilbault, en précisant d’un même souffle que le projet devra être carboneutre d’ici 2050. Tu vérifieras ça depuis ta maison de retraite, Steven ? Et c’est promis, il n’y aura pas d’impacts environnementaux négatifs importants… Ben oui, c’est vrai, le pétrole ne produit pas de GES lorsqu’il sert de combustible ! Selon vous, qui engrangera les bénéfices finalement, nous ou l’entreprise norvégienne ? Et qui paiera pour les dégâts irrémédiables sur l’environnement, pendant et une fois l’exploitation terminée ? L’ordre du jour est clair pourtant, bande de sans-dessein: « Le monde doit abandonner les combustibles fossiles le plus rapidement possible ». Et ceci n’est qu’un exemple parmi d’autres. Vous voyez, je ne me suis même pas énervé.
Équité linguistique, pas égalité

La semaine dernière encore, je lisais dans le Bulletin cette lettre en pleine page sur deux colonnes de la part de la Task Force on Linguistic Policy. S’il est vrai que la question de l’ingérence chinoise est l’actualité du moment, et que nous devrions nous sentir concernés (truquage des résultats des dernières élections, accès à nos données personnelles par Tik Tok), se joue en ce moment une partie d’échecs cruciale pour notre avenir en tant que pays bilingue, un trait essentiel à notre identité profonde en tant que Canadien, selon les libéraux eux-mêmes.
Or, comme d’habitude, ceux que l’on entend (ou lit) le plus sont souvent les extrémistes, en l’occurrence certains groupes de pression anglo-québécois. Déjà, le fait que leur lettre soit uniquement en anglais montre le peu de cas qu’ils font du bilinguisme ; et puis leur nom, qui est une sorte d’appel à la guerre, confirme l’exagération permanente dans laquelle ils drapent leur propos, ne serait-ce qu’en déclarant que la loi fédérale C13 (sur la modernisation de la loi sur les langues officielles du Canada) est le « précurseur de l’indépendance du Québec et la fin du Canada tel que nous le connaissons » (traduction libre).
Mais n’importe quoi ! Je le sais, vous le savez, nous le savons tous : les Québécois ont passé leur tour historique pour l’indépendance ; pour en être certain, demandez-leur ! Et de quel Canada parle-t-on ici ? Parce que le gros argument de nos compatriotes anglophones est que cette loi ne traite pas également les deux langues officielles… Évidemment ! Dans les faits, les deux langues ne sont pas à égalité, ni à petite échelle (au Québec) et encore moins à grande échelle (continentale). L’égalité suppose une absence de discrimination ; l’équité, d’attribuer à chacun ce qui lui est dû. Que fait-on quand une minorité est historiquement et culturellement lésée ? On lui confère certains avantages (quota, réglementation spécifique, budget, etc.) afin de rétablir l’équilibre. Ce que ces mêmes groupes de pression réclament, en arguant faussement qu’ils défendent les minorités ethniques — comme si tous les immigrants qui arrivent au Québec étaient de facto anglophones ! — pourquoi ne pas l’appliquer au français ? Surtout si l’on considère son statut réel dans la société nord-américaine. Cela s’appelle l’équité.
De plus, les cris d’orfraie qu’elle pousse nous en rappelle d’autres. Elle suggère qu’elle a peut-être été à l’origine des lois passées à partir de 1969 pour la reconnaissance du bilinguisme, ce qui, au passage, n’est pas comme reconnaitre le « fait français ». Mais qu’en disait à l’époque les Anglo-québécois ? Immigrants ou pas, ils parlaient du droit de choisir, surtout, en général, l’anglais ; 20 000 personnes manifestaient déjà devant le parlement en 1969 contre la loi sur le bilinguisme. Et à propos de la loi 101, sans laquelle le français aurait disparu du paysage ? Opposition systématique : opposition en 1974, lors du vote de la loi sur le français comme la langue officielle ; opposition via la Cour suprême en 1979 ; en 1982, via la loi sur langues officielles ; en 1988 sur l’affichage ; en 2010 sur les écoles passerelles… Années après année, toutes ces actions réduisent les droits linguistiques fraichement acquis pour protéger le français. Faut-il rappeler que les communautés québécoises d’expression anglaise, elles, contrairement aux minorités francophones du ROC, ont parfaitement accès aux services d’éducation ou de santé dans leur langue ?
Élargissons le « cercle des initiés »!

Cette année 2023 restera dans les annales de l’Académie française : le grand écrivain d’origine péruvienne Mario Vargas Llosa y a été reçu, tout comme l’avait été Dany Laferrière il y a dix ans. Mais entre eux, une grosse différence. Même s’il parle et comprend très bien le français, le premier n’a jamais publié une seule ligne dans cette langue. Cela peut nous interpeler sur le statut actuel du français dans le monde, alors qu’est célébrée la Journée internationale de la francophonie au moment où j’écris ces lignes.
Se bat-on encore pour elle et donc pour une certaine vision des choses, pour une perspective distincte de celle de l’anglais ? Parce que, ne nous y trompons pas, une langue est autant un outil de simple communication qu’un moyen de considérer le monde qui nous entoure selon un certain point de vue ; les langues expriment une pluralité de perspectives.
Je ne reviendrais pas sur les luttes des francophones et des francophiles pour la survie du français ici, en Amérique du Nord, au Canada, au Québec et même en Outaouais, j’y ai déjà consacré plusieurs éditoriaux. Voyons plus large, au moment où vient d’ouvrir en grande pompe la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, en France. Avec 320 millions de locuteurs comme langue maternelle ou d’adoption, le français reste statistiquement en bonne position dans les années à venir, compte tenu de la croissance démographique dans les Afriques, qui en compose déjà plus de la moitié.
Toutefois, après le Rwanda, qui a opté pour l’anglais comme langue officielle et qui s'est retiré de l'OIF, le Gabon et le Bénin qui ont adhéré en 2022 au Commonwealth, voici plus récemment la Roumanie et le Liban qui tournent le dos à la Francophonie. Ajoutez-y le rejet — politique, cette fois-ci — de l’aide française par les états de la région du Sahel pour lutter contre le terrorisme islamiste… et l’Algérie, qui cloue le cercueil en conseillant d’enseigner désormais à tous les niveaux scolaires exclusivement en arabe, et le portrait est plus sombre.
Il est compréhensible que les anciennes colonies françaises se détournent de la francophonie, ou même qu’elles cherchent à s’allier à d’autres « blocs » en matière économique. Personne ne dira le contraire. Cependant, le français est malmené, en grande partie à cause de l’attraction de l’anglais, certes pratique en maintes occasions, mais pas nécessaire en tout temps. En France, et dans les pays où il a le statut de seule langue officielle, le français ploie sous le poids de l’anglomanie. Peut-être cela constitue-t-il un progrès, sinon une tendance normale, dans l’évolution d’une grande langue vivante : elle s’adapte pour survivre ?
Au-delà de ce constat, la question se pose cependant : quelles références culturelles habitent aujourd’hui l’esprit, l’imagination, l’âme des francophones autour du monde ? Quel écho trouve le français dans nos cœurs ? Le français reste-t-il encore ce vecteur incroyable pour accéder à a culture, à la littérature universelle de Rabelais, Molière, Voltaire, Hugo, Miron, Senghor ou Camus ? Ces auteurs restent encore les plus traduits en dehors de la francosphère. L’enjeu est là, il est crucial. En musique, dans le cinéma, les arts de la scène, le français, je crois, le français survit grâce à une relève venue de partout dans le monde… Mais à quel prix et jusqu’à quand ?
Un toit sur la tête

Parfois, je me demande sur quoi nos gouvernements fondent leurs priorités, que ce soit à l’échelle municipale, provinciale ou nationale. Pour ce qui est des priorités internationales, je crois que, malheureusement, elles sont très (trop) claires : les multiples crises humanitaires du moment — mais c’est chronique — nous ramènent sans cesse à des besoins fondamentaux. Maslow illustre ces derniers par sa fameuse pyramide ; à la base, on y trouve les besoins physiologiques : la respiration, la nourriture, l’eau, le sexe, le sommeil, l’homéostase et l’excrétion ; en second, ce qui a trait à la sécurité, notamment du corps, de la famille, de la santé et de la propriété. Avoir un toit au-dessus de sa tête est la condition sine qua non à plusieurs de ces nécessités-là évidemment. C’est pourquoi l’ONU finance des constructions de camps (à court terme) ou de logements en dur (à plus long terme) à travers ses agences et programmes. Des logements abordables, cela va sans dire.
Alors, quand on voit des chefs d’État se rencontrer autour de sujets aussi « importants » qu’empêcher des personnes de s’établir au Canada, des familles qui rêvent simplement de pouvoir vivre en paix et en sécurité et qui ne sont un danger pour une personne, on ne peut que se poser des questions… À l’échelle provinciale, la mesure phare de Legault est quand même « les plus importantes baisses d’impôts de l’histoire du Québec » : 1 % aux deux premières tranches d’imposition. Comme si cela était un objectif en soi et une tare de la société québécoise ! Ce qui est certain, c’est que l’une des choses le plus faciles et rapides à faire… Coût : 1,7 milliard. Surtout, en ponctionnant le fonds des générations qui, comme son nom l’indique, est un legs aux générations futures. Gain : 128 $ dollars pour un foyer de la première tranche, une fois, cette année. On y ajoutera un crédit d’impôt pour la solidarité pour les personnes qui ne vivent pas dans un logement subventionné. Sera-ce suffisant pour permettre aux gens de répondre aux dits besoins essentiels, qui, eux, sont à long terme ? Une meilleure éducation pour leurs enfants ? Un panier d’épicerie plus abordable ? Un accès à un médecin ? À un logement à coût abordable ? Poser la question, c’est y répondre. Franchement, parler d’une promesse tenue, c’est pas de la démagogie ?
Plus précisément, sur la question du logement, la CAQ avait annoncé en campagne la construction de plus de 11 000 logements sociaux ! Attention, je ne parle pas de la construction d’habitations en général, mais bel et bien de résidences, d’appartements ou de maisons abordables. A-bor-da-bles. Bien sûr que les entrepreneurs bâtissent, mais pas à des prix accessibles ! Le budget Girard de 2023 en prévoit à peine 1000 par an pendant 5 ans ! C’est une promesse brisée. Avouons par ailleurs que réglementer l’hébergement touristique style Airbnb, en obligeant les propriétaires à posséder un numéro d’immatriculation de la corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ), pourrait aboutir à la mise en marché de ces logements, peut-être à des prix abordables… Cependant 1) ce n’est pas l’objectif du gouvernement, mais plutôt un avantage collatéral 2) les résultats sont largement incertains. Tous les acteurs du secteur sont largement d’accord : le gouvernement Legault est en mode rattrapage, et vient tout simplement de signer la mort du logement social.
Éditoriaux de février

Faire passer l’âge de la retraite à 64 ans, c’est de la rigolade, ici, au Québec. En effet, il est actuellement de 65 ans (61 ans en Suède, 68 au Portugal). Cependant, le débat qui fait rage en France cache au moins deux aspects problématiques et cruciaux de notre existence.
Le premier enjeu provient d’un fait simple, clair, indiscutable : notre économie comporte de moins en moins d’« actifs » et de plus en plus de retraités. Donc, de moins en moins de personnes payent les cotisations sociales, alors que de plus en plus de personnes qui en dépendent. C’est le fameux système par répartition… qui ne répartit plus. Et malheureusement ni la natalité ni l’immigration, toutes les deux trop faibles, ne pourront inverser l’inéluctable conclusion. Pire, demandez à vos filles, petites-filles, cousines, sœur, etc. : Vous allez vous apercevoir qu’elles n’ont pas l’intention de rajouter un autre humain au tableau catastrophiste actuel et à venir. On dirait aussi qu’avoir un enfant est devenu pour beaucoup une véritable charge physique et mentale, voire une fonction bassement reproductrice qui aliènerait la femme pour d’autres. Après la naissance, on se charge d’ailleurs vite de trouver au dit humain une pathologie : TDAH en série et autres troubles du langage ou de l’apprentissage font de l’éducation un véritable parcours du combattant… Et puis, une fois adulte, pourquoi s’embarrasser d’un tel fardeau si l’on veut poursuivre des études, s’investir à 100 % dans son travail, partir dans le sud, avoir du fun avec les chums, bref vivre sa vie ? Enfin, un enfant, ça pollue, non ?
Le deuxième enjeu découle de notre conception « moderne » de l’activité, terme ici synonyme de travail rémunéré (et imposé) au sein d’une structure privée ou publique, individuelle ou collective. Alors, déjà, le terme — tripallium — signifie étymologiquement « torture », et il faut avouer qu’il est souvent synonyme d’ennui et de souffrance pour plusieurs d’entre nous. Ce n’est pas bon signe… de là à penser que prendre sa retraite équivaut à arrêter la torture. Mais pourquoi ne peut-on imaginer un autre fonctionnement socio-économique, où un citoyen ne serait pas mis au rencart, au ban de la société, mais son expérience valorisée, rémunérée ? Où le volume de travail serait partagé et une somme décente pour vivre serait versée à tous, alors que l’évolution technologique permet une meilleure productivité et que de la richesse est créée ? À nous de mieux la partager.
Parce que les faits historiques ont la tête dure : depuis 150 ans, on travaille moins et on produit plus et mieux, même si nos décideurs continuent de nous seriner encore que le travail, c’est la santé, tout au moins économique, qu’il faut travailler plus et plus longtemps, au nom de la performance et de la compétition, mais également du pouvoir d’achat et de la consommation. Leur credo : maintenir le taux de croissance, produire de la richesse ! On doit se rappeler que plusieurs meurent avant la retraite, que la moitié d’entre nous développent des maladies ou des douleurs chroniques… Alors, oui, l’espérance de vie augmente, mais pas forcément la bonne santé. On ne se pose pas trop non plus la question du partage de cette richesse, de l’abordabilité des biens et services. Doit-on continuer de produire sur le même modèle qui nous a conduits au pied du mur climatique ?

Vu d’ici, en Amérique du Nord, continent qui n’a pas connu la guerre sur son territoire depuis bien longtemps, les conflits armés à l’étranger restent toujours loin psychologiquement, un peu abstrait. Bien sûr, certains ont perdu un membre de leur famille au cours du XXe siècle, pendant la Première, la Seconde Guerre mondiale, en Corée ou plus récemment au Moyen-Orient, mais ce danger n’a jamais été vraiment à nos frontières… Il n’est pas proche et n’a pas les relents de ce que l’Europe a vécu comme tragédies lors des deux grandes guerres.
Ainsi, malgré le danger évident que constitue la Russie (j’ai failli écrire l’URSS !), les puissances occidentales ont voulu ménager la chèvre et le chou, maintenir un semblant de non-ingérence armée tout en fournissant des armes aux Ukrainiens. Entre parenthèses, les pays « non occidentaux » oscillent entre l’indifférence et la sympathie envers les Russes, mais montrent rarement de la sympathie envers les Européens. Cela semble compréhensible, compte tenu du passif colonial et impérialiste des dits pays. Et puis quel impact l’« opération militaire » (dixit Poutine) en Ukraine peut-elle avoir sur les Pays du sud qui détériore leur situation ? Presque rien si ce n’est augmenter les prix de certaines céréales à la base de leur panier alimentaire ; déstabiliser les cours du pétrole, donc de l’énergie ; accaparer toute l’attention et l’argent de nations, grandes financières des fonds internationaux ; donner la part belle à de nouvelles dictatures impérialistes (Turquie, Chine), en laissant dans l’ombre d’autres conflits ou crises alimentaires, sanitaires, politiques qui font des ravages. Une broutille, donc.
Et voilà ti pas que l’alliance plus ou moins formelle bâtie autour de l’OTAN, déjà un fossile datant de la guerre froide contre le bloc communiste, monte la barre un peu plus haut. Jusqu’à maintenant, personne n’était dupe, mais tout le monde faisait semblant. Les missiles, batteries antiaériennes, canons, et autres équipements — y compris roulants — n’étaient soi-disant que « défensifs », donc « inoffensifs » officiellement, et le front anti-Poutine pouvait se déclarer hypocritement non-belligérant.
Or, une arme défensive n’existe pas. Mais en plus, désormais, l’Allemagne, en faisant le pas décisif et historique d’autoriser l’envoi de ses chars d’assaut Léopard à l’Ukraine, pire, en choisissant d’en céder elle-même un certain nombre, arrache le voile de la fausse pudeur occidentale. Non seulement la patrie du Nazisme a-t-elle repris du service par le changement radical de sa politique étrangère, mais c’est pour attaquer un ancien Grand Ennemi historique. Figurez-vous qu’un tank, c’est un « panzer » en allemand. Ça ne vous rappelle rien de vos cours d’histoire sur la guerre 39-45 ? Si vous vous en souvenez, imaginez les Russes !
D’ailleurs, Poutine, qui avait déjà averti que certaines limites ne pouvaient être dépassées, n’a pas tardé à déclarer que cette décision était « extrêmement dangereuse [et allait] amener le conflit vers un nouveau niveau de confrontation ». Il pèse ses mots, le bonhomme, parce qu’il désire maintenir l’incertitude et l’imprévisibilité : une vieille tactique de guerre inspirée de Sun Tzu. On se demande maintenant jusqu’où il ira pour répondre aux désormais cobelligérants déclarés… Et vu le nombre de pays impliqués, on pourrait même se demander si ce conflit ne s’est pas transformé en troisième guerre mondiale qui ne voudrait pas se l’avouer. Quelle est la prochaine étape ? Les avions de combat et les missiles à longue portée, comme le réclame Zelenski depuis mercredi ? Et ensuite ?

La conjonction d’évènement est toute personnelle ; elle ne prétend à aucune objectivité. Toutefois, elle met en lumière l’une des angoisses les plus puissantes qui se puissent parmi les humains et qu’habituellement on refoule. La peur de perdre son enfant est évidemment une réaction instinctive de l’espèce qui refuse de s’éteindre, mais davantage également.
Dans nos sociétés du Nord global, l’enfant est à la fois adulé et haï. En effet, nous vivons dans un univers peuplé de parents « hélicoptères », toujours là autour de leur(s) petit(s), à les accompagner partout et en tout temps, à prévenir le moindre traumatisme - physique ou psychologique - à les surprotéger, quitte à leur laisser croire qu’ils sont les meilleurs, les plus intelligents. Nous vivons dans une société d’éducateurs (enseignants, entraineurs, etc.) dont l’objectif est de développer le potentiel — forcément exceptionnel — de leurs joueurs, de les faire progresser sans douleur, ni épreuve, ni échec (surtout) : tout le monde est bon, tout le monde a gagné… même après une défaite !
Parallèlement, jamais dans l’histoire de l’Humanité, nos jeunes adultes ont-ils moins exprimé le désir d’avoir des enfants, de perpétuer la lignée. L’individualisme exacerbé par une société de consommation et de divertissement, qui vise surtout à satisfaire nos moindres désirs personnels et nous fait prendre des vessies pour des lanternes, les distrait des vrais enjeux de notre temps. Pourquoi s’embarrasser d’un enfant, obstacle à un hédonisme sans frein ? Quel intérêt à grever son budget, à creuser son endettement ? L’horloge biologique ne joue plus. De surcroît, l’horizon qui se présente à notre relève est franchement déprimant : pandémies, guerres, crise de la démocratie, récession économique, sur fond de changements climatiques et d’inégalités flagrantes et grandissantes à tous les niveaux : qui voudrait offrir cela à des petits d’hommes et de femmes ?
Et puis surviennent des tragédies comme l’attaque à l’autobus d’une garderie à Laval, ou, à plus large échelle, les séismes en Turquie et en Syrie aux dizaines de milliers de morts (dont des milliers d’enfants). Et en ce qui me concerne, la disparition subite de l’un de mes anciens élèves (et joueur de tennis) à l’âge de 20 ans, mort d’une rupture d’anévrisme. La goutte de sang qui fait déborder le vase. Alors, on sent bizarre, tout pensif ; comme les autres, on est sonné, frappé dans sa chair, traumatisé. Ce qui ne nous empêche pas de tomber dans le sensationnalisme et le voyeurisme via les médias, dans la sensiblerie dégoulinante.
Il n’en demeure pas moins que le choc est justifié : il n’est pas dans l’ordre naturel des choses que les enfants meurent avant leurs parents. C’est une infraction incompréhensible aux règles de fonctionnement de notre existence et de la vie en général. Ces drames nous renvoient non seulement à ce que nous laisserons derrière nous, mais ils nous renvoient aussi à propre mort. Et c’est effrayant, n’est-ce pas ? Cependant, comme pour la perte d’un enfant, il n’y a pas d’explication… Un-e responsable ? Oui, certainement : le chauffeur d’autobus, la Nature… et quoi d’autre ? Pourquoi ici et maintenant ? Pourquoi un tel et pas tel autre ? On peut toujours lever les yeux aux ciels et invectiver Dieu ou toute autre puissance suprême, nos appels resteront toujours sans véritable réponse. Il n’y a pas de règles en la matière, il n’y a pas de justice.

Chaque année apporte de nouveaux scandales de violence dans le sport. Attention, je ne parle pas de la brutalité dans les sports eux-mêmes, qui n’est pas forcément un problème en soi, si elle est réglementée et que l’on s’assure de son respect. C’est de l’agressivité ou la « gnaque », nécessaire dans un sport individuel, collectif, sans contact ou avec contact… Mais on la canalise. C’est normal dans une certaine mesure ; même dans des pratiques récréatives, hors compétition, sans enjeu, on joue avec agressivité, et c’est ainsi que l’on peut se dépasser tout en s’amusant !
En revanche, la violence hors du terrain, dans les gradins, dans les vestiaires est inadmissible, a fortiori entre co-équipiers ou entre entraineurs et joueurs. Encore en 2023 ?
Nous avons la mémoire sir courte ? Rien qu’en 2021, le journal Le Monde rapportait que 445 personnes avaient été mises en cause dans le sport français : agents publics, professeurs d’éducation physique, éducateurs professionnels… au sein de 48 fédérations, avec dans la moitié des cas, des signalements dans le sport de haut niveau. Souvent sur des mineurs de moins de 15 ans. Ici, au Canada, récemment, en plus du hockey, nous avons eu le ski (suite au témoignage de Geneviève Simard) et la gymnastique (Gymnastique Canada est même poursuivie). Une enquête conjointe de Radio-Canada et CBC a révélé que pas moins de 340 entraineurs avaient été accusés de délits sexuels en 20 ans ; ils ont fait plus de 600 victimes !
Voilà pourquoi je suis indigné, mais moyennement étonné suite au jugement de la Cour supérieure de l’Ontario, dans le cadre d’une demande de recours collectif faite par trois hockeyeurs juniors. Au Québec, il existe un service d’écoute 24 heures sur 24 depuis 2018 ; les fédérations sont accompagnées afin d’élaborer des politiques de protection des athlètes, des codes de conduite et des campagnes de sensibilisation dans les villes ou sur les réseaux sociaux sont effectuées. Mais que faire quand la violence, l’abus physique ou psychologique, provient des pairs, d’autres joueurs, comme c’est systémiquement le cas dans le hockey junior majeur ? Parce que là, il s’agit de la culture propre à ce sport en particulier, « ça fait partie de la game » diraient certains.
Les enfants sont naturellement durs entre eux, depuis toujours (rappelez-vous votre enfance), mais l’encadrement de ces jeunes, les dirigeants de la fédération et probablement des parents ont minimisé et banalisé le harcèlement, le viol en réunion et d’autres actions infâmes. Il y a ici une culture du secret, dénoncée d’ailleurs depuis belle lurette par les chercheurs. Au nom de quoi ? La performance ? La victoire ou la carrière ? Ou peut-être même parce que pour certains parents, leur enfant constitue un investissement ? Une chose est claire : le changement ne viendra pas de l’intérieur.
Il y a pourtant maintes manières de développer le sentiment d’appartenance d’un individu à son équipe. Jouer, s’entrainer collectivement en est la base ; quand c'est compétitif, les matchs en sont un autre : on souffre ensemble, on sue sang et eau ensemble, on perd ou on gagne ensemble. Toute autre activité est en option et ne devrait jamais humilier qui que ce soit, de quelque façon que ce soit. Les violences sexuelles et la misogynie, en particulier dans le sport masculin, n’ont tout simplement pas lieu d’être !
Éditoriaux de janvier

Eau secours ! Allez, une bonne nouvelle pour commencer l’année ! Le ministre de l’Environnement du Québec, Benoit Charrette, veut augmenter « significativement » le prix de l’eau. Comment ça, vous dites-vous, je paye l'eau que je consomme, et elle va me coûter encore davantage ? Comme si la hausse du prix du carburant ne suffisait pas ! Rassurez-vous : la mesure ne nous concerne pas, nous les simples citoyens — c’est ça la bonne nouvelle — et en plus, étonnamment, les particuliers ne payent toujours pas l’eau, ici, au Canada !
Je dis étonnamment, parce que dans beaucoup d’autres pays, surtout en Europe (qui est en avance sur nous en termes d’écologie), l’eau a un prix ! Ce n’est pas pour rien que l’on parle de plus en plus de l’« or bleu »… Elle est précieuse, cette eau douce, encore plus vitale que l’autre, salée, qui constitue les océans et les mers… Et même si nous pourrions croire qu’il s’agit d’une ressource infinie — pas tout à fait synonyme de renouvelable — en regardant par la fenêtre la belle neige fraîche qui orne notre cour arrière, ce n’est pas si simple.
Déjà, les misérables 2,5 % d’eau douce que contient notre globe proviennent des lacs, des rivières, des glaciers et des nappes phréatiques. Or, cette eau se renouvelle, mais selon un cycle spécifique : évaporation, condensation, précipitations, infiltration, ruissellement, stagnation. Cette dernière qui garantit la qualité de l’eau, peut varier de 8 jours, si l’eau stagne dans l’atmosphère, à 2500 ans dans les océans, en passant par 17 ans dans les lacs. À une échelle locale, elle peut donc s’épuiser. D’autant plus, parce qu’elle est utilisée jusqu’à l’excès : pour boire, se laver, laver des bâtiments, des véhicules, des trottoirs (!!), refroidir les métaux dans la métallurgie, entrer dans la composition de multiples produits fabriqués par les entreprises, etc. D’ailleurs, c’est là qu’intervient la redevance caquiste qui, à date, se monte à 30 petits millions par an pour des centaines de milliards de litres d’eau prélevés par les compagnies québécoises.
De surcroît, il faut savoir que l’eau douce n’est pas répartie de manière égale sur la planète. Dix pays se partagent 60 % des précipitations ; plus de la moitié des habitants de l’Amérique latine, de l’Asie et de l’Afrique n’y ont pas accès, soit un être humain sur trois. Et cela va empirer dans les années à venir… Enfin, mon propos aujourd’hui était plutôt de rebondir sur les 25 ans du mouvement Eau secours (eausecours.org) pour aborder ce sujet crucial, soit en amont, lorsqu’il est question d’extraire une eau souvent contaminée par les produits phytosanitaires et autres arsenic utilisés dans le domaine agricole aussi bien que minier depuis un siècle ou de confier cela à des entreprises privées auxquelles cela ne coûte presque rien ; soit en aval, avec la problématique de la mise en bouteille, dans des contenants plastiques qui finissent dans les océans, les cours d’eau, la faune marine et en bout de chaîne alimentaire, qui nous empoisonne ou bien encore avec le problème de l’accès à la ressource pour vivre, tout simplement.
Cet enjeu local autant qu’international est plus que jamais d’actualité, il est majeur pour notre survie, et il est incroyable que l’on ait régressé depuis 1997… Il est inacceptable que cet élément essentiel à toute vie se dégrade ainsi et reste entre les mains d’intérêts privés !

Le constat est sans appel : la clientèle est de retour dans les gyms en ce mois de janvier 2023. Après les fermetures et les confinements de la pandémie, après une année de transition, 2021, marquée par la guerre en Ukraine, les ratés des chaines d’approvisionnement, l’inflation galopante, la pénurie de main-d’œuvre et l’intensification des « accidents » climatiques, je suis heureux de savoir qu’il y a dans nos existences une chose intangible, qui reste positive : l’envie (le besoin ?) de rester en forme, ou plutôt de ne pas prendre trop de formes. Rien de tel qu’une résolution de début d’année pour nous sentir vivant-e ! J’ironise, mais j’en ai moi-même pris ; cependant, rien de plus que de perdre les deux kilos que je gagne habituellement en avant l’été.
Mais la fréquentation à un niveau qui dépasse celui de 2019, est-ce réellement l’effet des multiples tourtières ayant conduit à ces fameuses « bonnes résolutions » du temps des fêtes ? C'est un véritable sujet de sociologie, que les économistes m’envient à coup sûr… Et oui, les salles d’entrainement sont plus occupées que jamais. Les sondeurs le confirment : faire de l’exercice constitue l’une des résolutions les plus communes chez les Québécois. On s’abonne, on s’achète l’« outfit » qui va bien, on chausse nos plus belles espadrilles, et zou ! Sur le tapis mécanique ! Han ! Que je te soulève de la fonte ! Bien qu’une majorité de ces zélés sportifs s’essouffle au bout de quelques semaines, il n’en reste pas moins que la tendance est lourde ces dernières décennies : nous sommes de plus en plus à « cultiver » notre corps sur une base régulière. Et ce n’est pas qu’une question de tactique, style « Mets tes séances à l’agenda, mais reste flexible », « Vas-y moins, mais régulièrement », « Suis un entrainement adapté avec un professionnel” ou “Fixe-toi un objectif concret, précis et à court terme”.
Au fond, au-delà de la perte de poids, du cardio ou du mieux-être (vivre en santé, une question de santé mentale aussi), cette fascination générale pour sculpter son corps (regardez les réseaux sociaux, les séries TV et les télé-réalités), associée à la marchandisation des services, répond à des motivations plus profondes… et désespérantes. Il s’agit du rapport entre notre enveloppe physique comme interface avec qui nous entoure. Une préoccupation qui existe depuis longtemps - sinon depuis toujours - dans nos sociétés : les Romains et les Grecs esthétisaient déjà le corps humain à travers la performance. Évidemment l’hygiénisme du XIXe siècle est passé par là ; aujourd’hui, on parle de saines habitudes de vie.
Surtout, alors que l’individualisme s’est imposé au fil du XXe siècle en tant que valeur cardinale, nous sommes sommés de nous bâtir une apparence de santé. À part que la maladie , la mort nous rattrapent quand elles veulent. En véritables entrepreneurs de nous-mêmes, après les rituels quasi religieux que nous suivons scrupuleusement, semaine après semaine, nous exerçons ainsi notre liberté, nous reprenons le pouvoir, nous nous sentons enfin exister ! Certains avancent l’hypothèse que la peur et l’incertitude de ces dernières décennies nous poussent davantage à trouver réconfort dans l’une des rares choses sur laquelle nous avons du pouvoir : notre corps. Notre corps comme ressource à transformer en capital existentiel, voilà la version moderne et narcissique de la nécessité d’exister !

On peut s’en lasser, c’est certain. Mais pour bon nombre de personnes, de familles telles que la mienne, on peut en être nostalgiques, croyez-moi. En effet, passer les célébrations de fin d’année (que ce soit pour les réveillons — de Noël ou du Nouvel An — ou pour les jours qui les suivent) loin de ses parents, cela n’est jamais facile. Que vous soyez immigrants, ou dans une famille dont les membres sont partis vivre ailleurs. Un ailleurs parfois sur un autre continent, au-delà des océans. Et le temps ne change rien à l’affaire : on a beau avoir de nombreux et nouveaux amis, des « parrains », « marraines », « grand-papa » ou « grand-maman » d’adoption dans notre nouveau chez nous, ils ne remplaceront jamais tout à fait la famille d’origine.
Pourtant, les repas des fêtes en famille, c’est quelque chose ! En plus, d’une véritable orgie de nourriture et de boissons — le plus souvent alcoolisées — c’est l’occasion de renouer des liens entre cousins, c’est un moment d’échange dans une bonne humeur un peu factice, mais qui fait du bien au cœur aussi. En tout cas, en général. Parce que ces événements annuels ne seraient pas ce qu’ils sont sans quelques bonnes conversations musclées. Par exemple, du côté de la famille de ma mère, ça ne manquait jamais : l’un de mes oncles, déjà fort en gueule en temps normal, devenait sous l’effet des nombreux verres (d’apéritif, le Pastis, et de vin — un vin différent à chaque plat ou service !), donc le frère de ma mère devenait alors un vrai tribun de la gauche française, prenant à partie quiconque soulevait un sourcil ou amorçait une phrase, même pour abonder dans son sens. Quand l’un de ses fils fut assez grand, ce fut avec lui qu’il échangea les pires insultes. Tout cela devant les yeux ébahis des plus jeunes. On finit par ne plus l’écouter.
Voilà un geste d’autodéfense que je vous suggère si par malchance, vous avez parmi vous un trublion de cet acabit. Ne nourrissez pas le feu, éloignez de lui tout carburant potentiel. En plus, nous vivons dans une époque de polarisation des opinions sur l’actualité, politique, sociale, économique, etc. J’ai parfois l’impression qu’à l’exception de la météo, il n’y a plus grand sujet de discussion qui puisse être abordé sans risquer un embrasement général ou des mots qui dépassent notre pensée et créent des schismes infranchissables. Et d’ailleurs, aujourd’hui, même le climat peut être l’objet de débats, pour si peu que l’on s’intéresse à ses causes… Il reste les enfants et les animaux domestiques, objets d’interminables descriptions et narrations assez consensuelles, il faut l’admettre.
Mais surtout, trouvez un cadre adéquat, sympa et convivial, peut-être en territoire neutre (pour calmer les esprits forts)… Et pourquoi pas un restaurant d’Aylmer, sur notre rue Principale, qui a tant souffert depuis le début de la pandémie ? Si vous pensez quelques instants à la rotation de commerces qui a lieu depuis 2 ans chez nous (et ailleurs), franchement, c’est affligeant ! Et plusieurs parmi ceux qui restent, surtout dans le domaine de la restauration, sont à la limite de lâcher… Que nous reste-t-il ? Alors, achetez local, mangez local, réservez tout de suite pour vos repas de fêtes dans l’un de nos restaurants, ici, à Aylmer… et passez de joyeuses fêtes de fin d’année !

J’aurais bien commencé l’année en abordant les perspectives pour les mois à venir… Mais l’actualité m’a rattrapé et ce début janvier est plutôt marqué par une immoralité latente. Je vais donc jouer au « père la pudeur », aussi grinçant et désagréable cela peut-il être.
Dès le 2 janvier, les 100 dirigeants d’entreprises les mieux payés au Canada avaient déjà touché au moins une année du salaire d’un-e Canadien-n-e moyen-n-e. Soit plus de 200 fois que ces travailleurs dont le revenu est autour de 53 000 $. En ce qui me concerne, j’en suis à gagner deux fois ce montant, et je suis « riche », objectivement et pour Revenu Canada : je me permets de ne pas vraiment regarder le prix des aliments à l’épicerie… Mais vous avez remarqué que j’ai employé le verbe « gagner », parce qu’en effet je travaille assez dur pour mériter ce salaire. Quid de ces grands patrons, dont le quotidien consiste à participer à des conseils d’administration, « impulser les politiques » de leur groupe ou « avoir une vision stratégique » ? Plusieurs remettent même en cause leur pertinence, au regard de leurs tâches effectives…
En tout cas, dans cette catégorie on place ces hautes personnalités du monde l’entreprise privée qui sont non seulement payés des millions pour leurs services à la tête de grandes entreprises, mais sont aussi très souvent comme « cul et chemise » (permettez-moi l’expression) avec nos dirigeants politiques. Oui, je sais, c’est très grave du point de vue éthique, c’est de la collusion ; nous, on parlerait tout simplement de « chums ». Par exemple, Justin Trudeau et Dominic Barton, ex-grand patron mondial de la firme de conseil McKinsey, sont chums.
Si les images peuvent tromper (leur accolade en 2017), les actions ne trompent guère : après avoir chargé le cabinet-conseil dudit Barton de penser pour lui dans le domaine de la défense, de la santé (en pleine pandémie) ou de la politique énergétique (c.-à-d. exploitation des énergies fossiles), au coût de 66 millions de dollars en 7 ans (contre à peine plus de 2 millions en 9 ans pour les conservateurs), le gouvernement Trudeau lui a confié la présidence d’un comité consultatif d’économistes chargé de la « transformation » d’immigration Canada. Certes il y a des choses à changer, à repenser, mais confier cela — et tout le reste — à une entreprise privée transnationale qui travaille juste avec les plus offrants (Russes, Chinois, Français, Américains…) sans appel d’offres et de plus en plus souvent ? Il y a là un méchant conflit d’intérêts à travailler pour tant de pays si différents, sur des sujets aussi sensibles, non ? Ça ne vous choque pas ? L’idée des 450 000 immigrants par an pour combler la pénurie de travailleurs, c’est McKinsey ! Une gang de brillants experts qui, en échange d’une rétribution mirobolante, ont organisé une dizaine de présentations et rédigé deux ou trois rapports !
Cerise sur le sundae ! Pour récompenser Dominic Barton de ces bons et loyaux services, les libéraux de Trudeau n’ont pas hésité à lui offrir le poste d’ambassadeur du Canada en Chine entre 2019 et 2021, quand il a pris sa « retraite » de McKinsey. Il me semble qu’ailleurs dans le monde — et je ne veux pas jouer mon conservateur, je ne le suis certainement pas — la société civile aurait d’ores et déjà réclamé la démission du chef de l’état pour un tel scandale. Et l’aurait obtenue.
Éditoriaux de décembre

Surtout à ce niveau-là. On le sent, on le sait. Cage aux sports du Plateau. Finale de la Coupe du monde de football. Mais rassurez-vous, pas de commentaire sur le score, pas de dégoulinement d’émotions personnelles. Il y a plus intéressant. Mon édito aurait pu tout aussi bien porter sur une autre de ces grand-messes financées à coups de centaines de millions de dollars, qui nous accaparent ponctuellement.
Je disais donc, c’est plus que du sport. C’est de la politique, c’est un révélateur des tensions internationales, une manière pour les pays d’exister, de s’affronter sur une pelouse, dans les règles, sportivement. Sur le plan domestique, on voit également s’exacerber les tensions entre citoyens d’origines différentes : la cohésion sociale est mise à rude épreuve.
C’est du social : quel autre évènement peut rassembler autour d’une même cause tout un pays, ou mieux, plusieurs pays ? Le temps d’une demi-finale, le Maroc est ainsi devenu le porte-étendard de l’Afrique et des pays arabes réunis ! Les équipes nationales sont aussi souvent un échantillon de la société dont elles émanent ; par exemple le Canada ou la France sont un magnifique exemple de leur diversité ethnique. Chacun-e s’y reconnait. Le sentiment d’appartenance s’en trouve surstimulé, transformé par l’alchimie d’émotions puissantes et primaires. Tout cela est éphémère, unique… et si divertissant ! Malheureusement pour notre santé mentale, diraient certains (« divertissement » signifie sortir de la voie, donc perdre de vue ce qui est important, un buzz temporaire) ; heureusement, répliqueraient d’autres : il est bon d’oublier nos soucis de temps à autre. Parce que la Coupe du monde, c’est d’abord du grand spectacle, avec des héros (les joueurs, dieux du stade modernes), des rebondissements (les éliminations surprises ou les blessures), du suspense (le retour de la France à 2-2 après 70 minutes et puis les tirs au but comme ultime épreuve). Facile d’être accro.
C’est du philosophique : l’événement qui place le pays hôte sur la carte l’ouvre au reste du monde, l’incite à se moderniser, par la construction d’infrastructures nouvelles, mais également en changeant ses perspectives, ses habitudes, ses mœurs. Le foot devient alors un facteur de démocratisation, un vecteur de progrès social (peut-être davantage de petites filles qataries joueront-elles au soccer à l’avenir ?). Toutefois, entre le traitement indigne des dizaines d’ouvriers morts pour édifier les stades, la corruption pour l’octroi de la compétition ou pour simplement adoucir l’image du Qatar, et les interdictions sur place pour les spectateurs, on peut en douter.
Le plus étonnant reste : comment et qui a pu penser qu’organiser un tel évènement au milieu du désert, dans un pays où le « foot » est quasi-inconnu, en hébergeant plus de deux millions de spectateurs, était une bonne idée ? Et avec aplomb, annoncer la Coupe du monde la plus « verte » de l’histoire ? Le Qatar produit 99 % de son électricité grâce au pétrole et ne possède littéralement pas d’eau douce et potable. Ce qui restera un record, c’est la quantité de GES produite ; et la « compenser » n’y changera rien ! En 28 jours, cela aura équivalu à 775 000 voitures ayant roulé pendant un an !
Ah ! J’oubliais, le sport à ce niveau-là, c’est quand même aussi… du sport, mais plus grand que nature, une performance physique et technique (artistique ?) qui peut constituer une inspiration pour tous, amateurs et pratiquants.

J’aurais pu écrire en sous-titre « Ou comment éviter de scier la branche sur laquelle nous nous trouvons ». Nous, humains, aimons bien les chiffres, de petits signes visuels qui symbolisent parfois des quantités ou des idées inimaginables. Mais on peut leur faire dire ce que l’on veut. Une bonne illustration en est le 30 %, objectif majeur de la COP15 sur la biodiversité à Montréal. 30 % des milieux naturels terrestres et marins protégés d’ici 2030. Super ! Rien que dans le sud du Canada, il ne reste déjà plus que 7 % de milieux naturels préservés. Donc, au Québec, notre gouvernement caquiste peut respecter cet objectif tout en ne protégeant en fait que des zones peu habitées, voire inhabitables, et continuer de laisser aux promoteurs et aux industries l’initiative du développement du territoire. Un vrai tout de passe-passe d’écoblanchiment !
Soyez rassurés cependant, si la flore et la faune sont toutes deux en péril, si l’humanité telle qu’elle vit aujourd’hui est en péril, la planète, elle, ne l’est pas : elle nous survivra, d’une façon ou d’une autre. En attendant, comme la COP 15 de Montréal le souligne fortement, on observe une accélération historique de la disparition des espèces vivantes, qui constituent chacune, faut-il le rappeler, un maillon de l’écosystème dans lequel nous vivons. Désormais, ce sont 70 % des écosystèmes de la planète qui sont dégradés ou perdus. Et notre coin de pays ne fait pas exception : regardez autour de chez vous ce qu’il en reste de « la Nature » ! Et je ne parle pas juste des arbres ! En effet, nous avons la chance énorme d’être entourés d’eau douce. Partout ailleurs dans les pays du Nord, les citoyens payent pour l’eau qu’ils consomment en vertu de la règle plus que logique de l’utilisateur payeur. 90 % de récifs de corail (qui abrite 6000 espèces et 30 % de la vie marine) disparaitront d’ici 2040 ou qu’un million d’espèces végétales et animales soient en voie d’extinction.
Chez nous, la rivière des Outaouais et les lacs avoisinants abritent des centaines d’espèces variées de plantes et d’animaux, qui déclinent voire meurent sous les effets conjugués de la prolifération d’espèces envahissantes, du développement urbain et de la pollution d’origine résidentielle et industrielle. Nous avons tous entendu parler de la reinette faux grillon, sur laquelle j’avais personnellement été interpellé, sans savoir quoi faire… Elle est maintenant protégée, mais il y en a tant d’autres !
Aux sceptiques, je dis : vous croyez être à l’abri des inondations, des tornades, de la sécheresse dévastatrice pour les cultures, des canicules, des problèmes respiratoires ou de la multiplication des virus aériens ? Mais si vous vous vous sentez tout simplement-e, je réponds : pourquoi ne pas signer une pétition aujourd’hui, faire un don à des organisations comme Garde-rivière des Outaouais demain, acheter des produits d’entretien bio en fin de semaine, participer au nettoyage de la forêt Deschênes au printemps, vous adresser à votre représentant politique occasionnellement ou encore vous impliquer dans votre association de quartier ? Les options sont nombreuses, il ne tient qu’à vous d’agir ! Paradoxalement, la COP 15 risque de s’achever sans objectif chiffré, à cause de l’obstruction de certains pays… Or, réintroduire de la biodiversité est un levier majeur, sinon essentiel, à la lutte contre les changements climatiques, l’ignorer est tout simplement criminel.

Qu’il s’agisse de Plan particulier d’urbanisme (PPU) pour le Vieux-Aylmer, de la bisbille autour du 19-21 rue du patrimoine (derrière l’immeuble du café « La Femme à marier ») ou de la récente conférence « Densification et patrimoine » organisée par l’Association du patrimoine d’Aylmer (APA), on devine aisément quel est l’enjeu qui se dessine là… Mais la véritable question à long terme est plutôt : à quoi ressembleront nos villes et nos logements dans le prochain siècle ? Question autour de laquelle ont tourné les cinquante derniers débats et table ronde de l’université de la terre sous l’égide de l’UNESCO, rien que ça ! 10 000 participants, près de 300 intervenants il y a peine deux semaines à Paris.
La densité urbaine est souvent amalgamée à la densité de population (nombre d’habitants au kilomètre carré) ; ce concept de concentration humaine, qui a pour corollaire la densification — son processus — a correspondu en réalité à différentes visions urbanistiques… et politiques : depuis la vision hygiéniste face à l’insalubrité de plusieurs quartiers par le passé, en passant par la pensée fonctionnaliste pour répondre au baby-boom de l’après-guerre, avec ses grands ensembles et la verticalité de ses tours. Mais, quel que soit l’aménagement urbain, encore faut-il en partager les ressources, y bien vivre, dans une communauté bienfaisante. C’est seulement depuis le rapport Bruntland (ONU, 1987) que la densité urbaine revient au premier plan, associée à la notion de développement durable.
C’est maintenant l’Alpha et l’oméga du développement des villes, à Gatineau comme ailleurs, et un enjeu majeur à l’ouest de la ville. L’exode rural vers les villes des derniers siècles a conduit à une saturation des réseaux et à quantité de problématiques plus criantes que jamais : développement des transports en commun, gestion des déchets, accès aux services (santé, éducation, alimentation), accès au logement (abordable) ; et avec la crise climatique, aménagement de « poumons », d’espaces verts qui évitent les îlots de chaleur et la pollution atmosphérique. A fortiori si l’on pense la ville comme une juxtaposition de quartiers spécialisés (affaire, résidentiel, industriel, etc.), au lieu de miser sur la mixité fonctionnelle, soit dit en passant seule alternative à un réseau de transport exceptionnel et très couteux. Mesdames et messieurs de la mairie, c’est pour vous !
Je terminerai en rappelant qu’en matière de densification urbaine, l’expérience d’une ville-état comme Singapour — l’exact opposé de Gatineau et de toutes les villes continentales, certes — peut nous aider à réfléchir. En effet, nous avons la plus grande difficulté à envisager de construire vers le haut et à utiliser chaque centimètre carré : notre histoire canadienne s’est faite horizontalement, à coup de déboisement et de rangs, au sein d’un espace que l’on pourrait croire infini. Voilà deux principes de densité urbaine que nous acceptons avec grande difficulté. Les Singapouriens passent leur temps à détruire leurs habitations pour en construire des plus grandes des plus hautes, des plus modernes à étendre les terres constructibles, en assurant une qualité de vie extraordinaire.
Cependant, ne vaut-il pas mieux améliorer l’ancien plutôt que construire du neuf ? Revitaliser les petites villes plutôt que d’étaler les métropoles ? Les GES, c’est surtout lors de la construction qu’ils sont émis, en plus de consommer beaucoup de matériaux énergivores et d’accélérer l’artificialisation des sols naturels et agricoles. Alors, restaurons, rénovons, adaptons, créons des espaces verts et rendons les espaces publics… aux citoyens !

Sur les 60 témoins entendus par la commission Rouleau sur l’état d’urgence de février dernier, combien croyez-vous étaient francophones ? Et combien ont parlé en français ? Seulement trois hauts fonctionnaires du Service canadien du renseignement de sécurité ? Dominique Leblanc, acadien, ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des collectivités ? Justin Trudeau? En réalité, un seul témoin a entièrement communiqué en français : Steeve Charland, un Québécois leader du groupe des Farfadaas, un groupe d’opposants aux mesures sanitaires ! Sympa comme image des Francos !
Mais enfin, il s’agissait d’une commission fédérale ! Vous savez, ce palier de gouvernement qui prétend défendre le français et prône l’emploi des deux langues officielles au travail? Et bien, même dans ce genre d’événement, il ne serait donc pas possible d’échanger dans la langue de son choix, en l’occurrence le français ? Faits intéressants : la traduction simultanée était offerte et le juge Rouleau, qui préside cette commission, est franco-ontarien ! Que s’est-il passé ?
La réponse est simple. Et triste. La plupart des témoins francophones trouvent l’anglais plus « facile », plus « confortable » et normal, puisque certains avocats ne parlent pas le français. Comme c’est mimi ! Comme c’est généreux ! On pourrait aussi y voir de l’aplaventrisme, corollaire d’une insécurité linguistique généralisés, résultat de l’anglonormativité (l’anglais est la langue dominante, on doit être capable de se faire comprendre et de l’utiliser en toute circonstance), bref comme une forme de « racisme » linguistique systémique, puisque relié aux structures du pouvoir. La moquerie subie par le conseiller municipal Mathieu Fleury durant son témoignage en est d’ailleurs un exemple parfait.
Alors, pour régler le problème, pourquoi ne pas suivre les conseils de la ministre Mona Fortier ? On va « continuer à suggérer d’utiliser les deux langues officielles partout ». Et bien, avec ce genre de mesure puissante, on n’est pas sorti de l’auberge ! Et on comprend mieux pourquoi la modernisation de la Loi sur les langues officielles, promise depuis 2015 par le gouvernement libéral de Trudeau n’a toujours pas été adoptée, alors qu’elle est à l’étude depuis mars dernier. Et je ne parle même pas du contenu de ladite loi, clairement pas à la hauteur des enjeux réels de la survie du français au Canada.
La situation est vraiment préoccupante. À l’image de la francophonie institutionnelle, celle de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF). Cet organisme unique au monde réunit 88 pays et états francophones et mène des actions pour créer des ponts entre les 320 millions de francophones. Or, l’OIF a pour secrétaire-générale la citoyenne d’un pays qui a non seulement abandonné l’organisation, mais également le français lui-même, en adoptant l’anglais comme langue officielle ! Elle a été placée là par Emmanuel Macron, le président français, pour des raisons politiques. De plus, le Sommet de la Francophonie s’est tenu la semaine en Tunisie, un pays dirigé certes par un président élu, mais qui, depuis, a dissout le parlement et s’est arrogé les pleins pouvoirs. Bel exemple de démocratie ! On rétorquera que l’OIF aborde des enjeux d’aujourd’hui, dans une perspective multilatéraliste : l’éducation des jeunes, l’entrepreneuriat féminin comme facteur de croissance économique, la culture numérique, la « défiance citoyenne » envers les gouvernements… Ne sont-ce pas les problématiques du futur pour une francophonie de l’avenir ? Et au Canada? Demandez à nos décideurs ce qu’ils en pensent, ici, dans notre beau pays bilingue. Juste pour rigoler… ou pleurer.
Éditoriaux de novembre

J’ai fait mon laïus auprès de mes élèves les plus âgés, parce que je ne pouvais décemment pas l’ignorer. Appelons-le enseigner l’esprit critique ou l’éducation citoyenne, mais certainement pas de la partisanerie. Parce qu’objectivement, utiliser nos impôts pour payer un voyage à la COP 27, en Égypte, aux quatre entreprises pétrolières les plus grosses au Canada, sous prétexte qu’il faut maintenir le dialogue avec ces immenses pollueurs, qu’ils « font partie de la solution », c’est une honte. Ironie extrême : ces sociétés, qui exploitent les sables bitumineux et le gaz de schiste, se sont présentées en tant que championnes de la transition écologique ! En effet, ne vont-elles pas « capturer » le dioxyde de carbone et l’enfermer à tout jamais ? C’était un peu comme inviter un pyromane à trouver des solutions aux feux qu’il a allumés et puis qu’il propose de planter quelques arbres en retour.
À part ça, ça va bien. On voulait réaffirmer que l’objectif de tous les pays de la planète, mu par le même souci du bien commun, était de sortir de l’exploitation des énergies fossiles, rien n’est dit dans le texte final. On visait un maximum de 1,5 degrés d’augmentation des températures moyenne, c’est mentionné du bout des lèvres ; en vérité, tout le monde sait que ce sera infaisable… Mais on ne les dépassera pas, promis, juré, craché ! Et le Canada est le premier à l’affirmer avec force. Le dire, c’est une chose, mettre en œuvre les moyens, en est une autre.
Par ailleurs, le deuxième résultat – historique, lui - de cette COP, mais dont le sujet apparut incidemment à l’ouverture de la réunion, est de prévoir un mécanisme, un fond permanent de dédommagement des pays victimes de catastrophes climatiques ; un genre d’assurance tout risque rapidement débloquée en cas de sinistre environnemental. C’est beau, c’est nouveau, et c’est une initiative des Pays du Sud, les mêmes qui polluent le moins, mais en subissent le plus les effets. Seul petit problème : les plus gros pollueurs de la planète (la Chine et les États-Unis pour ne pas les nommer) ne veulent pas y contribuer ! On ne sait toujours qui va payer ! Et quid du dédommagement des pays colonisés pendant les 150 dernières années d’exploitation et de pollution, et victimes massives aujourd’hui de la crise climatique ? Oups ! On l’a oublié !
Quand on apprend qu’il y avait à Charm el-Cheikh plus de lobbyistes proénergies fossiles que de groupes défenseurs de l’environnement et de la biodiversité, on comprend vite que l’optimisme de notre ministre fédéral de l’environnement, passé maitre dans la langue de bois, avec ses expressions atténuantes et ses déclarations creuses, n’est guère plus qu’un murmure éphémère. Cette fois-ci, les libéraux de Trudeau ont accouché d’un nouveau concept : le Défi mondial sur la tarification du carbone ! Commencez par atteindre les objectifs que vous vous êtes donnés dans votre propre pays, les gars, et on en reparle.
On a beau dire que le dialogue entre les états est nécessaire, que les COP sont juste le reflet ponctuel de l’état d’avancement de nos actions, la pilule est amère à avaler : c’est par une débauche d’allées et venues créatrices de GES, dans une station balnéaire pour les riches, que ces discussions ont lieu et mènent plus à de belles paroles (et encore !) qu’à des actes concrets.

Vous êtes de petits coquins ! Ne vous sentez pas personnellement visé-e, mais vous m’avez forcé à chercher dans mes textes passés, afin de vérifier que je ne me trompais pas. Et en effet, j’évoquais encore à l’époque (au printemps dernier, et avec un optimisme très modéré) le maintien du réchauffement climatique à 1,5 degré. Et bien c’est définitivement terminé. Le bilan est limpide : aucun des engagements pris dans les Conférences des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques précédentes n’est suffisant. Ces derniers seraient réalisés — ce qui n’est même pas le cas — que nous nous dirigerions toute de même vers du 3 degrés ! Or, aucun des 40 indicateurs de progrès élaborés par les chercheurs du rapport L’État de l’action climatique 2022 n’a évolué dans le bon sens à ce jour !
La 27e COP a commencé dimanche dernier à Charm el Cheikh ; elle durera jusqu’au 18 novembre et tentera de « renouveler la solidarité entre les pays du monde afin de concrétiser l’accord historique de Paris. » Dans ce noble but — sauver le monde, rien que ça ! — les chefs d’État, les ministres, les négociateurs, les militants proclimat, les maires, les chefs d’entreprise et les lobbyistes de tous horizons vont plancher sur les solutions à la crise climatiques et le respect de leurs engagements.
Comme si l’on ne connaissait pas les solutions. Comme s’il fallait attendre la COP pour tenir ses promesses. Comme si l’on n’avait pas compris que les efforts chez nous, c’est bien, mais financer les efforts dans les pays du sud global, c’est mieux. En 2015, la COP avait abouti à une promesse de leur verser 130 milliards de dollars par année, à partir de 2020 (vous voyez un peu comment ça fonctionne. Ça ne vous rappelle pas certaines promesses libérales ?). Ce chiffre n’est même pas atteint en 2020, alors vous pensez, en 2022 ! Parce qu’évidemment, l’effet de reprise post-COVID étant passé, nous sommes désormais empêtrés dans une récession (que nos élus osent à peine nommer telle) et dans une crise énergétique sans précédent depuis 50 ans. Dès lors, où trouver l’argent ? D’ici le 18 novembre, une fronde des pays les plus pauvres — qui sont, comme par hasard, les plus touchés par les catastrophes naturelles — n’est pas impossible…
Et je ne parle même pas de reconnaitre les pertes et les dommages que ces pays ont subis dans le passé, du fait de la responsabilité historique de quelques pays, dont le Canada, dans la crise climatique actuelle. Quid des actions entreprises par les plus grands pollueurs de la planète, l’Inde, la Chine, la Russie et les États-Unis ? Seules 24 « parties » ont déposé une mise à jour de leur cible de réduction des GES.
Pourquoi la mise en place des solutions contre la crise climatique n’avance-t-elle pas plus vite ? D’abord à cause d’une incompréhension profonde de la situation, qui n’est pas seulement physique, économique et technique, mais sociopolitique : les lobbys, les intérêts divergents des états nationaux s’ajoutent à l’impossibilité intellectuelle de se projeter, de se figurer les conséquences matérielles de la crise. Et on vous les donnerait, vous n’y croiriez pas ! Ainsi est fait le cerveau humain… Je désespère que les états participants à la COP 27 aient l’honnêteté de reconnaitre le pétrin cosmique dans lequel nous nous trouvons.

Il y a deux semaines, deux militantes de Just stop oil avaient jeté le contenu d’une boite de conserve de soupe de tomate sur la toile « Les Tournesols », à la Galerie nationale de Londres. Argument avancé en public sur la vidéo virale : « Qu’est-ce qui a le plus de valeur ? L’art ou la vie ? ». Une manière d’attirer de façon très visuelle (pensez aux couleurs ainsi associées !) l’attention médiatique, selon ces militantes écologistes. Une manière aussi de rappeler à l’ordre un gouvernement qui veut continuer l’exploitation des hydrocarbures sous prétexte de crise énergétique.
Ce n’était pas une première dans la capitale britannique, c’est même un stratagème séculaire. Mais convenons que cela a fonctionné. Heureusement, l’œuvre célèbre de Van Gogh était protégée par une vitre. La semaine dernière, à Berlin, deux écomilitants de Last generation ont lancé de la purée sur « Les Meules », un tableau du peintre impressionniste Claude Monet. Dans les derniers mois a eu lieu une véritable épidémie de « performances », qui n’ont rien d’artistiques, mais sont plutôt politiques.
Vous avez trouvé cela choquant ? Vous ne comprenez pas la relation entre le pot de jus de tomate ou de purée et les œuvres ? C’est tout à fait normal : l’objectif n’était pas d’attirer la sympathie du grand public ou de faire de l’art, il était purement médiatique. D’ailleurs, sur le fond, tous ces activistes qui désespèrent de voir nos gouvernements bouger, changer de paradigme, ont-ils réellement tort ? Certes, nous aurions été désolés de voir le tableau de Van Gogh, d’ailleurs méconnu et ignoré par ses contemporains, abîmé, mais qui se révolte de la disparition de la surface de la Terre d’une espèce vivante (animale ou de plante) chaque 20 minutes ? Et même si seulement la moitié de ces 26 000 extinctions sont le fait de l’activité humaine, avouez que ce chiffre est effarant. Notre indignation collective est pas mal à géométrie variable.
De plus, les musées ne symbolisent-ils pas l’élitisme culturel et les gouvernements, souvent même utilisés par ces derniers dans les relations diplomatiques et pour raconter une version idéologique de l’histoire nationale ? “Les Tournesols” valent aujourd’hui près de 40 millions de dollars, “Les Meules”, 111 millions de dollars. Des prix pour un art seulement accessible à des “investisseurs” privés - princes, magnats de l’industrie, patrons de start-up milliardaires ou traders qui jouent avec nos épargnes - ce 1 % qui accapare 80 % de la richesse mondiale.
Un paquet de gens, y compris moi, en ont ras le bol. On change nos habitudes de consommation, on tente de convaincre nos proches, on manifeste, on se dit qu’en s’impliquant politiquement ou dans des associations, les choses changeront. Mais la situation environnementale et sociale se dégrade plus vite que les états n’agissent… Quel score a fait le Parti vert du Canada aux dernières élections ? Qu’a changé Steven Guilbault depuis qu’il est ministre fédéral ?
L’action perturbatrice est donc une voie possible, quitte à faire ce que Gandhi et sa marche du sel, Rosa Parks et son boycott ou les Baltes en chantant ont fait. Une révolution pour répondre à une crise profonde et injuste de leur société. Alors, bloquer l’entrée d’un site de chargement de pétrole, s’enchainer à des grues sur le point de détruire des écosystèmes cruciaux, faire un sit-in quotidien devant les bureaux de nos représentants politiques, pourquoi pas ?
Éditoriaux d'octobre

Nous pourrions nous réjouir d’entendre la mairesse Bélisle annoncer son intention de placer dans la liste des enjeux à présenter au gouvernement provincial fraîchement élu le projet de tramway à l’ouest de la ville. Cependant, pourquoi le remettre sur la table, alors qu’ à part pour le palier fédéral - merci Greg Fergus - il fait déjà consensus ?
Personnellement, je ne comprends pas. S’assurer (à nouveau) que le gouvernement « continuera » dans ce projet nécessaire, structurant et écologiste ? Instiller un doute sur sa pertinence sans le remettre en cause frontalement ? J’ai un doute sur les motivations profondes de notre nouvelle élue. N’a-t-elle pas elle-même parlé de le « repositionner » ? Creusons un petit peu.
Visiblement, les autorités fédérale et provinciale ne s’entendent pas sur le financement et la gestion de ce projet qui sont désormais interprovinciaux, depuis que l’arrimage avec le système de transport ottavien a été acté par toutes les parties. La ville et la STO déclarent vouloir garder en ligne de mire le rail plutôt que la route (l’autobus), mais l’harmonisation des deux réseaux semble problématique… Se désengager de cette initiative telle qu'elle est aujourd'hui est-ce la solution ? En tout cas, le résultat est clair : le financement pour l’étude de l’avant-projet n’est même pas encore arrivé !
Or, à trop tarder, nous allons avoir dans 10 ans un moyen de transport dont la technologie datera d’il y a 15 ans, celle utilisée par Ottawa avec le succès — mitigé — qu’on lui connait. On parle -là d’un « retard » de 25 ans. Une génération ! Veut-on vraiment de cela ? Quelle vision d’avenir, quel leadership environnemental cela illustre-t-il ? Puisqu’il s’agit d’un enjeu de gouvernance, la ville pourrait reprendre la main et changer le tracé, abandonner l’idée du lien interprovincial, réviser le choix de la technologie… Mais cela signifie également repartir de zéro !
En réponse à ces atermoiements, la réponse de nos élus est molle ; ni Mathieu Lacombe ni Greg Fergus ne semblent prendre la mesure de la frustration de la population ; ils disent « continuer à travailler avec tous les partenaires ». Pour ? Rien : aucun résultat tangible dans un dossier dont j’entends parler depuis mon installation dans la région en 2005 ! Ils manquent tout simplement de leadership. Ou bien le député McKinnon et son souhait d’un sixième pont à l’est de la ville a-t-il plus de poids auprès de Trudeau que notre représentant dans Hull-Aylmer ?
Ce qui est certain, c’est que toutes les études montrent que le tramway, en plus d’être moins polluant, représente le meilleur moyen pour répondre aux enjeux de transport collectif en général : il permet de transporter deux fois plus de gens que des autobus et l’on sait qu’une plus grande rotation de petits transports vaut mieux qu’un autobus accordéon à la demi-heure, fût-il un service rapide par bus. À l’horizon 2030, poursuivre sur la lancée du Rapibus signifierait en effet davantage de congestion routière et plus de GES.
L’argument qui prévaut en ce moment de la complexité extrême du projet, parce que nécessitant une coordination entre cinq gouvernements distincts, ne doit pas nous faire oublier une chose : le projet d’un transport structurant et écologique à l’ouest de la ville est absolument nécessaire. Et entre nous, on en a un peu assez d’être les parents pauvres de l’accessibilité aux services essentiels ici, à Aylmer.

Et oui, il arrive parfois qu’au-delà des paroles creuses que l’on entend de-ci de-là sur l’importance du français, sur la nécessité de le soutenir, par une rénovation de la loi sur les langues officielles (au Canada) ou de la loi 101 (au Québec), il arrive alors que des actes forts consacrent la langue de Corneille, de Rostand et de Miron comme langue universelle. Décerner le prix Nobel de littérature à une écrivaine française en est un sacré !
Mais revenons d’abord sur le processus qui conduit à ce résultat pour mieux en comprendre la portée. Chaque année depuis 1901, en mémoire d’Alfred Nobel qui créa l’Académie du même nom, on remet un prix à cinq personnes (ou groupes) ayant rendu service à l’humanité dans cinq disciplines : paix, littérature, chimie, médecine et physique ; celui d’économie, créé en 1968, est le seul qui ne figurait pas dans le testament de l’illustre Suédois. Les lauréats sont annoncés en octobre et reçoivent leur prix (environ 870 000 euros chacun) en janvier.
Cependant, ils doivent respecter plusieurs critères pour y être éligibles. Déjà, contrairement à l’Académie française, personne ne peut se présenter soi-même, les candidatures proviennent de diverses académies dans le monde, de figures reconnues, de personnalités qualifiées dans leur domaine. Les candidatures sont ensuite sélectionnées une première fois par un comité spécial composé de cinq académiciens aidés par des conseillers et des experts internationaux, et élus pour trois ans. Avant l’été, cinq noms ressortent de ce tri dans chaque discipline. Les mois suivants sont occupés à la lecture en profondeur de leurs œuvres. Après une dernière rencontre mi-septembre, le vote est organisé ; la décision est prise à la majorité des voix. L’âge, l’origine géographique et le sexe n’y font rien théoriquement, mais évidemment, depuis sa création, une majorité d’homme blancs anglophones ont reçu le Nobel. Les choses ont changé depuis 2018, suite à un scandale qui a forcé l’Académie à revoir ses critères de sélection. Malgré tout, recevoir ce prix équivaut encore à une reconnaissance prestigieuse, à une consécration : l’œuvre primée doit se démarquer par son ampleur, son style unique et parce qu’elle « fait preuve d’un puissant idéal ».
Après le romancier anglais d’origine tanzanienne Abdulrazak Gurnah et la poétesse américaine Louise Glück, cette année, la Française Annie Ernaux s’est vue récompensée « pour le courage et l’acuité clinique avec lesquels elle met au jour les racines, les éloignements et les contraintes de la mémoire personnelle ». Elle aborde les thèmes de la mémoire, mais aussi des rapports de domination sociale, des femmes. On parle ici du genre autobiographique, qui touche à l’universel à travers le particulier. Un tour de force, dans ce qu’elle nomme une « autobiographie impersonnelle ».
Contradictoire ? Assurément. Sa perspective est iconoclaste, tout à fait particulière. Elle le dit elle-même : « Pour moi, chaque mot doit avoir la lourdeur du vécu. Je recherche la densité des mots […] J’essaie de justement de déjouer tout ce langage qui classe et hiérarchise. ». Elle est la seizième Française à recevoir le prix Nobel, et la dix-septième femme. Son premier succès international ? Les Années (Gallimard, 2008). Son dernier roman ? Le Jeune Homme (Gallimard, 2022).
Au-delà de la nationalité de la récipiendaire du Nobel de littérature, qui a tout pour nous rendre fiers en tant que francophones, c’est surtout une victoire de la littérature elle-même.

Selon Élections Québec et Statistiques Québec, ce sont respectivement, et du premier au dernier, le montant de votants, de citoyens inscrits et de Québécois au total. Il y a plusieurs conclusions évidentes à tirer de ces trois nombres, il suffit d’en regarder les deux premiers chiffres !
Pour commencer, seulement deux personnes sur trois ont fait le déplacement pour exercer leur droit. Ce n’est clairement pas assez pour une démocratie, mais si l’on se souvient du chiffre des élections municipales (33 %), on se console, comme dit l’expression ! Et c’est égal au taux de participation de 2018. Alors ? Alors… La participation stagne depuis plusieurs années, avec une tendance à la baisse sur un demi-siècle, toutes élections confondues. Certains pourraient demander que le vote soit rendu obligatoire… D’autres rétorqueraient aussitôt qu’on leur prend une liberté de plus…
Que faire ? Il y a manifestement un désintérêt croissant pour la politique (partisane), une perte de confiance énorme, une perte du crédit donné à nos gouvernements pour accomplir leur mission, pour prendre soin de la population. C’est grave. Et si l’on comptabilisait le vote blanc, par exemple, comme l’expression véritable d’une fidélité à la démocratique, et non seulement comme un désaveu des forces en présence ?
Ensuite, la CAQ, qui se targue d’avoir « un mandat clair » de la population, ne récolte finalement que 41 % de 66 % ; un quart (soit à peine un sur deux) des électeurs ayant voté, soit un-e Québécois-e sur quatre. Vos deux voisins, celui de droite et de gauche, mais aussi celui au centre en face de vous, n’ont pas voté pour le premier ministre de la continuité Legault. Vu sous cet angle, cela parait incroyable, non ? Avec leurs 600 000 votes et leur soi-disant « mandat fort », eux aussi, les libéraux devraient moins claironner : s’ils avaient la moindre parcelle d’intégrité politique et morale, ils devraient plutôt reconnaitre que, dans les faits (en termes de soutien populaire), ils sont troisièmes derrière QS… et pas mieux que le PQ. Ajoutez-y le PCQ, qui les talonne !
Ces quatre partis font pitié, disons-le. Pour des raisons différentes et que l’on peut déplorer ou pas, selon nos préférences. Cependant, objectivement, entre un parti libertarien — naissant et opportuniste — un parti qui a perdu le Nord — et racole ce qu’il peut, cantonné qu’il est à Montréal — un parti qui a retrouvé son Nord, mais dont les électeurs voient de moins en moins la pertinence — et un vrai parti de gauche, qui a la justice chevillée au corps, mais qui s’est converti au wokisme et au multiculturalisme — comment faire pour qu’ils soient justement et dignement représentés à l’Assemblée nationale ? Peut-être, introduire de la proportionnalité dans un scrutin uninominal majoritaire à un tour venu directement des temps anciens du dominion britannique ?
C’est pour cette même dernière raison qu’aucun parti n’est prêt s’allier à un autre, prêt à collaborer pour monter une liste électorale ? N’y a-t-il donc aucun point commun, aucun terrain d’entente, aucun dénominateur commun entre vous ? Quelque chose qui permettre au Québec de gagner contre les crises que nous traversons, quitte à y perdre un peu ? La « tradition parlementaire », le système britannique ont bon dos. Pour le bien de tous, s’il vous plait, mettez vos ego de côté, soyez humbles et surtout, soyez pragmatiques !

Au moment où j’écris ces lignes, je ne connais pas le résultat précis des élections provinciales. Évidemment, la CAQ va rester aux commandes du Québec, avec une majorité de sièges… et la plus forte minorité de voix parmi les partis en présence. Le résultat d’une distorsion systémique qui a posé et pose un problème grandissant de représentativité démocratique.
Cependant, il existe au moins un sujet qui nous concerne tous (simples citoyens, associations, entreprises, partis de droite comme de gauche — si cette dichotomie existe encore —), un sujet qui fait l’unanimité, mais largement galvaudé et que certains toutefois dénoncent. La transition énergétique doit pourtant une priorité absolue — oui, devant l’inflation, l’immigration ou l’économie — pour le nouveau gouvernement.
Pour comprendre ce concept, il faut se rappeler que notre dépendance aux énergies fossiles (essentiellement pétrole, gaz et charbon), en remplacement des énergies traditionnelles (l’eau et le bois) et au détriment des énergies renouvelables (marémotrice, éolienne, solaire, etc.), cette addiction est un choix qui date de la fin du XVIIIe siècle pour répondre à la poussée démographique et à l’accroissement des productions en Europe.
C’est dans les années 1860-1870 que l’hégémonie du charbon se réalise… peu après remplacée par celle du pétrole, à l’orée du XXe siècle. La Première Guerre mondiale marque le début du règne de l’automobile, la seconde celui de l’avion. À l’époque, une convention impose même à tous les états de vendre le kérosène à prix coutant, sans taxe. Cette mesure, qui devait permettre la mobilité du plus grand nombre, nous a juste collectivement précipités dans l’une des crises existentielles les plus graves que l’humanité ait jamais traversées. Nous n’en sommes toujours pas sortis : réfléchissez-y bien, notre mode de vie est littéralement basé sur l’automobile. Et qui est prêt à en changer ? Vous ? Moi ?
Or, plusieurs nous ont prévenus depuis longtemps, bien avant que se présente l’enjeu climatique dans les années 1970, avec la découverte du trou de la couche d’ozone. L’historien Lewis Mumford, le philosophe Ivan Illich ou l’économiste Alfred Sauvy ont entrevu l’impasse du « tout-auto » (autrement appelé la « mentalité moteur »). Mais qu’arrive-t-il aujourd’hui ? Tous les constructeurs, avec l’aval de nos gouvernements, nous présentent l’automobile électrique comme la solution, un transport propre (quid de sa construction ?), en oubliant de parler de la production d’énergie en amont, par des centrales thermiques ou nucléaires… Objectif d’ici 2050 : la neutralité carbone, qui se fera à coup de subventions massives qui elles-mêmes vont augmenter la pression fiscale, au détriment des revenus et de la redistribution dans des domaines tels que la santé et l’éducation.
De surcroît, le problème demeure que nos solutions ne sont valables que si elles sont également appliquées par les autres régions du monde (90 % de la population mondiale). Nous sommes par ailleurs consommateurs de produits de plus en plus énergivores : électronique de nos véhicules, téléphones 5G, cinéma-maison, frigos ou maisons connectés, métavers… Tous friands de minerais rares, au point que les énergies renouvelables ne pourront probablement pas y suffire. Et c’est sans compter que l’être humain n’a jamais autant brûlé de charbon et de pétrole ! Au fond, une véritable transition énergétique requiert deux actions simples dans les actes — mais difficiles psychologiquement : diminuer notre consommation d’énergie, voire notre consommation tout court ; et limiter l’utilisation de l’automobile et de ces variantes !